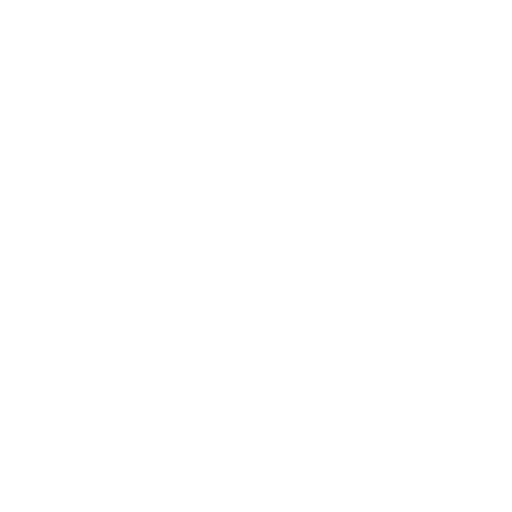0 avis
Église paroissiale Saint-Gervais-et-Saint-Protais
France > Nouvelle-Aquitaine > Vienne > Champagné-Saint-Hilaire
Historique
Champagné, " Campaniacus ", est cité dans un diplôme du 30 décembre 889 par lequel le roi Eudes confirme un partage de terres suite à un don fait aux chanoines de Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers ; Campiniacus apparaît comme dépendance du chapitre poitevin (Beauchet-Filleau, p. 230).
La paroisse " De Campigniaco ", mentionnée dans le Pouillé du diocèse de Poitiers du début du 14e siècle, forme, avec celle de Romagne, le territoire d'une châtellenie appartenant au chapitre de Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers, à l'exception des terres dépendant de la seigneurie de la Millière. La cure était à la nomination du chapitre de Saint-Hilaire.
À l'époque romane est édifiée l'actuelle église Saint-Gervais-et-Saint-Protais dont il subsiste au moins la façade occidentale et son portail sculpté. Deux autres établissements religieux sont attestés sur le territoire de la paroisse : l'abbaye bénédictine Notre-Dame des Moreaux (qui aurait été fondée au début du 12e siècle) et le prieuré Sainte-Catherine de la Millière, prieuré de l'ordre de Saint-Augustin dépendant de l'abbaye de Saint-Séverin (Rédet, p. 264). Les deux monastères, et peut-être l'église paroissiale, sont dévastés pendant la guerre de Cent Ans et, au 16e siècle, lors des guerres de religion.
Une campagne de travaux est effectuée dans les années 1580 (registre des actes du chapitre de Saint-Hilaire-le-Grand).
Le Pouillé de 1782, qui fait état de 800 communiants dans la paroisse, signale l'existence, dans l'église Saint-Gervais-et-Saint-Protais, de deux chapelles dédiées à Sainte-Catherine et à Notre-Dame de la Compassion, et d'une troisième dite d'Aymard Nepveu. En revanche, la chapelle des chantres de Saint-Hilaire, attestée en 1648, n'est pas citée (Beauchet-Filleau, p. 231).
Le clocher a été édifié à l´époque moderne sur le flanc nord et la sacristie sur le flanc sud. La cloche la plus ancienne, Gervaise, date de 1728.
Jusqu'en 1789, la paroisse de Champagné-Saint-Hilaire fait partie de l'archiprêtré de Gençay, de la sénéchaussée et de l'élection de Poitiers (Rédet, p. 86). La paroisse devient, en 1789, la commune de Champagne-St-Hilaire. En 1794, sous la Terreur, elle prend provisoirement le nom de Champagné-la-Montagne.
Après le Concordat de 1801, l'église paroissiale devient une succursale. Le 17 avril 1898 sont baptisées deux cloches, sorties des ateliers de M. Vauthier, fondeur à Saint-Émilion. Louise, la plus petite, a été cassée le 8 mai 1945 et refondue en 1970.
En 1925, le portail de l'église Saint-Gervais-et-Saint-Protais est inscrit sur la liste supplémentaire des monuments historiques. Cinq ans plus tard, les vestiges de la façade occidentale de l'église ruinée de l'abbaye des Moreaux sont également protégés au titre des monuments historiques.
Au début des années 2000, l'église a bénéficié de travaux de réfection (toiture, chevet extérieur, peintures intérieures, enduits extérieurs). En 2007, la façade occidentale est restaurée (nettoyage, traitement algicide de la végétation, remplacement des pierres de taille).
Description
L´église, de plan allongé, est dédiée aux saints Gervais et Protais. Elle est située dans le bourg, sur une butte qui culmine à 178 m.
La façade occidentale présente deux niveaux séparés par une corniche à modillons.
Le portail central est encadré de deux arcades aveugles, hautes et sans décor. La voussure à deux rouleaux est décorée de feuillages en S sur le rouleau interne et de quadrupèdes et de griffons assis ou cabrés, disposés claveau par claveau, sur le rouleau externe. Le tout est cerné par une archivolte portant un décor de palmettes doubles. Des claveaux en surnombre ont été insérés dans l´arcature aveugle sud (pour plus de détails, voir l´annexe 1).
Les chapiteaux du portail sont sculptés, à gauche, de deux lions affrontés dont la tête unique a disparu et à droite d´un griffon affronté à un dragon ailé à deux têtes opposées (amphisbène).
La corniche est soutenue par douze modillons sculptés.
Au-dessus, une baie est encadrée de colonnettes à chapiteaux sculptés.
Les rampants du pignon et la croix antéfixe sont modernes.
Le chevet est plat et rythmé par deux contreforts à la jonction de la nef et des chapelles latérales.
Le chœur originel était éclairé par un triplet remplacé par une baie unique. Les anciennes baies nord et sud de ce triplet, murées, sont visibles à l´extérieur.
Les chapelles latérales, dédiées l´une à la Vierge, l´autre à saint Nicolas, ont été ajoutées postérieurement à l´édifice roman et sont éclairées par des baies gothiques. Elles sont adossées et couvertes d´un toit à un pan en tuile creuse. Deux puissants contreforts ont été construits à l´est à la jonction des chapelles et de l´ancien chevet. Chacune des chapelles est également contrebutée par un contrefort dans l´angle oriental.
La nef est couverte d´un toit à longs pans à pente assez faible.
Le clocher a été édifié à l´époque moderne sur le flanc nord. Il est de plan carré et couvert d´une flèche carrée en ardoise. Chaque face est éclairée par deux baies en plein cintre.
La nef unique est voûtée de croisées d´ogives. Elle est prolongée par un chœur légèrement surélevé qui comporte deux séries de stalles en chêne. La chapelle nord comprend deux travées. Elle a conservé ses arcs pénétrants élégamment dans les supports sans chapiteaux.
La sacristie est adossée à l´élévation sud.
Brouillet (1865) signale juste les deux rouleaux du portail ornés de palmettes et de quadripèdes ailés, ainsi que la corniche avec des modillons historiés.
Pour de Longuemar (Les anciennes fresques . . ., 1884, p. 47), la façade romane présente une porte à deux archivoltes à feuillages retombant sur des corniches et des chapiteaux ornés de griffons ; elle est encadrée de deux arcades aveugles en plein cintre. Un cordon à modillons ornés d'un bestiaire sépare cette triple arcature d'une « fenêtre romane d'un bon style ».
Détail de la description
| Murs |
|
|---|---|
| Toits |
|
| Plans |
plan allongé |
| Couvrements |
|
| Couvertures |
|
| Décors/Technique |
|
| Décors/Représentation |
Précision sur la représentation : Voir annexe 1 : le décor roman de la façade occidentale. |
Informations complémentaires
Bien que Champagné (Campaniacus) soit cité dès la fin du 9e siècle, l'église Saint-Gervais-et-Saint-Protais est édifiée à l'époque romane. Elle a subi de nombreuses modifications par la suite et il ne reste guère de cette époque que la façade occidentale et son portail sculpté.
L'église Saint-Gervais-et-Saint-Protais, dans le bourg de Champagné-Saint-Hilaire, est le résultat de constructions successives. Si la façade, restaurée en 2007, conserve des éléments romans, le reste de l'édifice a connu d'importants dégâts suite à la guerre de Cent Ans et, au 16e siècle, lors des guerres de religion. Une importante campagne de reconstruction est menée à partir de 1580. La nef unique est voûtée de croisées d´ogives. Elle est prolongée par un chœur légèrement surélevé qui comporte deux séries de stalles en chêne. Le clocher, de plan carré et couvert d´une flèche carrée en ardoise, a été ajouté au nord à l'époque moderne et la sacristie au sud. La cloche la plus ancienne, Gervaise, date de 1728.
Le chevet est plat et rythmé par deux contreforts à la jonction de la nef et des chapelles latérales. Le chœur originel était éclairé par un triplet remplacé par une baie unique. Les anciennes baies nord et sud de ce triplet, murées, sont visibles à l´extérieur. Les chapelles latérales, dédiées l´une à la Vierge, l´autre à saint Nicolas, ont été ajoutées postérieurement à l´édifice roman et sont éclairées par des baies gothiques.
La façade occidentale, seul élément roman important conservé, présente deux niveaux séparés par une corniche à modillons. Le portail central est encadré de deux arcades aveugles, hautes et sans décor. La voussure à deux rouleaux est décorée de feuillages en S sur le rouleau interne et de quadrupèdes et de griffons assis ou cabrés, disposés claveau par claveau, sur le rouleau externe. Le tout est cerné par une archivolte décorée de palmettes doubles. L´imposte porte à gauche une file d´animaux très érodés, avec des feuillages superposés et à droite d´un décor de palmettes.
Les chapiteaux du portail sont sculptés, à gauche, de deux lions affrontés dont la tête unique a disparu et à droite d´un griffon affronté à un dragon ailé à deux têtes opposées (amphisbène).
Trois claveaux en surnombre ont été insérés dans l´arcature aveugle sud.
La corniche qui sépare les deux niveaux de la façade est soutenue par douze modillons sculptés (certains refaits) figurant des têtes humaines, des têtes d´animaux, un lion à corps retourné, deux serpents entrelacés.
La baie du deuxième niveau est encadrée de chaque côté d´une colonnette monolithe à base moulurée. Le chapiteau gauche porte un décor végétal alors qu´un monstre anthropophage occupe l´angle de celui de droite.
| Type de dossier |
Dossier d'oeuvre architecture |
|---|---|
| Référence du dossier |
IA86007837 |
| Dossier réalisé par |
Dujardin Véronique
Chercheur, service Patrimoine et Inventaire Sarrazin Christine |
| Cadre d'étude |
|
| Aire d'étude |
Civray |
| Phase |
étudié |
| Date d'enquête |
2010 |
| Copyrights |
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel |
| Citer ce contenu |
Église paroissiale Saint-Gervais-et-Saint-Protais, Dossier réalisé par Dujardin Véronique, (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/6a8cd837-bcad-47ba-bcd3-5f90283091c0 |
| Titre courant |
Église paroissiale Saint-Gervais-et-Saint-Protais |
|---|---|
| Dénomination |
église paroissiale |
| Vocable |
saint Gervais saint Protais |
| Statut |
|
|---|---|
| Protection |
|
Localisation
Adresse: Nouvelle-Aquitaine , Vienne , Champagné-Saint-Hilaire
Milieu d'implantation: en village
Cadastre: 1812 I2 418, 2010 AB 68