Les phares : de l’ouvrage d’art au monument historique, un exemple de patrimonialisation
La signalisation maritime est l’une des dix thématiques étudiées dans le cadre de l’opération Littoral. Parmi les signaux les plus emblématiques, les phares constituent un héritage technique et historique majeur. Ils font partie intégrante des paysages littoraux et suscitent un fort attachement des populations.
Carnet du patrimoine
Publié le 19 mai 2025
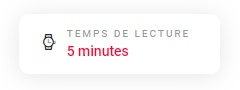
# Pyrénées-Atlantiques, Landes, Gironde, Charente-Maritime
# Opération d'inventaire : Communes littorales de Nouvelle-Aquitaine
# Phare
# 19e siècle, 20e siècle, 21e siècle
Au début de l’année 2025, plusieurs articles de la presse locale et nationale (1) relaient l’annonce du service des Phares et Balises, subdivision de La Rochelle, de déconstruire, dans un avenir proche, le phare de la Coubre (commune de La Tremblade). Le recul du trait de côte menace ce monument emblématique du littoral charentais, amenant l’État, propriétaire du site, à prendre cette décision.
Cette résolution suscite l’incompréhension et des pétitions sont lancées pour « sauvegarder ce patrimoine ». Ce mouvement de sauvegarde du phare de la Coubre est révélateur du processus de patrimonialisation que connaissent ces édifices au début du 21e siècle qui, d’objet « technique », sont devenus patrimoine.
Une politique volontariste de signalisation du littoral
Sur la pointe de la Coubre fragilisée par l’évolution du trait de côte, après l’édification de plusieurs feux sur des tours en bois au 18e siècle, trois phares se succèdent à partir de 1830 afin de signaler l’entrée dans l’estuaire de la Gironde. L’actuel phare est le dernier ; il est allumé en 1905. La Coubre n’est pas un exemple unique. Toujours dans l’estuaire de la Gironde, sur la pointe de Grave, deux tours sont détruites par l’érosion et l’océan avant la construction du phare actuel, allumé en 1860.
Ces phares relèvent d’une politique de signalisation du littoral français initiée par l’Etat au début du 19e siècle. La Commission des phares, créée en 1811, et le service des Phares, au sein des Ponts et Chaussées, en sont les principaux artisans. Entre 1825, année de la publication du premier rapport sur la signalisation des côtes (2) et la fin du 19e siècle, la « ceinture lumineuse » de la France est presque achevée. Elle permet de guider les bateaux de plus en plus grands, aux calaisons de plus en plus importantes.
Dans l’actuelle région Nouvelle Aquitaine, le pertuis d’Antioche, entre les îles de Ré et d’Oléron, et l’embouchure de la Charente sont balisés par quatre phares et huit fanaux signalent les ports des îles et de La Rochelle ; l’estuaire de la Gironde est éclairé dans les années 1860 par huit phares, trois feux flottants et des fanaux de ports ; la côte landaise et basque est éclairée par quatre phares.
Un rôle moindre
Essentiels à la navigation maritime pendant plus d’un siècle, les phares perdent progressivement de leur importance avec les radiophares (années 1920), les radars (années 1940) puis des systèmes de guidage par satellite. L’automatisation dans les années 1990 entérine la fin du métier de gardien de phare. Les grands phares n’ont plus qu’un rôle minime dans le guidage des bateaux et se pose la question de leur devenir.
Les phares et le patrimoine culturel maritime
Au cours des années 1990 se développe la notion de patrimoine culturel maritime. Elle recouvre différents domaines comme le patrimoine bâti, l’ethnologie, les bateaux…
Les phares, ouvrages d’art destinés à la navigation maritime, marqueurs du paysage littoral, sont rapidement pris en compte. Ils demeurent cependant des « objets techniques » car les feux fonctionnent.
Un protocole signé le 1er août 2000 entre le ministère de la Culture et le ministère de l’Équipement, auquel est rattaché le Bureau des phares et balises, permet d’engager une opération d’inventaire des phares achevée en 2002. 129 édifices sont étudiés, dont 13 pour la Nouvelle-Aquitaine. Les opérations d’inventaire de l’estuaire de la Gironde et de la vallée de la Charente ont permis d’enrichir le corpus.
De nombreux ouvrages viennent également renforcer la connaissance sur les différents domaines du patrimoine culturel maritime.
De nouveaux monuments historiques
Des phares « historiques » sont très tôt protégés au titre des monuments historiques comme Cordouan, plus ancien phare de France, classé en 1862 ou, en 1904, l’ancienne tour des Baleines (du 17e siècle) sur l’île de Ré.
A la fin des années 2000, au terme de l’inventaire, une politique de protection est mise en œuvre, amorçant un véritable phénomène de patrimonialisation des « sentinelles des mers ». En Nouvelle-Aquitaine, 13 phares sont inscrits en 2009 et 2011, rejoignant les phares de Chassiron (1970) et de Biarritz (1993).
Le bureau des phares et des balises émet parfois des réticences et demande à pouvoir intervenir librement sur ces édifices dont les feux fonctionnent toujours (3).
La valorisation des phares
Dès le 19e siècle, les ingénieurs des Ponts et Chaussées, en charge de la construction et de l’entretien des phares, font connaître ces phares à travers des publications scientifiques. Un musée des phares et balises est ouvert au sein du dépôt des phares du Trocadéro à l’occasion de l’Exposition universelle de 1878 ; il ferme dans les années 1950. Ses collections sont transférées en 1988 au nouveau musée des phares et balises aménagé au pied du phare de Créac’h de l’île d’Ouessant.
Écrivains et journalistes s’y intéressent aussi. Des articles, des nouvelles, des romans nourrissent tout un imaginaire autour du phare et de son gardien. Le Phare des Sanguinaires, d’Alphonse Daudet (1869), Le gardien du feu, d’Anatole Le Braz (1900 ), Le phare du bout du monde de Jules Verne (1905) sont parmi les plus célèbres.
A partir des années 2000, aux côtés des publications scientifiques, les ouvrages de vulgarisation se multiplient. Des expositions sensibilisent aussi à ce patrimoine. En 2012, le musée de la Marine à Paris consacre une grande exposition aux phares dont la fréquentation avoisine les 90 000 visiteurs.
Devenus monuments historiques, les phares s’ouvrent aux visiteurs ; ils sont au nombre de douze sur le littoral de Nouvelle-Aquitaine. L’ascension jusqu’à la lanterne, la visite de la maison du gardien parfois transformée en musée ou en boutiques où sont vendus de nombreux produits dérivés (cartes postales, affiches, maquettes…) sont des incontournables.
Sur la très touristique île de Ré, le phare des Baleines accueille 180 000 visiteurs en 2020 ; 70 000 personnes ont gravi les marches du phare de la Coubre en 2024 et 129 000 au Cap-Ferret. Cordouan, accessible uniquement en bateau d’avril à octobre, reçoit 23 000 personnes.
Ancrés dans l’imaginaire collectif, témoins d’une histoire maritime et technique, les phares sont désormais considérés comme des biens patrimoniaux. Mais, soumis aux intempéries, ils sont fragiles et leur entretien onéreux. Ainsi le phare de Cordouan a été l’objet d’une grande campagne de restauration entre 2019 et 2022. Le coût de la restauration s’élève à 9,5 millions d’euros, financé par l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine et les conseils départementaux de Charente-Maritime et Gironde (4).
- Christine Sarrazin, documentaliste au service du patrimoine et de l'Inventaire, Région Nouvelle-Aquitaine
Notes
(2) Rossel, Elisabeth-Paul-Edouard de. Rapport concernant l’exposition du système adopté par la Commission des phares pour éclairer les côtes de France. Paris : Imprimerie Royale, 1825. Gallica. Consulté le 7 mai 2025.
(3) Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer. Jean-Pierre-Thibault , Christina Dieudonné, Antoine Pichon, Jean-Michel Suche. Valorisation des phares et de maisons-feux. Affirmer une politique ambitieuse pour un patrimoine emblématique. Rapport CGEDD n° 010429-01, IGAM n° 2016-96. Juin 2016, p. 27-28. Consulté le 07 mai 2025.
(4) Cordouan : le roi des phares famblant neuf | Ministère de la Culture
Quelques éléments bibliographiques
Antoine Resche, Yann Werdefroy. Les phares de Nouvelle-Aquitaine. La Crèche : La Geste, 2022
Jean-Christope Fichou, Noël Le Hénaff, Xavier Mével. Phares. Histoire du balisage et de l’éclairage des côtes de France. Douarnenez : Chasse-Marée, 2016
Francis Dreyer, Jean-Christophe Fichou. L’histoire de tous les phares de France. Rennes : Editions Ouest-France, 2014.
Vincent Guigueno, Franck Guillaume (photographe). Au service des phares : la signalisation maritime en France : XIXe-XXe siècle. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2001


























