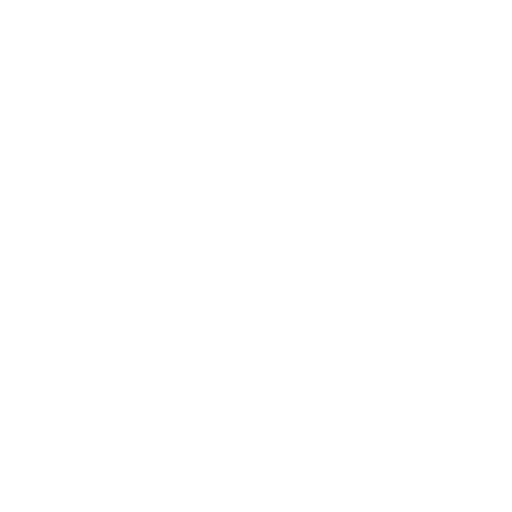Historique
L'abbaye du Pin aurait été fondée vers 1120 à l'instigation de Géraud de Sales, par Guillaume des Forges, chanoine de Saint-Hilaire de Poitiers, sur des terres offertes par Tition de Bares. Obéissant à la règle cistercienne à partir de 1141-1142, l'abbaye Notre-Dame du Pin est placée sous la tutelle de l'abbaye de Pontigny le 3 juillet 1163. A la fin du 12e siècle, elle connut une grande prospérité grâce à l'intervention de Richard Coeur de Lion, roi d'Angleterre et comte de Poitiers, qui nomma son cinquième abbé, Pierre Milon, et dota l'abbaye de biens fonciers au sud-est de l'Angleterre et du droit de minage (taxe sur la vente du blé) perçu à Poitiers dans un bâtiment rue du Moulin-à-Vent. Bénéficiant de nombreuses dotations, elle possédait, au 13e siècle, une grande partie du territoire de Béruges, un étang et un moulin. Du 12e siècle restent la partie inférieure des murs de la nef de l'église et une partie du mur nord de l'ancien moulin. L'abbaye connut une première vague de réparations au 15e siècle, suite à la Guerre de Cent Ans (surélévation des murs et reconstruction de la toiture de l'église).
Occupés par les troupes de Coligny, les bâtiments subirent un incendie au moment du siège de Poitiers en 1569. La voûte en berceau du sanctuaire s'effondra, seuls les quatre murs de la nef subsistèrent mais restèrent découverts pendant 80 ans durant lesquels les religieux faisaient l'office dans la salle du chapitre. Des réparations furent alors effectuées et le choeur fut séparé de la nef par un mur portant toujours l'inscription : ce pignon fut faict an l'an 1598. En 1600, la voûte du choeur s'effondra à son tour. L'abbaye abandonna la Commende pour redevenir abbaye régulière. En 1621 le choeur, de même longueur que la nef, est restauré et pourvu de trois autels. Puis tout au long du 17e siècle des travaux importants sont entrepris, c'est de cette époque que date le logis abbatial dont l'aile sud est établie en 1649 sur l'emplacement du choeur de l'église et qu'une sacristie y fut installée. La nef est alors recouverte d'un berceau de bois et en 1699 un retable est commandé au sculpteur poitevin Girouard. Sont également édifiés les vastes communs qui existent toujours et un cloître est construit (l'emplacement des supports est visible sur le mur nord de l'église et sur la façade ouest du logis). En 1714 le pont est réparé comme l'indique une date gravées sur son arche nord. Sur le pavillon d'entrée une inscription : 1736 fait par la main de Charles Boud[ile], indique la date de sa construction qui est peut-être également celle du portail, du côté de l'accès actuel à l'ouest. A partir de 1779, le logis est remanié par l'architecte Robert Penchaud. Sa façade orientale est percée de grandes fenêtres disposées en travées, la pièce située entre la cuisine et le couloir est divisée et l'étage est entièrement cloisonné. A la Révolution, l'abbaye est vendue comme bien national ainsi que toutes ses dépendances qui consistaient en 12 métairies, 8 borderies et de nombreuses terres. En 1792, l'abbé Guy de Cressac rachète la maison abbatiale. Sur la plan cadastral de 1830, en plus des bâtiments actuels, figure au centre une construction qui devait correspondre aux traces d'arrachement visibles à l'angle nord-ouest de l'église et devait soutenir la galerie ouest du cloître.
En 1945, la voûte de l'église s'effondre et sa toiture est abattue vers 1952 par mesure de sécurité.
Détail de l'historique
| Périodes |
Principale : 1ère moitié 12e siècle Principale : 15e siècle Principale : 17e siècle Principale : 18e siècle Secondaire : 16e siècle |
|---|---|
| Dates |
1598, porte la date 1714, daté par source 1736, daté par source |
| Remplois et déplacements |
Deplacement : oeuvre déplacée à Commune : 16,Magnac-Lavalette Deplacement : oeuvre déplacée à Département : Deux-Sèvres Commune : Thénezay |
| Auteurs |
Auteur :
Penchaud Robert, architecte (attribution par source) Auteur : Girouard Joseph, sculpteur (attribution par source) |
Description
L´abbaye du Pin est située à l´ouest du bourg de Béruges, en fond de vallée, dans une boucle de la Boivre et en bordure de celle-ci. Au nord et au nord-ouest un coteau abrupte et boisé la sépare de la route départementale 6 et, au sud, le terrain monte plus doucement vers la route rejoignant la route départementale3 et la Torchaise en bordure de laquelle sont encore visibles les vestiges d´un long mur clôturant la propriété. A l´ouest un pont à plusieurs arches sépare l´abbaye de l´ancien moulin et filature. De ce côté, l´accès à l´enclos se fait par un portail constitué de deux piliers à amortissement, derrière lequel se trouve un logement en rez-de-chaussée à haut toit à croupes couvert d´ardoise. Au nord, en bordure de la route D 6 où se trouvent un mur de clôture et un ancien logement de gardien en ruine, également couvert d´ardoise, est un ancien accès par un chemin en lacets descendant à flanc de coteau pour arriver à un pont franchissant la Boivre. Ce pont est constitué de trois arches dont l'une correspond au canal d'un moulin. Entre la falaise et la rivière se trouve une fontaine maçonnée abritée par une voûte en arc brisé au sud de laquelle sont trois bassins rectangulaires successifs, celui du milieu aux angles coupés, le plus proche de la rivière étant un lavoir. Sur l´autre rive, les bâtiments se regroupent autour de plusieurs cours. Celle qui est au débouché du pont est bordée à gauche par un bâtiment de communs abritant des fours et où se trouvait autrefois le moulin. Il est traversé par un passage couvert donnant accès à la grande cour nord-est. En vis à vis à l´ouest est un corps de dépendance et, entre les deux, face au pont, un passage couvert donne accès à une très vaste cour entourée sur trois côtés par d´anciennes écuries et autres communs, le quatrième étant aujourd´hui fermé par un mur. Dans l´aile sud de ces communs, face à celui qui est aménagé dans l´aile nord, un passage couvert donne accès à la cour d'entrée actuelle, également accessible par un portail à l'ouest, qui est bordée au sud par un bâtiment de dépendances allongé et bas. A l´est de la précédente cour, accessible par un passage aménagé dans les années 1940 dans l´aile sud des communs, s´étend la cour principale bordée au sud par le prolongement de l´aile des communs et à l´est par un grand corps de logis. Dans sa partie sud, accolée perpendiculairement au logis, se trouve l´église abbatiale. La partie nord de cette cour s´étend en contrebas jusqu´à la Boivre. Elle est séparée de la première cour par le bâtiment contenant les fours et autrefois le moulin, auquel est accolé un petit corps de bâtiment perpendiculaire, autrefois à usage de buanderie.
L´église abbatiale, construite en pierre de taille, est constituée d´une nef à trois travées dont le sol, en contrebas par rapport à la cour, présente par endroit un carrelage de terre cuite. Dans la première travée, à la base des murs se trouve une banquette en pierre. Actuellement il n´y a plus aucune charpente ni couverture. A l´ouest, où sont visibles les traces de l´ancien pignon avant sa surélévation, s´ouvrent un portail et une petite porte à droite, toutes deux couvertes d´un arc segmentaire. Plus haut est une haute fenêtre en arc brisé. Les travées sont séparées par des colonnes sur dosseret dont les chapiteaux restants sont sans sculpture, leur tailloir se prolongeant en un cordon à la base de l´ancienne voûte. Dans chacune de ces travées s´ouvre, au nord et au sud, une fenêtre en plein cintre (plusieurs d´entre elles ont été élargies). Dans la partie inférieure du mur nord, dans la travée médiane, s´ouvrent une porte et une niche dont le fond est ouvert dans sa partie supérieure. A l´est, un mur a été construit sous l´arc qui ouvrait autrefois sur le choeur et qui a fait place à une aile du logis. A l´extérieur, la façade est encadrée par deux gros contreforts corniers et se divise en deux registres séparés par une corniche en glacis. Le portail est couvert d´un arc brisé à deux rouleaux, dont les arêtes sont ornées d´un tore, et à archivolte retombant sur un tailloir se prolongeant sur toute la largeur du mur et sur des chapiteaux orné de feuilles. Au-dessus du portail, des corbeaux supportaient vraisemblablement un auvent ou un porche. Les murs latéraux sont renforcés par des contreforts plats et l´archivolte des fenêtres se prolonge pour former un cordon horizontal. Dans le mur nord, limité à gauche par un autre contrefort, en plus des baies vues à l´intérieur, est visible à gauche la partie supérieure d´un enfeu couvert d´un arc brisé orné d´un tore sous un arc plein cintre muré. Au-dessous du niveau des fenêtres sont les traces d'arrachement des supports et du solin de la galerie de cloître du 17e siècle. Le mur sud est limité à droite par une ancienne tour d´escalier carrée dont la face sud porte des traces de reprise de maçonnerie qui peuvent correspondre au départ du mur d´un ancien transept détruit.
Le logis abbatial est un long bâtiment rectangulaire à corps central entre deux ailes en saillie sur la façade orientale. L´ensemble est construit en moellons irréguliers et les couvertures sont en ardoise. Celle de l´aile nord a disparu et celle de l´aile sud est pourvue de croupes. Ce bâtiment est constitué d´un sous-sol, un rez-de-chaussée, un étage et un comble. La façade ouest sur la cour présente des travées irrégulières et conserve des baies en plein-cintre (du 17e siècle) à clef saillante et pour certaines murées. Des traces des supports du cloître disparu sont visibles dans le mur. L´élévation postérieure est beaucoup plus régulière, avec treize travées, la porte au centre et quatre lucarnes dans le comble. Les ailes latérales ont chacune trois travées de fenêtres dont le linteau est surmonté d´un arc de décharge en brique. Dans l´aile sud, légèrement plus haute que le corps de bâtiment principal, s´ajoutent deux lucarnes passantes. L´aile nord, à l´abandon, a perdu sa couverture et dans sa façade sur la Boivre sont des ouvertures percées de manière très irrégulière tandis que l'élévation sud de l´aile sud présente quatre travées, les trois de gauche étant surmontées d´un oculus.
A l´intérieur, la partie centrale est simple en profondeur tandis que les ailes sont divisées par un mur de refend longitudinal. Sous la partie centrale, accessible par un escalier en pierre au nord et par une porte dans la façade ouest, le sous-sol est divisé en cinq caves en enfilade couvertes de voûtes en berceau. La première au nord, sous la cuisine, a un pilier carré en son centre pour soutenir la voûte. La troisième, très vaste, a son mur ouest renforcé par des contreforts. Sous la partie est de l´aile sud se trouve une salle voûtée, réutilisée comme chapelle, accessible par l´escalier principal au bas duquel se trouve un massif de maçonnerie appareillé qui pourrait être un vestige de l´ancien chœur, à droite duquel la porte d´accès à la salle est couverte par une dalle funéraire en remploi. Au rez-de-chaussée du corps principal sont, du nord au sud : en contrebas, une pièce voûtée transversale sans fenêtre ouvrant à l´ouest sur la cour et à l´est sur un escalier en pierre rampe sur rampe ; la cuisine à voûte d´arêtes soutenue par un pilier carré ; une pièce étroite ; une pièce avec une cheminée en marbre et des lambris sculptés ; un couloir médian transversal à sol dallé, avec porte donnant sur l'extérieur à l´ouest et à l´est ; une salle divisée par des cloisons ; une autre salle couverte d´une voûte d´ogives (seule la retombée sud-est conserve son chapiteau), avec cheminée lambrissée, lambris d´appui et une porte murée couverte d´un arc déprimé à l´ouest ; la cage de l´escalier principal en pierre, dont le sol est dallé d´ardoise, qui ouvre par une porte sur la cour ouest et par un très haut arc en plein cintre sur chacune des volées, rampe sur rampe, et sur l´aile sud. Dans cette aile sud, la partie ouest, qui a servi un temps de sacristie, est divisée en deux par un mur au nord duquel est un large couloir avec quelques marches. Dans son angle nord-ouest est visible la base de l´arc muré de la nef de l´église, dans lequel est engagé un petit bénitier en pierre. Dans le mur nord se trouve un lavabo en pierre à niche concave bordée d´une moulure et en face, au sud un large oculus également à encadrement mouluré. La partie est de cette aile sud est divisée par une cloison en deux pièces chacune avec une cheminée. Dans le mur ouest de la pièce sud-est est un grand arc en plein-cintre muré. A l´étage, le corps de bâtiment principal est cloisonné et un couloir longe la façade ouest, desservant les chambres. Au sud, la cage de l´escalier principal communique avec l´aile par un grand arc semblable à celui du rez-de-chaussée. L´espace intérieur de l´aile sud a été réaménagé. L´escalier conduit jusqu´au comble, séparé de la cage par une cloison en pan de bois.
Les communs sont constitués de trois très vastes corps de bâtiments accolés en U traversés par deux passages couverts en vis à vis, pourvus de chasse-roues coniques surmontés d'une boule en pierre. Le passage de la partie est de l'aile sud a été aménagé au 20e siècle derrière une porte charretière en plein cintre existante. La majeure partie des ouvertures de ces communs sont pratiquées côté cour, sur deux niveaux. Les portes charretières et piétonnes sont couvertes en plein-cintre et les fenêtres (ou anciennes fenêtres) sont rectangulaires. A l'intérieur sont d'anciennes pièces d'habitation, des écuries et diverses dépendances. Des escaliers en pierre sont conservés.
Détail de la description
| Murs |
|
|---|---|
| Toits |
|
| Étages |
sous-sol, 1 étage carré |
| Couvrements |
|
| Couvertures |
|
| Escaliers |
|
| Décors/Technique |
|
| Décors/Représentation |
Précision sur la représentation : Chapiteaux de la porte de l'église à larges feuilles et crochets. Dalle funéraire ornée d'un personnage gravé et pierres à décor de pointes de diamant en remploi. Dans la salle sud du logis, chapiteau à feuilles ; dans la salle nord, lambris ornés de volutes, coquilles et feuilles ; cheminées lambrissées à panneaux ; porte à panneaux dans la cage d'escalier. Aile sud : lavabo à niche garnie d'une coquille, chambre sud-est avec cheminée à décor végétal, de rubans et d'instruments de musique. Portail ouest à pilastres et amortissements en forme de pomme de pin. |
Informations complémentaires
| Type de dossier |
Dossier d'oeuvre architecture |
|---|---|
| Référence du dossier |
IA86004089 |
| Dossier réalisé par |
Martel Céline
Renaud Geneviève |
| Cadre d'étude |
|
| Aire d'étude |
Communauté d'Agglomération de Poitiers |
| Phase |
étudié |
| Date d'enquête |
2006 |
| Copyrights |
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers |
| Citer ce contenu |
Abbaye Notre-Dame, Dossier réalisé par Martel Céline, (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/1599a1bc-8ef0-41c6-8d1c-46965dbed696 |
| Titre courant |
Abbaye Notre-Dame |
|---|---|
| Dénomination |
abbaye |
| Vocable |
Notre-Dame |
| Parties constituantes non étudiées |
jardin cour pont portail communs logement four moulin buanderie écurie fontaine lavoir |
| Statut |
|
|---|---|
| Protection |
|
| Intérêt |
|
Localisation
Adresse: Nouvelle-Aquitaine , Vienne , Béruges
Milieu d'implantation: en écart
Lieu-dit/quartier: le Pin