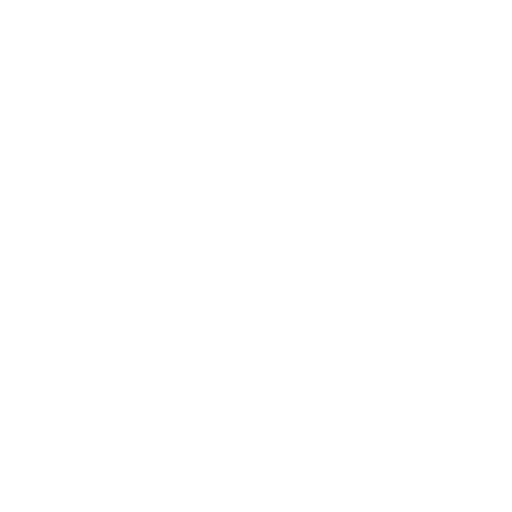0 avis
Historique
Le prieuré Saint-Pierre de Jarnac est mentionné dès le 8e siècle comme appartenant à l´abbaye Saint-Cybard d´Angoulême. Les partie des murs du clocher et des trois premières travées de la nef, construits en petit appareil, pourraient dater de la fin du 10e siècle ou du début du 11e siècle. La façade détruite devait aussi dater de cette période. La quatrième travée de la nef, la première surélévation du clocher et la coupole du clocher datent du 12e siècle.
La crypte et le chœur semblent dater du 13e siècle et la chapelle nord du 14e siècle.
Incendiée en 1562 par les protestants, qui en abattent les voûtes, l´église est restaurée à partir de 1601.
La nef est voûtée en briques en 1847, 1849 ; l´architecte Alphonse Deménieux restaure le chœur et en rétablit la grande fenêtre en 1860, 1862. Édouard Warin bâtit la chapelle sud et la sacristie en 1874, 1875. La façade, entièrement reconstruite par L. Martin, est bénie le 25 juin 1899.
Détail de l'historique
| Périodes |
Principale : 4e quart 10e siècle (incertitude) Principale : 12e siècle Principale : 13e siècle Principale : 14e siècle (incertitude) Principale : 1er quart 17e siècle Principale : 2e quart 19e siècle Principale : 2e moitié 19e siècle |
|---|---|
| Auteurs |
Auteur :
Warin Édouard, architecte Auteur : Deménieux Alphonse, architecte Auteur : Martin Louis, architecte |
Description
L´église prieurale Saint-Pierre se trouve dans le bourg de Jarnac, dans l´ancien diocèse de Saintes. Sous un bâtiment au sud-ouest de l´église est conservée une salle voûtée qui aurait fait partie du prieuré. De l´époque romane ne subsistent que la partie des murs du clocher et des trois premières travées de la nef construites en petits moellons cubiques et la coupole dans le clocher.
L´église se compose d'une nef de quatre travées, d'un chœur, d'une crypte à laquelle on accède par des escaliers droits et de chapelles adossées au nord et au sud. Les murs des trois premières travées et du clocher sont construits en petit appareil composé de moellons cubiques, les autres murs sont en pierre de taille. Les trois premières travées de la nef sont couvertes de voûtes d´arêtes en briques, la quatrième travée de la nef, le chœur, les chapelles nord et sud et la crypte sont couverts de voûtes d´ogives.
Pour Crozet, l´église primitive de Jarnac appartient aussi à la série des églises à nefs simples de largeur moyenne, environ 9 mètres. Dans le mur sud est esquissé l´emploi de l´opus spicatum. Dès l´origine, à la fin du 10e ou au début du 11e siècle, le clocher est positionné du côté nord et non dans l´alignement de la nef, celle-ci étant trop large avec des murs trop minces qui n´étaient pas destinés à recevoir une voûte. La tour carrée du clocher est percée de fenêtres à petits claveaux cunéiformes très ébrasés au dedans et, autre signe d´archaïsme, de deux petits oculi dont l´un au moins est appareillé de même. Cette tour a été surélevée dès l´époque romane et à nouveau plus tard. Lors de sa construction, cette tour n´était pas voûtée. Une coupole sur pendentifs a été élevée dès le 12e siècle sur quatre piliers massifs placés dans les angles du clocher.
La façade est percée d´une porte entre deux arcades et se compose, au premier étage, de cinq arcades (avec une fenêtre dans celle du milieu), au second étage, de sept arcades sous le pignon.
Sur une gravure ancienne, la façade est flanquée de deux contreforts plats qui montent à mi-hauteur de l´élévation. Au centre, le portail, représenté avec une voussure de quatre rouleaux apparemment sans décor, est encadré de deux contreforts plats plus étroits et un peu plus hauts que les contreforts latéraux. Il est surmontée d´une haute fenêtre relativement étroite. Le pignon triangulaire, à faible pente, est découvert.
On accède à la crypte par deux escaliers droits, l´un au nord et l´autre au sud. De plan carré, la crypte est partagée en quatre parties égales très larges, couvertes chacune d´une voûte d´ogives à nervures toriques. Au centre des quatre travées, un pilier central cruciforme sur base carrée reçoit les retombées des nervures. Les faces du pilier sont renforcées d´une colonne engagée et les angles, d´une colonne plus petite. En face, sur le milieu des murs, des colonnes sur dosseret accostées de deux colonnes plus petites reçoivent les arcs doubleaux partant du pilier central. Les bases des colonnes sont ornées de griffes, et les chapiteaux, de crochets saillants. Quatre « statues-colonnes » en calcaire, avec quelques vestiges de polychromie, de 83 à 95 cm de haut, reçoivent les retombées des ogives et des formerets dans chacun des angles de la crypte. Les tailloirs sont garnis de feuilles et les socles sont variés (cul-de-lampe, demi-colonne). Chaque œuvre est taillée dans un seul bloc de pierre. Elles semblent dater du 13e siècle, comme la crypte, et sont assez abîmées : mains, visages et/ou jambes cassés, nombreuses épaufrures, présence de calcin et de moisissures.
Au nord-ouest se trouve un atlante aux bras levés et aux jambes pliées sous lui, doté d´une chevelure courte et bouclée ; il est vêtu d´une robe blousant sur la poitrine et serrée à la taille par une ceinture (peut-être nouée par devant). La statue nord-est est un ange debout, les deux bras ramenés par devant, les ailes repliées en arrière de part et d´autre de la tête, surmontée d´une épaisse auréole ; il est vêtu d´une robe longue plissée par devant. Un homme se tient debout au sud-est. Il semble tenir un objet à la main gauche et porte une robe longue à col rond, plissée dans le bas et également aux manches, au-dessus des coudes. La statue sud-ouest est un homme debout, légèrement penché en avant ; il est pourvu d´un long cou et d´une tête à la chevelure courte bouclée ; il porte une robe mi-longue, au plissé large, qui laisse apparaître ses pieds et ses mollets.
Sur les murs sud et est de la travée sud-est de la crypte subsistent quelques vestiges de peintures murales (vraisemblablement des fresques) religieuses qui pourraient dater du 13e ou du 14e siècle. Il ne s´agit probablement que d´une petite partie d´un ensemble qui devait garnir les quatre murs de la crypte. À l´origine, la partie inférieure des murs, sur environ 2 m de haut, devait être garnie d´un semis de fleurs ocre rouge à cinq pétales vraisemblablement exécutées à l´aide d´un pochoir. Au-dessus d´une bande ocre rouge, ocre jaune et noire de 10 cm environ devaient être peintes des figures de saints et saintes à raison de deux par travée : une à gauche et une à droite du soupirail qui est percé au centre du mur. D´autres figures étaient peintes, sur les ébrasements des soupiraux. De ce décor ne subsistent plus que d´infimes vestiges sur la partie gauche du mur sud et sur le mur est de la travée sud-est.
La partie gauche du mur sud est la partie la mieux conservée, celle qui a été déjà décrite par Augier et Millet en 1875. Depuis le sol jusqu´à environ 1,95 m à 1,98 m, on reconnaît une quinzaine de ces fleurs ocre rouge à cinq pétales qui, à l´origine, devaient entièrement garnir la partie inférieure des murs. Au-dessus, sur 1,16 m de long et 9 cm de large environ, se développe une bande ocre rouge en bas et ocre jaune en haut que délimite en haut un trait noir. Au-dessus, en particulier à gauche et juste devant le personnage, se distingue un nouveau semis de fleurs (une douzaine sont bien visibles). Au centre, un évêque mitré et crossé se tient tourné vers la droite, tendant en avant sa main droite au-dessus d´un baquet rectangulaire d´où émergent les trois clercs : il s´agit, bien évidemment, de saint Nicolas ressuscitant les trois clercs du saloir. Le saint porte une robe ocre rouge aux contours noirs pourvue au col et au poignet d´un orfroi ocre jaune résillé de noir. Il est coiffé d´une mitre blanche ornée de deux bandes ocre jaune perpendiculaires l´une par rapport à l´autre. Sa crosse ocre jaune surmonte un long bâton ocre rouge. Sa barbe et ses cheveux sont ocre jaune, sa bouche, son nez et ses sourcils, ocre rouge. Le nimbe placé derrière sa tête est fait de ces deux mêmes couleurs. Du baquet, dont les planches ocre jaune sont cernées d´ocre rouge, émergent les corps nus, cernés de noir, des trois clercs. On ne distingue plus guère que les cuisses, le bas ventre, les bras et les mains jointes de celui de gauche, la tête aux cheveux courts ocre jaune de celui du centre et les mains jointes de celui de droite (qui a peut-être été coupé par l´ouverture du soupirail, postérieure à la réalisation du décor peint).
Sur la partie droite du mur est, entre 1,25 m et 1,50 m au-dessus du sol, se devinent encore les vestiges d´un décor végétal ocre rouge. Puis, entre 1,72 m et 1,88 m se développent un filet ocre rouge puis un bandeau ocre jaune et ocre rouge surmonté d´un filet noir. Au-dessus se distinguent un semis de fleurs ocre rouge à cinq pétales et une figure debout, tournée, semble-t-il, vers la gauche et tenant un livre à la main. Ce saint ou cette sainte porte une robe à manche noire et un manteau ocre jaune à plissé ocre rouge et contours noirs. Le livre est ocre rouge avec une tranche ocre jaune.
Dans la partie basse sur la gauche du mur oriental se devinent les restes d´un semis fleurs à cinq pétales et des filets ocre rouge imitant de faux joints. Entre 1,83 m et 1,91 m court un bandeau ocre jaune et ocre rouge surmonté d´un liseré noir. Au-dessus, sur un semis de fleurs rouges, on croit reconnaître sainte Marguerite agenouillée dans sa prison, tournée vers la droite, brandissant une croix, et le dragon couché sous ses pieds. De celui-ci, on voit encore, à droite, l´extrémité enroulée sur elle-même de la queue, à gauche, l´avant train, l´un et l´autre ocre jaune cerné d´ocre rouge, et au-dessus, la gueule, dont on distingue bien les dents et un œil. La sainte, en robe à manche noire, porte par dessus une tunique ocre jaune au plissé ocre rouge et tient devant elle une croix légèrement pattée. Elle est agenouillée sur les trois assises d´une maçonnerie rose qui doit probablement symboliser sa prison.
Dans l´embrasure gauche du soupirail est, au-dessus d´un semis de fleurs, on ne distingue plus, d´un personnage debout, que les contours ocre rouge d´une partie de son vêtement et une main tenant une coupe.
À une époque inconnue, le caveau des seigneurs de Jarnac a été élevé contre le mur occidental de la crypte.
Détail de la description
| Murs |
|
|---|---|
| Toits |
|
| Plans |
plan allongé |
| Étages |
1 vaisseau |
| Couvrements |
|
| Couvertures |
|
| Escaliers |
|
| État de conservation |
|
| Décors/Technique |
|
| Décors/Représentation |
Précision sur la représentation : Sujet : ornement animal ; support : chapiteaux des arcatures de la 4e travée de la nef ; sujet : ornement végétal ; support : chapiteaux de la nef, du clocher, du choeur, des chapelles et de la crypte. |
Informations complémentaires
| Type de dossier |
Dossier d'oeuvre architecture |
|---|---|
| Référence du dossier |
IA00049619 |
| Dossier réalisé par |
Riou Yves-Jean
Dujardin Véronique Chercheur, service Patrimoine et Inventaire Sarrazin Christine |
| Cadre d'étude |
|
| Aire d'étude |
Pays Ouest-Charente - pays du Cognac |
| Phase |
étudié |
| Date d'enquête |
1985 |
| Copyrights |
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel |
| Citer ce contenu |
Prieuré, aujourd'hui église Saint-Pierre, Dossier réalisé par Riou Yves-Jean, (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/57f46920-fb86-4c20-bacb-2783f9e45fb7 |
| Titre courant |
Prieuré, aujourd'hui église Saint-Pierre |
|---|---|
| Dénomination |
prieuré |
| Genre du destinataire |
de bénédictins |
| Vocable |
saint Pierre |
| Destination |
église paroissiale |
| Parties constituantes non étudiées |
crypte église |
| Statut |
|
|---|---|
| Protection |
|
Localisation
Adresse: Nouvelle-Aquitaine , Charente , Jarnac , place de l' Eglise
Milieu d'implantation: en ville
Cadastre: 1829 C2 1063, 2011 AS 724