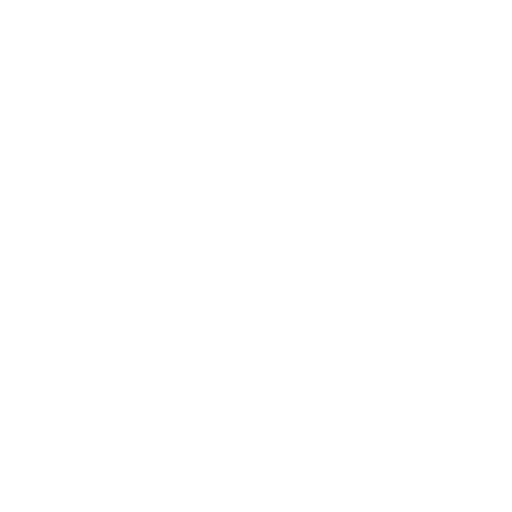0 avis
Prieuré de bénédictins Saint-Léger (prieuré-cure), aujourd'hui église
Historique
Le prieuré Saint-Léger est fondé en 1016 par Arnaud de Villebois ou de Vitabre, sacré six ans plus tôt évêque de Périgueux, et ses neveux Itier et Arnaud, premiers seigneurs connus de Cognac. Le prieuré et l´église paroissiale sont donnés à l'abbaye d'Ebreuil. L´église en bois fondée par Arnaud est reconstruite en pierre dans la seconde moitié du 12e siècle, avec une nef à un vaisseau couvert d´une file de coupoles. Le voûtement d´origine, le transept et le chœur sont repris au 13e siècle. Au 14e siècle, le chœur est pourvu de collatéraux auxquels des chapelles sont ajoutées au 15e siècle. Le cloître est également construit au 15e siècle. Abandonné par les bénédictins, le couvent fut occupé à partir de 1623 par des bénédictines.
D´importantes restaurations de l'église sont réalisées entre 1845 et 1865 : Paul Abadie reprend notamment la nef et la façade de manière radicale. Le décor de style gothique flamboyant du chœur a été exécuté à partir de 1846 à la demande de l´abbé Berchon, curé de Saint-Léger. Le grand orgue a été installé en 1861 : l´instrument est du facteur parisien Henri Thébaud et le buffet de « Boccière et ses neveux, au Mans ».
Description
Située dans le bourg de Cognac, l´église Saint-Léger était un prieuré dépendant de l´abbaye d´Ebreuil, aujourd'hui dans le département de l´Allier.
D´ouest en est, elle se compose pour l´époque romane d´une nef de deux travées qui étaient à l´origine couvertes de coupoles et d´une partie du transept, ainsi que de la tour d´accès à l´escalier, adossée au nord de la deuxième travée de la nef.
La façade occidentale se compose de deux niveaux et d´un pignon triangulaire, partagée verticalement en trois par des contreforts-colonnes. Au premier niveau, le portail central est encadré d´arcatures aveugles (pour le décor, voir ci-dessous). Ce premier niveau a peu souffert des restaurations du 19e siècle, mais la sculpture est très endommagée, probablement depuis les guerres de Religion.
Au second niveau, une rose a été percée au 15e siècle au milieu d´arcatures disposées sur deux registres, comme on peut encore le voir au nord et au sud. Abadie souhaitait restituer à la place de la rose un triplet surmonté de six arcatures ; la rose a finalement été conservée. D´après un dessin de Sadoux, avant les restaurations de la fin du 19e siècle, le fronton était flanqué de deux petits clochetons.
Dans son état actuel, l´église mesure 56 m de long pour une largeur de 12,8 m au niveau de la nef.
La nef se compose de deux travées sur un vaisseau unique. Elles étaient couvertes à l´origine d´une file de coupoles qui ont été remplacées au 13e siècle par des voûtes d´ogives.
L´ancien transept a été inclus dans les collatéraux construits au 14e siècle. L´ancien chœur était légèrement plus étroit que la nef. Le chœur actuel, à chevet plat, est composé de trois travées dans la nef centrale et quatre pour les collatéraux.
Dès l´origine, le clocher a été positionné dans l´angle rentrant formé par la nef et le transept nord. Il est désormais inclus dans le collatéral ajouté au 14e siècle. Un faisceau de colonnes supporte la coupole dans chaque angle.
L´ensemble du mobilier est postérieur à 1623.
Le cloître et les bâtiments conventuels étaient installés au sud de l´église prieurale. Très endommagés par les guerres de religion, ils sont complètement reconstruits à partir de 1623. Le couvent prend alors le nom de Notre-Dame-de-Grâce. Il abrite aujourd'hui la bibliothèque municipale.
Le décor roman est conservé sur le premier niveau de la façade. Le tympan de l'arcature nord porte une scène très érodée généralement interprétée comme l'Adoration des mages. Sur le tympan de l'arcature sud sont représentées les saintes femmes au tombeau.
Les chapiteaux du piédroit gauche du portail central portent, de l´extérieur vers l´intérieur, le Christ en gloire porté par deux anges, le sacrifice d'Abraham, des oiseaux qui attaquent un quadrupède et des entrelacs avec des animaux et un personnage. Les chapiteaux du piédroit droit portent, du centre vers l´extérieur, des entrelacs avec un oiseau et des quadrupèdes, la pesée des âmes, des oiseaux qui attaquent un quadrupède et une scène qui associent des personnages et des animaux. Tous les tailloirs sont ornés de motifs végétaux.
La voussure du portail est constituée de quatre rouleaux. Les trois premiers rouleaux portent des motifs géométriques et végétaux ; le quatrième, à l´extérieur, est orné du zodiaque et des travaux des mois, soit de gauche à droite : un personnage assis représenté de profil, Verseau, un personnage assis représenté de face, Poissons, un homme taille un arbre, Bélier, scène illisible, Taureau, scène illisible, Gémeaux (endommagés), un homme moissonne, Cancer, feuille (parfois interprétée comme une coquille Saint-Jacques), Lion (très endommagé), un homme barbu accroupi, Vierge, un personnage bat le blé avec un fléau, Balance, un personnage foule le raisin dans un baquet (vendange), Scorpion, un homme abat des glands, Sagittaire, un personnage donne à manger à un animal (la mangeoire est surtout lisible), Capricorne, personnage attablé (endommagé).
Sur le mur nord de la nef, un relief porte des lions et des oiseaux sculptés surmontés par des entrelacs. Ce relief, inachevé du côté droit, montre la technique de sculpture précédée d´une gravure profonde.
Détail de la description
| Murs |
|
|---|---|
| Toits |
|
| Plans |
plan en croix latine |
| Étages |
1 vaisseau |
| Couvrements |
|
| Couvertures |
|
| Décors/Technique |
|
| Décors/Représentation |
Précision sur la représentation : Façade occidentale, premier niveau roman : - sur le tympan de l'arcature nord : l'Adoration des mages ; - sur le portail central : les trois premiers rouleaux comportent des motifs géométriques et végétaux ; le quatrième, à l´extérieur, est orné du zodiaque et des travaux des mois ; - Les chapiteaux du portail sont ornés principalement de motifs végétaux et animaux. À noter cependant, du côté nord, le sacrifice d'Abraham, le Christ en mandorle encadré de deux anges, des oiseaux attaquant des personnages. - sur le tympan de l'arcature sud : les Saintes Femmes au tombeau Ensemble de dix chapiteaux romans dans la nef : entrelacs, feuillages, représentations d'animaux (poisson, lionne). |
Informations complémentaires
| Type de dossier |
Dossier d'oeuvre architecture |
|---|---|
| Référence du dossier |
IA00052883 |
| Dossier réalisé par |
Riou Yves-Jean
Dujardin Véronique Chercheur, service Patrimoine et Inventaire Sarrazin Christine |
| Cadre d'étude |
|
| Aire d'étude |
Pays Ouest-Charente - pays du Cognac |
| Phase |
étudié |
| Date d'enquête |
1988 |
| Copyrights |
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel |
| Citer ce contenu |
Prieuré de bénédictins Saint-Léger (prieuré-cure), aujourd'hui église, Dossier réalisé par Riou Yves-Jean, (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/a3397bbb-34e6-4bce-bd6c-4cd847e60cb7 |
| Titre courant |
Prieuré de bénédictins Saint-Léger (prieuré-cure), aujourd'hui église |
|---|---|
| Dénomination |
prieuré |
| Genre du destinataire |
de bénédictins |
| Vocable |
saint Léger |
| Destination |
église |
| Parties constituantes non étudiées |
cloître bâtiment conventuel |
| Statut |
|
|---|---|
| Protection |
|
Localisation
Adresse: Nouvelle-Aquitaine , Charente , Cognac , 10 rue du Minage
Milieu d'implantation: en ville
Cadastre: 1823 B 356, 357, 1975 AW 591, 2011 AW 584 (église), 1020, 1021 (bâtiments du prieuré et cloître)