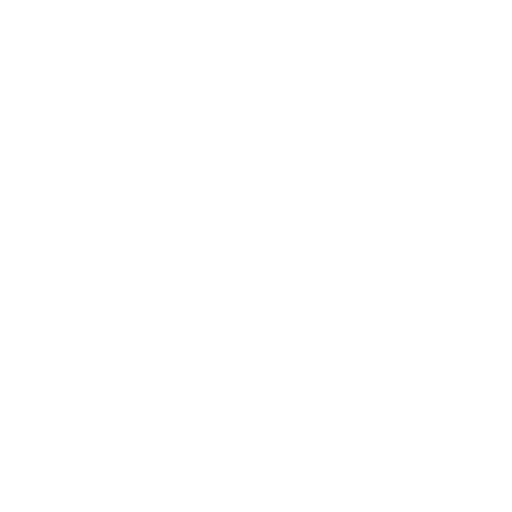0 avis
Les Portes-en-Ré : présentation de la commune
France > Nouvelle-Aquitaine > Charente-Maritime > Les Portes-en-Ré
Historique
La commune des Portes révèle de nombreuses traces d'habitat préhistorique, en particulier à la pointe du Lizay, occupée entre le 9e et le 6e siècle avant notre ère. Il semble, cependant, que ce territoire est par la suite délaissé. La naissance du bourg actuel ne parait dater que du Moyen Age. On peut supposer qu'il a été mis en valeur par des colons envoyés du bas Poitou par l'abbé de Saint-Michel-en-l'Herm, seigneur des îles d'Ars et de Loix depuis le début du 13e siècle, qui possédait aux Portes une recette seigneuriale située aux environs du quartier appelé "Derrière l'Abbaye", au village de La Rivière.
Prospérité du village du 15e siècle au 17e siècle
Il semble que ce soit aux Portes qu’aient été exploitées les premières salines. Ces marais, appartenant au prieuré d’Ars, sont aménagés entre 1375 et 1493. Des levées sont édifiées afin de protéger ces salines, ce qui profite aussi au village dont la population croissante entraine à partir du 15e siècle les premiers travaux de développement. Pour subvenir à leurs besoins en nourriture, les habitants établissent des écluses à poissons. Certaines restent encore visibles le long du rivage. Ils aménagent également des puits qui seront régulièrement entretenus jusqu’à l’arrivée de l’eau courante en 1965. Les maisons s’élèvent autour de l’église. Les enclos et les chais sont édifiés en pierre sèche d’après une technique ancestrale.Toutefois, le peuplement a dû se faire lentement puisque ce n'est qu'en 1548 que la terre des Portes, qui dépendait auparavant du prieuré Saint-Etienne d'Ars, est érigée en paroisse par l'évêque de Saintes, Charles de Bourbon. Le village connait alors une période de prospérité. Dès la fin du 15e siècle, des moulins commencent à s’élever sur le territoire communal. Plusieurs moulins vont s’établir sur la commune entre le 15e et le 19e siècle. Aujourd’hui, trois de ces édifices (Moulin de la Garenne, Moulin du Petit Marchais, dit de la Purée et Lanzin, et Moulin du Gros Jonc, dit de la Grande famille) ont été conservés, seules les dépendances des moulins du Roc et de Villeneuve ont été entretenues.En 1625, les troupes anglaises commandées par le duc de Buckingham débarquent sur la plage du Gros-Jonc. En 1627, la paroisse est pillée.Au 17e siècle, l’économie de la paroisse était fondée sur la récolte de sel dont les marais appartenaient tous à des non-résidents, à l'exception de trois familles de négociants, propriétaires des principaux logis de la paroisse : les Néraud, les Brizard et surtout les Masseau. Parmi les autres activités de la commune, on trouve la culture de la vigne destinée à la consommation locale et la meunerie.
Déclin de la commune à partir du 19e siècle
La commune des Portes est érigée en 1790. Le 5 décembre 1792, un arbre de la Liberté est planté sur la place de l'église, à l'emplacement de l'arbre de la féodalité appelé le "Poteau". Au cours du 19e siècle, l'économie de la commune et sa population déclinent. En 1835, après l'épidémie de choléra qui décime la population, le cimetière jusqu'alors situé au nord-ouest de l'église, est transféré à l'écart du bourg, au nord du village.Au milieu du 19e siècle, de nombreuses prises sont endiguées et les chenaux s’ensablent progressivement. Le chargement de sel doit se faire plus près du Fier d’Ars. Une grande Jetée est aménagée avec les matériaux de délestage des bateaux entassés depuis des siècles en plusieurs endroits. Il n’est pas certain qu’elle ait été achevée.
A la fin du 19e siècle, un canon porte-amarre est installé sur la côte, à la jonction des plages du Lizay et de la Saucière. Il permettait de porter secours aux naufragés proches des récifs. Les canons
A la fin du 19e siècle, un canon porte-amarre est installé sur la côte, à la jonction des plages du Lizay et de la Saucière. Il permettait de porter secours aux naufragés proches des récifs. Les canons porte-amarre, étaient souvent réalisés à partir d'un canon Perrier réformé, monté sur affût ou sur fourche. Ces canons pouvaient lancer leur flèche de fer Delvigne (du nom de l’inventeur) à 225 m environ, selon la force et la direction du vent. Ils étaient attribués aux postes de douane du littoral. Le canon porte-amarre des Portes est abandonné après la Première Guerre mondiale. Il ne reste que des vestiges de la petite construction en pierres qui l'abritait. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande investit dès 1940 d'anciennes batteries côtières établies par l'armée française au 19e siècle. Aux Portes, les soldats occupent l'ancienne redoute et y aménagent, par la suite (1943), une batterie de côte, nommée LOLA. A partir de 1942, ils renforcent la défense de l'île : dans la commune, ils construisent le long de la côte ouest une seconde batterie de côte, appelée KITTY, et des points d'appui défensifs, sous le nom de KUNI (pointe du Lizay) et LILY (pointe de Troussechemise).
Le 15 juin 1979, la commune des Portes change de nom et devient Les Portes-en-Ré.
Description
D'une superficie de 8,56 km2, limité à l'ouest par la commune de Saint-Clément-des-Baleines, la commune des Portes occupe l'extrémité nord-ouest de l'île. Son territoire est constitué de deux langues de terre sablonneuse, disposées à angle droit et reliées par l'isthme de la redoute, en bordure desquelles s'étendent des marais salants autour du Fier d'Ars. Du côté de la mer, la côte est formée d'un plateau rocheux au nord et d'une vaste grève sablonneuse, propice aux débarquements, à l'est.
La population est rassemblée essentiellement autour du bourg qui est situé dans la partie septentrionale de la commune dont le front nord est protégé par les digues du Marchais, du Gros-Jonc et de La Prise. Les maisons les plus anciennes sont situées dans la rue de la Cure, face à l'église. Le village est traversé par d'anciens écours, aujourd'hui enterrés.
A l'ouest du village s'étend la forêt domaniale du Lizay à la lisière de laquelle se trouve le hameau de La Rivière. Un ancien chemin, reliant le hameau à la côte, a conservé son appareillage en pierres debout.
La partie méridionale de la commune présente un aspect très différent. Il se compose de marais et du site classé du bois de Trousse-Chemise où ont été édifiées entre 1970 et 2000 de nombreuses résidences secondaires. D’anciens domaines ont été conservés : la Ferme du Fier et la demeure du Roc. La Patache, à l'extrémité du bois de Trousse-Chemise, est l'ancien lieu d'accostage d'un bac qui assurait autrefois la liaison avec la presqu'île de Loix pour les fermiers généraux chargés de surveiller le trafic du sel dans le fier. Une ancienne ferme y a été construite ; le bâtiment a été converti en buvette et dancing après-guerre.
L'économie a longtemps reposé sur l'agriculture, l'élevage bovin et ovin. L’exploitation des marais salants a largement décliné. En revanche, le tourisme y connait un large essor depuis les années 1970. En 1968, on comptait 375 résidences secondaires (soit environ 70%) pour 161 résidences principales. En 2016, on recense 1 640 résidences secondaires (soit environ 82,5%) pour 321 résidences principales. Les lieux de baignade sont situés à l’est où le rivage est sableux, tandis qu’au nord-est ont été aménagées et conservées plusieurs écluses à poissons : La Grande Ecluse (Plage du Grand Marchais), La Chiouse (Plage de Lanzin), La Providence (Plage de La Redoute), Le Trou d’Cheu (Plage du Gros Jonc).