0 avis
Abbaye-aux-Dames (ancienne) de Saintes
France > Nouvelle-Aquitaine > Charente-Maritime > Saintes
Historique
Au milieu du 11e siècle, Agnès de Bourgogne et Geoffroy Martel, comte d'Anjou, seigneur de Saintes et de la Saintonge, fondent à Saintes un monastère féminin régi par la règle de saint Benoît, l'abbaye Notre-Dame-et-Saint-Sauveur (dénommée par la suite abbaye aux Dames). Il s'élève sur la rive droite de la Charente, en dehors des murs de la ville.
L'abbaye est dotée de nombreux biens (terres, salines, vignes, marchés et foires, monnayage...) qui assurent son indépendance. Le pape Léon IX la place sous la protection directe du Saint-Siège en 1049.
Le 2 novembre 1047, l'église Sainte-Marie est dédicacée en présence de nombreux religieux et seigneurs. Elle est composée d'une nef, d'un transept et d'un chœur, l'ensemble étant sans doute charpenté.
L'église est transformée au siècle suivant. La nef est agrandie et dotée d'une nouvelle façade, un clocher est édifié sur la croisée du transept. Ces travaux pourraient être l’œuvre de l'architecte Bérenger dont l'épitaphe, datée du début du 12e siècle, a été retrouvée vers1930. Vers 1150, la nef est couverte par deux coupoles et un profond chœur remplace le précédent.
L'abbaye prospère au cours des siècles suivants grâce aux dons. Les moniales qui y vivent sont souvent issues de familles aristocratiques. En 1378, le monastère est placé sous la protection royale.
En 1568, pendant les guerres de Religion, les statues de la façade de l'église sont abattues par les Protestants. En 1608 et en 1648, deux incendies endommagent grandement l'abbaye. D'importants travaux de reconstruction s'ensuivent.
Les coupoles de l'église, en ruine, sont remplacées par une voûte sur croisée d'ogives (travée est) et par un plafond porté par quatre piliers (travée ouest) ; la voûte du bras sud du transept est refaite et une galerie voûtée ceinturant l'abside du chevet est édifiée.
Les bâtiments monastiques sont reconstruits.
L'abbaye aux Dames, une des plus puissantes de la Saintonge à la veille de la Révolution, ferme en 1792. Transformée un premier temps en prison, elle est affectée à l'armée en 1808 et devient une caserne militaire.
En 1815/16, le cloître roman et le bâtiment conventuel sud sont détruits. En 1820, le transept et le chœur de l'église sont divisés en deux niveaux par l'installation d'un plancher qui permet l'installation de chambrée.
Cependant, l'édifice gêne les militaires qui envisagent sa destruction. A l'initiative d'érudits locaux, il est inscrit sur la liste des monuments historiques en 1846, ce qui le sauve provisoirement.
En 1874, toute la nef est divisée en deux par un plancher. Le rez-de-chaussée, qui sert de magasin à vivres, est rehaussé d'un mètre et éclairé par de nouvelles baies. L'étage accueille des chambrées.
Fragilisé par ces travaux, le clocher menace ruine et l'armée envisage de l'abattre. Le projet est finalement abandonné et les travaux de sauvegarde sont entrepris par l'architecte des Monuments Historiques Ballu en 1879.
Après la Première guerre mondiale, l'église est donnée à la Ville de Saintes qui engage des travaux de restauration en 1923. Les toitures sont reprises, la maçonnerie du chevet refaite. Quelques années plus tard, Maurice Gouverneur, architecte départemental, procède à la destruction de la voûte de la croisée est de la nef et fait restaurer les piliers de la travée ouest. Il envisage de reconstruire les coupoles afin de restituer l'édifice dans sont état du 12e siècle mais son projet n'aboutit pas. En 1936, l'église est rouverte au culte.
Les bâtiments monastiques demeurent la propriété de l'armée jusqu'au lendemain de la Seconde guerre mondiale. En 1948, ils sont protégés au titre des monuments historiques. Il faut attendre les années 1970 pour que soit entreprise une vaste campagne de restauration qui s'achève en 1988.
Détail de l'historique
Description
L'architecture
L'église Sainte-Marie est un édifice majeur de l'architecte romane en Saintonge. Construite selon un plan fréquemment utilisé dans les communautés monastiques (nef, transept et chœur), elle présente plusieurs aspects novateurs pour la région.
Ainsi en est-il de la façade. Elle s'élève sur deux niveaux surmontés d'un fronton qui porte les armes de l'abbesse Françoise de Rochechouart (1559-1606). Le rez-de-chaussée et le deuxième niveau présentent une division tripartite : portail encadré de deux arcades aveugles plus étroites au premier niveau et, à l'étage, baie centrale inscrite dans une large arcade en plein cintre et arcades latérales plus étroites. Cette tripartition est soulignée par les colonnes qui séparent la travée centrale des parties latérales.
Ce type de façade structuré en trois parties sur deux niveaux est nouveau en Saintonge. Souvent mis en relation avec les arcs de triomphe gallo-romains, symboles du pouvoir impérial romain, il permettrait de montrer la puissance de l'Église au sein de la société.
Datée de 1125 par la sculpture, la façade de l'église Sainte-Marie va servir de modèle à des édifices locaux plus modestes.
Le couvrement de la nef, deux coupoles dont il ne reste aujourd'hui que les pendentifs, est une autre particularité de l'église. Lorsqu'elles sont édifiées, elles remplacent la charpente qui, depuis un siècle, couvre la nef. Les murs gouttereaux, construits en moellons et rythmés de hautes arcades ne peuvent pas en porter la charge. Six fortes piles (trois au nord, trois au sud) sont érigées près des murs gouttereaux, pour recevoir les pendentifs. A l'extérieur, un massif contrefort au nord et, au sud, un puissant arc-boutant (érigé au 17e siècle) renforcent les murs.
Le couvrement de la nef par des coupoles est introduit en Angoumois, à la cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême, vers 1120/1130. Ce choix de couvrement pour l'église Sainte-Marie témoigne de l'esprit précurseur des constructeurs et des moyens financiers et techniques dont ils disposent.
Le transept et le chœur prolongent la nef vers l'est.
Le bras sud du transept est couvert d'une voûte sur croisée d'ogives. Une tribune aménagée dans l'angle du bras sud et de la travée orientale de la nef permettait à l'abbesse et aux sœurs malades d'assister aux offices.
Le bras nord du transept, couvert de voûte d'ogives, ouvre à l'est sur une chapelle de plan rectangulaire adossée à la travée droite du chœur.
La croisée du transept est couverte d'une petite coupole octogonale portée par des trompes.
Le chœur est composé d'une travée droite et d'une abside semi-circulaire scandée de contreforts-colonnes. Il est largement éclairé par les cinq baies de l'abside et les deux du mur sud ; celles du nord ouvrent sur la chapelle contiguë. Les fenêtres sont inscrites dans de hautes arcades qui animent le mur.
Extérieurement, le chœur est dominé par le clocher qui s'élève sur la croisée du transept. Celui-ci est composé d'une souche carrée, percée sur chaque face de trois arcades en plein cintre dont les arc à trois ressauts sont ornés d'un riche décor géométrique, et d'une chambre des cloches circulaire encadrée de quatre clochetons et coiffée d'un toit conique en pierres. La chambre des cloches est percée de 12 baies géminées séparées par des colonnes. Les chapiteaux sont ornés de sculptures, refaites pour une partie d'entre eux.
Le chevet, très restauré au 20e siècle après la destruction de la galerie du 17e siècle, est divisé en deux niveaux par un bandeau. Les deux tiers de l'élévation, qui correspondent au premier niveau, sont rythmés d'arcades en plein cintre à l'intérieur desquelles s'inscrivent les quatre baies de l'abside. Certaines arcades conservent des archivoltes ornées de pointes de diamant. Toutes les baies ont été refaites. Le deuxième niveau est nu. Les deux registres sont réunis par des colonnes montant de fond.
La sculpture
La façade concentre le décor sculpté extérieur, porté aujourd'hui par la voussure du portail et les arcades aveugles. Ce décor est incomplet. Des sculptures occupaient vraisemblablement l'espace entre le cordon orné d'un damier et la corniche du premier niveau. L'arcade supérieure nord abritait un cavalier.
La voussure est composée de quatre larges rouleaux séparés par trois rouleaux plus étroits et surmontés par une archivolte ornée de lions et oiseaux entremêlés. Les figures sont sculptées soit dans le sens de l'arc, ce qui donne de longues silhouettes, soit dans un ordre rayonnant. Les arcs les plus larges portent un décor historié religieux, les plus étroits des entrelacs de feuillages ou des oiseaux. Sur le premier large rouleau est représentée la main de Dieu sur un disque soutenu par des anges ; elle bénit le chrétien qui entre dans l'église. Le troisième rouleau porte, au centre, l'Agneau de l'Apocalypse, avec la croix et le Livre. À ses côtés sont représentés les symboles des quatre évangélistes. Le Massacre des innocents est illustré sur le cinquième rouleau. Sur le dernier sont figurés les Vieillards de l'Apocalypse, dont le nombre est ici bien supérieur aux 24 cités dans la Bible. Les rouleaux retombent sur les colonnes des piédroits. De foisonnants rinceaux de feuillages et des luttes d'hommes et d'animaux sont représentés sur les chapiteaux.
Les arcades latérales portent aussi un décor historié. Au nord, le Christ, la main droite bénissant, est entouré de cinq apôtres (ou saints ?) tenant le Livre ; la retombée de droite de l'arc porte un centaure. L'archivolte est ornée d'un rinceau de feuillages habité d'animaux et d'êtres humains. Les chapiteaux des colonnes de l'arcade sont sculptés. À droite, une sirène-poisson à deux queues occupe le chapiteau externe.
Au sud est figurée la Cène. Le Christ, au centre, est entouré des apôtres qui tiennent une coupe ou un pain. Personnages et monstres complètent le décor. Sur l'archivolte sont figurés des personnages nus entremêlés à une vigne (la Vigne Véritable qui jaillit du Christ est représentée à l'extrémité sud de l'archivolte). Les chapiteaux des colonnes présentent, à gauche, deux hommes avec un maillet et un personnage luttant contre deux oiseaux ; à droite, une femme et un homme semblent écarter les feuillages.
Le clocher et à l'intérieur de l'église conservent un décor sculpté roman. Les chapiteaux des colonnettes du clocher, notamment ceux de la souche, sont ornés de feuillages, d'animaux proches de ceux de la façade ; ils reçoivent les arcs à ressauts des baies qui sont décorés de motifs géométriques. À l'intérieur, le chœur concentre l'ornementation romane (des feuillages) portée par les chapiteaux des baies et des colonnes ainsi que par les archivoltes.
Détail de la description
| Murs |
|
|---|---|
| Toits |
|
| Plans |
plan en croix latine |
| Étages |
1 vaisseau |
| Couvrements |
|
| Couvertures |
|
| Escaliers |
|
| Décors/Technique |
|
| Décors/Représentation |
Précision sur la représentation : La façade Le portail et les arcades de la façade concentrent le décor sculpté extérieur. Ce décor est incomplet. Des sculptures occupaient vraisemblablement l'espace entre le cordon orné d'un damier et la corniche du premier niveau. L'arcade supérieure gauche abritait un cavalier. Ce décor a été daté des années 1125. La voussure du portail est composée de quatre larges rouleaux séparés par trois rouleaux plus étroits et surmontés par une archivolte sculptée de lions et oiseaux entremêlés. Les arcs les plus larges portent un décor historié religieux, les plus étroits des entrelacs de feuillages ou des oiseaux. Ils retombent sur des colonnes à chapiteaux ornés de feuillages, de combats d'animaux... De l'arc interne vers l'arc externe, sont représentés : - la main de Dieu sur un disque soutenu par des anges (premier rouleau) - l'Agneau de l'Apocalypse et les symboles des quatre évangélistes (troisième rouleau) - le Massacre des innocents (cinquième rouleau) - les Vieillards de l'Apocalypse (septième rouleau). Les rouleaux retombent sur les chapiteaux des colonnes où sont représentés de foisonnants rinceaux de feuillages et des luttes d'hommes et d'animaux. Les arcades latérales portent aussi un décor historié : - au nord, le Christ bénissant, est entouré de cinq apôtres (ou saints ?) tenant le Livre ; les retombées de l'arc présentent un centaure. L'archivolte est ornée d'un rinceau de feuillages habité d'animaux et d'êtres humains ; - au sud est figurée la Cène ainsi que des personnages et de monstres. L'archivolte est ornée de personnages nus entremêlés à une vigne (la Vigne Véritable qui jaillit du Christ est représentée à l'extrémité sud de l'archivolte). Les chapiteaux des colonnettes des baies du clocher et des colonnes du chœur sont ornés de feuillages, d'animaux. Les arcs à ressaut des baies du clocher présentent une riche ornementation géométrique. |
Informations complémentaires
Lieu de culte d'une puissantes abbayes de Saintonge, l'église Sainte-Marie témoigne de l'évolution de l'architecture romane aux 11e et 12e siècles. Sa façade et le décor sculpté qui l'agrémente vont être repris au cours du 12e siècle dans de nombreux édifices locaux.
Au milieu du 11e siècle, le comte d'Anjou Geoffroy Martel, seigneur de Saintes et de la Saintonge, et sa femme Agnès fondent à Saintes sur la rive droite de la Charente, en dehors des murs de la ville, un monastère féminin régi par la règle de saint Benoît, l'abbaye Notre-Dame-et-Saint-Sauveur (dite abbaye aux Dames).
Le 2 novembre 1047, la nouvelle église Sainte-Marie est dédicacée en présence de nombreux religieux et seigneurs. Elle est composée d'une nef sans doute couverte d'une charpente, d'un transept et d'un chœur en abside.
L'édifice est profondément transformé au siècle suivant. Vers 1120/1125, la nef est agrandie et terminée par une nouvelle façade, un clocher est érigé à la croisée du transept. Le nom du maître d’œuvre est connu, ce qui est rare pour l'époque romane. Il s'agit de Béranger, dont l'épitaphe, retrouvée vers 1930, est aujourd'hui présentée à l'extrémité ouest du mur nord de l'église.
Vers 1150, la nef est couverte par deux coupoles sur pendentifs ; pour les porter, de massifs piliers sont construits à l'intérieur de la nef. Un chœur plus profond que le précédent est reconstruit.
Ces remaniements traduisent la volonté de l'Église d'affirmer sa place dans une société dominée par les seigneurs. L'église, la « maison de Dieu », doit être magnifiée. Les édifices sont voûtés, les chœurs, espaces dévolus au clergé, portent symboliquement les clochers, les façades sont ornées de sculptures qui exposent aux yeux des fidèles le message de l'Église.
La présence des coupoles de la nef de l'église Sainte-Marie, mode de couvrement introduit dans la région quelques années plus tôt à la cathédrale d'Angoulême, témoigne de cet esprit novateur. Il en de même pour la façade de l'église qui présente une structure tripartite inédite en Saintonge.
Le frontiscipe présente deux niveaux divisés en trois parties et un pignon. Le portail du rez-de-chaussée est encadré de deux arcades aveugles, comme la baie centrale de l'étage. Cette structuration est peut-être inspiré des arcs de triomphe gallo-romains, l'architecture antique étant une des sources d'inspiration des constructeurs romans.
La voussure du portail porte l'essentiel du décor sculpté de l'église. Elle compte sept rouleaux alternativement ornés d'un décor historié (Main de Dieu portée par des anges, Agneau de l'Apocalypse entouré des symboles des évangélistes, Massacre des innocents, Vieillards de l'Apocalypse) et d'animaux et/ou de feuillages entremêlés. Ces motifs ornementaux sont très présents dans la sculpture saintongeaise
Les arcades du rez-de-chaussée portent, à gauche, le Christ bénissant entourés de saints (ou d'apôtres) et, à droite, la Cène. À l'étage, l'arcade gauche abritait un cavalier aujourd'hui disparu.
L'église accueille les religieuses pendant plus de sept siècles, jusqu'à la fermeture de l'abbaye en 1792. Malgré d'importantes altérations (mutilation partielle de la façade en 1568, disparition des coupoles de la nef lors d'un incendie en 1648, construction d'une galerie sur le pourtour du chevet), l'édifice roman demeure encore lisible en 1792.
Au 19e siècle, les destinations successives de l'ancien monastère en prison puis en caserne endommagent l'église. Elle est séparée en deux niveaux pour accueillir un magasins aux vivres et des chambrées. Menacée un temps de disparition, elle est inscrite sur la liste des monuments historiqes en 1846.
Dans les années 1920, l'église devient la propriété de la Ville de Saintes qui entreprend sa restauration. L'église est ouverte au culte quelques années plus tard.
| Type de dossier |
Dossier d'oeuvre architecture |
|---|---|
| Référence du dossier |
IA17037571 |
| Dossier réalisé par |
Dujardin Véronique
Chercheur, service Patrimoine et Inventaire Sarrazin Christine |
| Cadre d'étude |
|
| Aire d'étude |
Pays de Saintonge romane |
| Phase |
étudié |
| Date d'enquête |
2016 |
| Copyrights |
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel |
| Citer ce contenu |
Abbaye-aux-Dames (ancienne) de Saintes, Dossier réalisé par Dujardin Véronique, (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/e7dc9215-fee0-4b37-b178-f237faeccd21 |
| Titre courant |
Abbaye-aux-Dames (ancienne) de Saintes |
|---|---|
| Dénomination |
abbaye |
| Genre du destinataire |
de bénédictines |
| Vocable |
saint Sauveur Notre-Dame |
| Parties constituantes non étudiées |
bâtiment conventuel |
| Statut |
|
|---|---|
| Protection |
|
Localisation
Adresse: Nouvelle-Aquitaine , Charente-Maritime , Saintes , place de l'Abbaye
Milieu d'implantation: en ville
Cadastre: 2014 CP 21 (Cadastre en ligne consulté le 23 décembre 2014. Cadastre napoléonien : section de l'abbaye aux Dames non trouvée.)
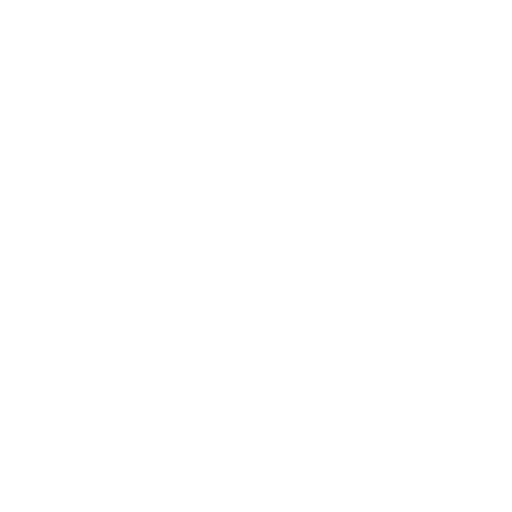
![Plan de l'église abbatiale de Notre-Dame de Saintes [sic]. Etat actuel. L. Julien-Laferrière [vers 1885].](/graphQlProxy.ashx?urlgraphql=https://rna-gertrude-diffusion-graphql-prod.atolcd.com/api/file/951dbaf9-5514-48fe-88e2-d07eeafb15ae.jpg)




