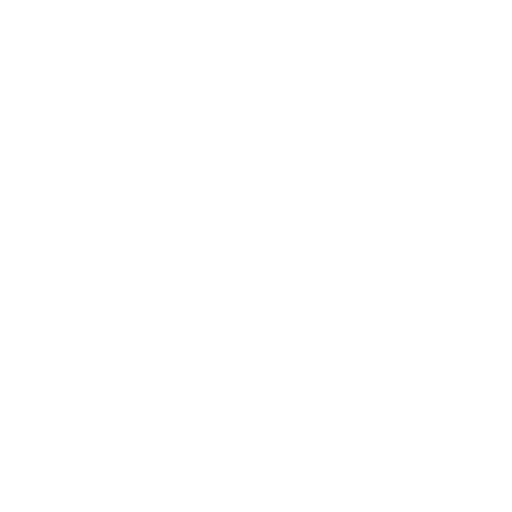0 avis
Historique
L'abbaye a été fondée en 1002 par Wardrade Loriches, comte de la Marche et premier seigneur connu de Jarnac, et son épouse Rixendis, au retour d´un pèlerinage à Rome. Elle a été consacrée vers 1015 par Grimoard, évêque d'Angoulême, et son frère Iso, évêque de Saintes. En 1092, elle est rattachée à l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély et redevient libre en 1246. De l´édifice roman du 11e siècle subsiste la base des murs et les premiers niveaux du clocher. L'église a été en grande partie reconstruite sous Guillaume de Vibrac, abbé de 1247 à 1286. La plus grande partie de l´église et le haut du clocher reflètent cette reconstruction dans le style gothique, avec des voûtes d´ogives bombées.
Pillée par les troupes anglo-gasconnes en 1434, elle est restaurée et fortifiée (construction notamment de deux échauguettes sur la façade et d´un mur d´enceinte), sous Henri de Courbon, abbé de 1451 à 1476, qui reconstruit également le logis de l'abbé et le cloître. Le mur du chevet est alors percé d´une grande baie à remplages.
Elle est pillée par les protestants en 1564, adopte la réforme mauriste en 1566 et est à nouveau assiégée et pillée par les catholiques au moment de la bataille de Jarnac en 1569. Les voûtes furent démolies lors de ce deuxième siège puis reconstruites, en 1677 pour la deuxième travée, et en 1688 pour la première. Les bâtiments conventuels ont été construits de 1677 à 1681 pour le bâtiment sud-est, vers 1683 pour l'aile sud-ouest et de 1712 à 1716 au nord-ouest. La construction des stalles a commencé en 1699 sur les dessins de frère Jean Lacoste. Le retable date de 1730.
Le cloître est détruit en 1820. L'église est restaurée en 1874, sous la direction de Warin : soixante chapiteaux sont refaits et douze restaurés par le sculpteur Guimberteau d'Angoulême. En 1884 et 1885, le clocher est restauré par l'entreprise Laboisne sous la direction de Warin. En 1895 et pour quelques années seulement, un séminaire s´installe dans les bâtiments encore utilisables. Depuis 1947, l´abbaye est occupée par les frères missionnaires de Sainte-Thérèse-de-l´Enfant-Jésus. Deux chapiteaux romans provenant de l'ancienne église paroissiale Saint-Nicolas servent de socle à des statues dans la première travée de la nef de l'église abbatiale.
Détail de l'historique
| Périodes |
Principale : 1er quart 11e siècle Principale : 13e siècle Principale : 4e quart 17e siècle Principale : 1er quart 18e siècle Principale : 3e quart 15e siècle (détruit) |
|---|---|
| Dates |
1677, daté par travaux historiques 1688, daté par source |
| Auteurs |
Auteur :
Warin Édouard, architecte Auteur : Guimberteau, sculpteur Auteur : Ballu Albert, Auteur : Besnard Charles-Henri (architecte), |
Description
L´abbaye Saint-Étienne est située dans l´ancien diocèse de Saintes, en bordure d´un bras de la Charente dans le village de Bassac. L´église Saint-Étienne n'est pas orientée : son chœur est au sud-est, sa façade au nord-ouest, le cloître adossé à son mur sud-ouest et les bâtiments conventuels s´organisent autour de ce cloître.
L'église, construite en pierre de taille, présente un plan allongé. Elle est composée de quatre travées couvertes de voûtes d'ogives à huit quartiers, les deux premières constituant la nef et les deux dernières le chœur avec les stalles, séparé de la nef par un jubé en pierre. Deux chapelles voûtées sont accolées au nord-est de la quatrième travée de l'église. Le clocher est adossé du même côté à la troisième travée ; son escalier d´accès est aménagé dans le contrefort séparant la deuxième et la troisième travées.
De l´époque romane ne subsistent que quelques chapiteaux et la base du clocher.
Dans la première travée nef, deux anciens chapiteaux provenant de l´église paroissiale Saint-Nicolas de Bassac ont été remployés comme supports de statues (du côté nord : Saint-Joseph et l´Enfant Jésus, du côté sud : saint Nicolas). Les deux corbeilles (hauteur : 0,36 m, largeur : 0,55 m ; profondeur : 0,33 m) portent le même décor : deux tiges s'entrecroisent, qui ce terminent par une volute à la partie supérieure et par une palmette à la partie inférieure ; en bas, les tiges sont reliées deux par deux par des bagues, ornées comme les tiges et les palmettes d'une série de têtes de clous. Ce thème est répété quatre fois : une sur chaque petite face de la corbeille et deux sur la grande face.
Deux chapiteaux romans, d´une hauteur d´environ 30 cm, surmontent les colonnettes de la fenêtre nord du rez-de-chaussée du clocher. Les deux corbeilles, à peu près semblables, sont ornées sur chaque face de quatre longues tiges retombant à leur extrémité, commune à deux tiges. Entre les huit tiges se dressent sept feuilles à bordure découpée. Au-dessus de l'astragale est placée une rangée de trois ou quatre crossettes. Les tailloirs sont ornés de six fasces.
Les chapiteaux des quatre piles portant la coupole qui couvre le rez-de-chaussée du clocher sont également romans. Chaque corbeille, d´environ 0,40 m de hauteur, et son astragale est taillée dans un seul bloc de calcaire de couleur ocre clair.
Sur le groupe nord-ouest sont figurés, de gauche à droite : deux personnages accroupis, les mains sur les cuisses (celui de gauche est simplement épannelés) ; deux quadrupèdes dissemblables dont la tête commune occupe l'angle supérieur de la corbeille ; deux groupes de larges feuilles disposées les unes au-dessus des autres.
Sur le groupe nord-est sont sculptés, de gauche à droite : aux angles de la corbeille, un groupe de feuilles surmonté d'une grosse crosse de feuillage et accosté de deux crossettes, une palmette occupant la partie basse de chacune des trois faces ; une grande palmette d'angle entre deux demi-palmettes ; deux lionnes adossées à tête commune et, à droite, un loup à la tête retournée.
Sur le troupe sud-est sont représentés, de gauche à droite : deux lionnes affrontées, une patte antérieure levée et la tête tournée vers l'arrière ; un masque humain crachant des feuillages qui se mêlent au reste du décor végétal de la corbeille ; de hautes feuilles disposées sur plusieurs rangées. Sur le groupe sud-ouest se voient, de gauche à droite : un gros masque flanqué de deux importantes crosses de feuillages et, sur la petite face droite, d'un animal ou personnage accroupi ; un animal à visage humain et longue queue bifide faisant face à une palmette ; un chapiteau à larges feuillages gras.
Ces quatre groupes de chapiteaux du clocher ainsi que les deux chapiteaux du côté nord sont datables de la première moitié du 12e siècle.
Le reste de l´église est gothique, avec d´importants remaniements postérieurs.
La façade est encadrée par deux gros contreforts surmontés chacun d'une échauguette. Le portail central, encadré de deux arcatures aveugles, comporte quatre rouleaux, le premier étant polylobé. Le troisième rouleau porte une inscription révolutionnaire : « LE PEUPLE FRANÇAIS RECONNOIT L´ÊTRE SUPRÊME ET L´IMMORTALITÉ DE L´ÂME ». Des chapiteaux sculptés couronnent les colonnes portant les différents rouleaux. Une niche polylobée surmonte l'arcature gauche. Au-dessus d'une corniche, le second niveau se compose d'une baie centrale en plein cintre, encadrée par quatre étroites arcades aveugles portées par des colonnettes. Au-dessus d'une deuxième corniche, le pignon est percé d'archères au niveau du chemin de ronde reliant les deux échauguettes.
Le chevet plat est percé d'une grande baie en arc brisé à remplage gothique.
Le clocher, de quatre étages, de est attenant au nord-est de la troisième travée de l'église. Une coupole sur pendentifs, reposant sur des faisceaux de colonnes à chapiteaux romans (voir plus haut), est située sous le clocher. Les étages présentent sur les quatre faces, trois arcades aveugles au premier étage, deux arcades percées de baies jumelles au second, deux grandes baies au troisième et quatre petites baies au quatrième. Les baies sont encadrées de colonnettes. Le quatrième étage est surmonté d'une flèche conique en maçonnerie et de quatre petits pinacles aux angles.
Les bâtiments conventuels, disposés au sud-est, au sud-ouest et au nord-ouest de l'ancien cloître, sont construits en moellons enduits et comportent un étage carré et un étage de comble, avec élévations à travées, toits à longs pans brisés en ardoise et trois escaliers dans-œuvre tournants à retours avec jours en maçonnerie, dont deux sur voûte en demi berceau et un suspendu. Le rez-de-chaussée est voûté en arc de cloître à lunettes, en berceau brisé asymétrique à lunettes et en voûtes d'arêtes. Le sous-sol est voûté en berceau plein cintre. Le logis de l'abbé comporte deux étages, avec pignons couverts et escalier en vis hors-œuvre. Le cloître détruit était jadis voûté d'ogives. Le long passage couvert menant de la basse-cour au cloître est couvert de six voûtes d'ogives et d'une voûte d'arêtes.
Détail de la description
| Murs |
|
|---|---|
| Toits |
|
| Plans |
plan allongé |
| Étages |
1 vaisseau, 2 étages carrés, étage de comble, sous-sol |
| Couvrements |
|
| Couvertures |
|
| Escaliers |
|
| État de conservation |
|
| Décors/Technique |
|
| Décors/Représentation |
Précision sur la représentation : Sujet : ornement géométrique, support : fenêtres ; sujet : blasons, support : clef de voûte, litre funéraire ; sujet : feuillage, support : clef de voûte. |
Informations complémentaires
L'église romane a été en grande partie reconstruite au 13e siècle. Pillée à plusieurs reprises, l'église a été fortifiée au 15e siècle. Elle a conservé un clocher roman à quatre étages. Les bâtiments conventuels datent de la fin du 17e siècle et du début du 18e siècle. Un long passage voûté permet d'accéder au cloître.
L'abbaye a été fondée en 1002 par Wardrade Loriches, seigneur de Jarnac, et son épouse Rixendis. Elle a été consacrée vers 1015 par Grimoard, évêque d'Angoulême, et son frère Iso, évêque de Saintes. L'église a été en grande partie reconstruite sous Guillaume de Vibrac, abbé de 1247 à 1286. Pillée par les troupes anglo-gasconnes en 1434, elle est restaurée et fortifiée sous Henri de Courbon, abbé de 1451 à 1476, qui reconstruit également le logis de l'abbé et le cloître. Elle est à nouveau pillée par les Protestants en 1564, puis assiégée et pillée par les Catholiques au moment de la bataille de Jarnac en 1569. L'abbaye adopte la réforme mauriste en 1566. Les voûtes de l'abbatiale sont reconstruites, en 1677 pour la deuxième travée, et en 1688 pour la première. Les bâtiments conventuels ont été construits de 1677 à 1681 à l'est, vers 1683 pour l'aile sud et de 1712 à 1716 à l'ouest. Le cloître est détruit en 1820. L'église est restaurée en 1874 ouis en 1884-1885 sous la direction de Warin
Deux chapiteaux romans provenant de l'ancienne église paroissiale Saint-Nicolas servent de socle à des statues dans la nef de l'église abbatiale.
L'église abbatiale, construite en pierre de taille, présente un plan allongé. Elle est composée de quatre travées couvertes de voûtes d'ogives à huit quartiers. La façade est encadrée par deux gros contreforts surmontés chacun d'une échauguette. Le portail central comporte quatre rouleaux, le premier étant polylobé. Deux arcades aveugles encadrent le portail. Des chapiteaux sculptés couronnent les colonnes portant les différents rouleaux.
Le chevet plat est percé d'une grande baie en arc brisé à remplage gothique. Le clocher est attenant au nord de la troisième travée de l'église. Une coupole sur pendentifs, reposant sur des faisceaux de colonnes, est située sous le clocher. Le clocher comporte quatre étages qui présentent sur les quatre faces, trois arcades aveugles au premier étage, deux arcades percées de baies jumelles au second, deux grandes baies au troisième et quatre petites baies au quatrième. Les baies sont encadrées de colonnettes. Le quatrième étage est surmonté d'une flèche conique en maçonnerie et de quatre petits pinacles aux angles.
Deux chapelles voûtées sont accolées au nord de la quatrième travée de l'église. Les bâtiments conventuels, disposés à l'est, au sud et à l'ouest de l'ancien cloître, sont construits en moellons enduits, et comportent un étage carré et un étage de comble. Les toits sont à longs pans brisés en ardoise. Le logis de l'abbé comporte deux étages, avec pignons couverts et escalier en vis hors-œuvre. Le cloître détruit était jadis voûté d'ogives. Le long passage couvert menant de la basse-cour au cloître est couvert de six voûtes d'ogives et d'une voûte d'arêtes.
| Type de dossier |
Dossier d'oeuvre architecture |
|---|---|
| Référence du dossier |
IA00049629 |
| Dossier réalisé par |
Riou Yves-Jean
Dujardin Véronique Chercheur, service Patrimoine et Inventaire |
| Cadre d'étude |
|
| Aire d'étude |
Pays Ouest-Charente - pays du Cognac |
| Phase |
étudié |
| Date d'enquête |
1985 |
| Copyrights |
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel |
| Citer ce contenu |
Abbaye de bénédictins Saint-Étienne, de mauristes, Dossier réalisé par Riou Yves-Jean, (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/cd809ca5-96a0-4bf0-a7f9-2841e5810a4d |
| Titre courant |
Abbaye de bénédictins Saint-Étienne, de mauristes |
|---|---|
| Dénomination |
abbaye |
| Genre du destinataire |
de bénédictins de bénédictins de la congrégation de Saint-Maur |
| Vocable |
saint Etienne |
| Parties constituantes non étudiées |
enclos cour jardin terrasse en terre-plein église salle capitulaire logis abbatial communs hôtellerie grange pressoir puits vivier |
| Statut |
|
|---|---|
| Protection |
|
Localisation
Adresse: Nouvelle-Aquitaine , Charente , Bassac
Milieu d'implantation: en village
Cadastre: 1829 E 369-381, 2011 E 218-233 (église sur la parcelle E 228, le reste correspond au cloître et aux bâtiments conventuels)