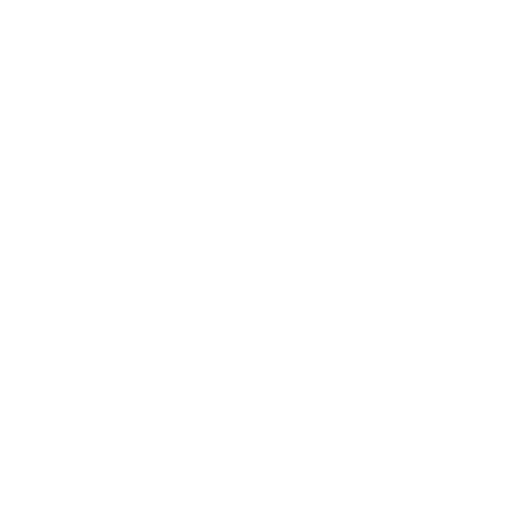0 avis
Maisons et fermes du Confolentais
France > Nouvelle-Aquitaine
Historique
Les maisons du XVIe ou du XVIIe siècle, les plus anciennes identifiées, sont rares, sauf à Confolens où l´on trouve également la très grande majorité des maisons à pans de bois du territoire. Elles se caractérisent par des façades sans organisation en travée, des ouvertures rarement alignées, avec des encadrements irréguliers, parfois couverts en anse de panier, décorés d´accolades ou de simples chanfreins.
Cette période est plus difficile à caractériser en milieu rural. Au cours des XVIe et XVIIe siècles, la construction de manoirs, sièges de petits fiefs, s´intensifie, mais il ne reste que peu de vestiges visibles de maisons contemporaines. Les petits manoirs ne se distinguent des simples maisons que par la présence de pigeonniers et une ornementation architecturale plus riche quoique limitée : blasons muets sur des linteaux, couvertures de baies en accolade, fenêtres à mouluration, plus rarement escaliers de distribution extérieurs, qu´il s´agisse d´escaliers droits couverts par un auvent ou « balet », ou de tours d´escaliers hors-oeuvre ou demi-hors-oeuvre.
Quarante-quatre dates du XVIIe siècle ont cependant pu être repérées, dont la moitié dans la vallée de la Marchadaine (au nord-ouest de la commune de Montrollet et au nord-est de Saint-Christophe). Cette concentration peut correspondre à une coutume des artisans locaux ou, plus probablement, à une conservation particulière du bâti le plus ancien dans un secteur à l´écart des bourgs et peu touché par les restaurations. Les reconstructions des XIXe et XXe siècles ne permettent pas toujours de reconnaître ce bâti le plus ancien lorsqu´il ne s´agit pas de maisons à pan de bois ou portant des décors spécifiques. Ces maisons sont plus facilement repérées à Confolens et dans les deux communes voisines de Lessac (Sainte-Radegonde) et Saint-Germain-de-Confolens, qui concentrent la plupart des fenêtres à moulurations entrecroisées et accolades sur du bâti civil.
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les maisons à escalier extérieur sont le plus souvent des maisons d´artisans avec atelier au rez-de-chaussée et habitation à l´étage. En dehors des bourgs, très peu de maisons sont identifiables pour cette période. Pourtant, la très grande majorité des hameaux est figurée sur la carte de Cassini et existait donc au milieu du XVIIIe siècle. Cette carte présente le territoire dans une configuration proche de ce que l´on observe aujourd´hui : bourgs, villages, hameaux et fermes isolées sont en place. Cependant, si un tiers des maisons et fermes conserve des éléments du XVIIIe siècle, la quasi-totalité a été remaniée ou reconstruite entre 1830 et 1940, au moment du plus fort peuplement.
A partir du XIXe siècle, les maisons sont dotées de fenêtres plus grandes qu´auparavant et de façade souvent ordonnancées : elles présentent des alignements verticaux (travées d´ouvertures) et horizontaux.
Détail de l'historique
| Périodes |
Principale : Moyen Age Principale : Temps modernes Principale : Epoque contemporaine |
|---|
Description
. RÉPARTITION DES LOGEMENTS SUR LE TERRITOIRE
Les cadastres des années 1830 mentionnent pour l´ensemble du Confolentais 5 904 maisons, alors qu'en 1999, l´Insee dénombrait 7 524 logements, dont 1 388 à Confolens. Sur plus de 5300 dossiers documentaires d´architecture établis au cours de l´opération d´inventaire, 83,5 % (4431) concernent des maisons et des fermes.
Confolens, Ansac-sur-Vienne et Champagne-Mouton sont les communes qui comprennent le plus de bâtiments de la seconde moitié du XXe siècle, en lotissement et surtout en maisons individuelles. A l´inverse, Saint-Germain-de-Confolens est une commune de petite superficie qui n´a pas eu d´espace permettant le développement d´une urbanisation récente (7 immeubles postérieurs à 1949 d´après l´Insee, recensement de 1999).
Lors du recensement de 1999, l´Insee a distingué plusieurs classes pour la date de construction des logements, en fonction de la déclaration des habitants. Pour les petites communes, toute erreur d´appréciation peut avoir des répercussions importantes sur l'estimation globale de la datation des logements.
Si l´on se reporte au bâti identifié par l'Insee comme antérieur à 1949, la part globale des logements étudiés par l´inventaire est de 86 %. Elle varie de 61 % à Ansac-sur-Vienne à plus de 120 % à Turgon et Montrollet. On s´aperçoit que l´inventaire a pris en compte des logements aujourd´hui abandonnés que l´Insee ne compte pas comme des logements, et a exclu les logements les plus remaniés. Ceux-ci se trouvent surtout à Champagne-Mouton (chef-lieu de canton) et à Ansac-sur-Vienne (« réhabilitations » de logements anciens en périphérie de la ville de Confolens), et de manière inexpliquée, à Alloue et Abzac.
. MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Les roches présentes à la surface du sol étaient jadis utilisées comme matériaux de construction, que ce soit sous forme de moellons pour les murs ou, plus soigneusement préparés, pour les chaînes d´angle et les encadrements des portes et fenêtres : calcaire à l´ouest, roches variées du socle (granite, gneiss, diorites) à l´est. Dès le XVe siècle, le calcaire de Pressac est importé en zone granitique pour réaliser les encadrements.
L´argile présente dans le sous-sol de la partie nord-est du territoire, au contact du Montmorillonnais, a été utilisée crue comme matériau de construction, surtout dans la commune d´Oradour-Fanais, depuis une période très ancienne jusqu´au XXe siècle. Elle a été principalement employée pour la construction des granges et dépendances, mais aussi pour celle des maisons, aujourd´hui très souvent restaurées, en élévation ou pour les cloisons intérieures.
Le pan de bois est une caractéristique des maisons les plus anciennes (des XVe et XVIe siècles) recensées en zone d´habitat aggloméré. Qu´elles aient une façade en pignon, cas le plus fréquent, ou une façade sur le mur gouttereau, leur rez-de-chaussée a souvent été construit en moellons et leurs étages en pan de bois posés en encorbellement sur la poutre sablière. Les incendies et leur prévention (recouvrement par un enduit ou reconstruction en moellons), font que très peu d´entre elles, environ une quinzaine, ont pu être repérées hors de la ville de Confolens. A Confolens, une soixantaine de maisons (soit 1/10e des maisons du centre-ville), conservée dans des états variables, est à pan de bois. Six ont été protégées au titre des monuments historiques. Au fil du temps, nombre d´entre elles a été partagé en plusieurs propriétés. La majorité comprend une façade en pignon avec un rez-de-chaussée en moellons ou en grand appareil, des étages en pan de bois et des murs gouttereaux en moellons. Pour prévenir les incendies, des règlements ont ordonné à plusieurs reprises de les recouvrir d´un enduit. Ces maisons sont souvent séparées de leurs voisines par une venelle qui servait de coupe-feu.
Dans la zone où la terre est utilisée, mais également là où les matériaux sont les plus difficiles à travailler en pierre de taille, les encadrements en bois sont présents sur tout ou partie des baies de plus d´un cinquième des logements, soit, par ordre décroissant de présence, à Lesterps, Saint-Christophe, Oradour-Fanais, Brillac, Montrollet, Lessac, Confolens, Hiesse, Saint-Germain-de-Confolens, Abzac et Saint-Maurice-des-Lions. Ce type d´encadrement est en revanche très rare en zone calcaire : moins de 10 % des logements en possèdent à Vieux-Ruffec, Pleuville, Benest, Le Vieux-Cérier, Le Bouchage, Turgon, Champagne-Mouton, Saint-Coutant, Chassiecq, Alloue et Ambernac.
A la fin du XIXe siècle, l´emploi de briques dans les encadrements se généralise, souvent en alternance avec la pierre calcaire. Le chemin de fer a facilité l´importation de matériaux de construction comme la pierre calcaire d´Angoulême ou l´ardoise que l´on trouve employées dans de nombreuses constructions des années 1920 et 1930.
Les couvertures sont traditionnellement en tuiles creuses. La tuile mécanique, notamment de Roumazières, si elle est employée sur les logements et quelques granges à partir de la fin du XIXe siècle, n´a réussi à la supplanter que depuis les années 1960. La tuile plate et l´ardoise ne sont guère employées que sur les bâtiments publics, une part importante des châteaux et manoirs et quelques maisons de notables dans les bourgs pour l´ardoise.
. TYPOLOGIE DES LOGEMENTS
De taille très modeste, ils sont souvent composés d´un rez-de-chaussée d´une à deux pièces surmonté d´un comble à surcroît. Ce type de logement est présent dans l´ensemble du Poitou-Charentes.
Les logements les plus grands, à façade à trois travées ou plus, se retrouvent dans les communes les plus peuplées, dans les bourgs ou pour les sièges des plus grandes exploitations agricoles. A Confolens, 285 logements étudiés ont un étage et 223 deux étages et plus. En dehors de Confolens, un tiers des logements comporte un étage, et moins d´une cinquantaine deux étages et plus. Les logements à étage se trouvent davantage dans les bourgs, où le bâti est plus dense, que dans les écarts et les fermes isolées, où la place disponible est plus importante, ce qui permet de répartir les espaces d´habitation en rez-de-chaussée plutôt que sur plusieurs niveaux.
. TYPOLOGIE DES FERMES
Sur plus de 2 200 fermes, les neuf dixièmes sont isolés ou regroupés dans les hameaux. En revanche, plus des deux tiers des maisons qui ne sont pas liées à un siège d´exploitation agricole se situent en village ou en ville.
Les fermes ont des plans variés qui sont le résultat de l´évolution permanente des exploitations. Les bâtiments sont en effet construits ou reconstruits au gré des besoins agricoles. Les grands ensembles à cour fermée sont très rares et la grande majorité des fermes est située en bordure de chemin ou en est séparée par une cour ouverte.
Si les types de fermes se répartissent différemment sur le territoire, il est difficile d´expliquer ces variations en l´absence d´étude sur les faire-valoir, les modes de culture et d´élevage.
L´organisation la plus fréquente est celle de la ferme à bâtiments dispersés (44 %), dont la proportion dépasse 60 % à Alloue, Epenède, Hiesse, Lesterps et Oradour-Fanais, mais n´atteint pas 30 % au Bouchage, à Chassiecq, Manot, Saint-Coutant et Turgon. Il est rare que les bâtiments soient disposés de manière organisée autour de la cour. Plus souvent, le logement, la grange et/ou les dépendances sont implantés au gré des besoins et peuvent être séparés par un chemin.
Parfois, les nouveaux corps de bâtiments ont été accolés aux constructions préexistantes (fermes à bâtiments jointifs, 18 % des cas) ou en alignant leurs façades (fermes à bâtiments alignés, 10 %). Ce type, où la grange est généralement plus haute que le logement, est plus représenté à l´ouest (20 % à Chassiecq et à Saint-Coutant) qu´au centre (moins de 5 % à Alloue, Champagne-Mouton, Epenède, Esse et Le Vieux-Cérier).
Par opposition à ces ensembles hétérogènes, deux types de fermes, construites en une seule phase, réunissent sous un même toit grange et logement. Dans le cas des fermes de type bloc en longueur, de plan rectangulaire, le logement occupe environ un tiers du bâtiment et la grange, les deux tiers restants, alors que pour les fermes dites de plan massé, de plan proche du carré, le logement est situé sous la partie la plus basse et la grange-étable dans la partie présentant le plus de hauteur. Les fermes de type bloc en longueur représentent 17 % du total des fermes mais sont réparties de manière inégale sur le territoire, plus nombreuses à l´ouest (autour de 25 % au Bouchage, à Chassiecq, à Saint-Coutant et à Turgon) qu´au centre (15 % environ à Alloue, Ambernac, Epenède) et n´atteignant pas 10 % à Hiesse, Montrollet et Esse. Les fermes de plan massé (11,5 % des fermes recensées) sont généralement antérieures au XIXe siècle, en proportion très inégale d´une commune à l´autre et sont relativement plus nombreuses à Benest et à Turgon.
Les granges dont la façade est sur un mur pignon sont le plus souvent antérieures au XIXe siècle, même si dans la partie granitique du Confolentais, il s´en trouve qui datent de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle. Ce mode de construction permet de créer un vaste espace central dédié au stockage des récoltes et du matériel agricole. Les étables sont quant à elles placées le long des murs gouttereaux, souvent peu élevés du fait de l´allongement des pans de toit.
Construites le plus souvent aux XIXe et XXe siècles, les granges dont la façade est située sur un mur gouttereau sont généralement plus petites que celles dont la façade est sur un mur pignon. La façade comporte soit une porte charretière centrale encadrée de deux portes d´étables, soit une porte charretière et une porte d´étable latérale.
Les étables intégrées dans les granges étaient généralement destinées aux bovins, aux ovins et aux chevaux de trait. D´autres petits bâtiments, bas et de plan allongé, étaient fréquemment attribués aux porcs et sont localement appelés « toit à cochons ».
Informations complémentaires
| Type de dossier |
Dossier collectif, aire d'étude |
|---|---|
| Référence du dossier |
IA16008679 |
| Dossier réalisé par |
Dujardin Véronique
Chercheur, service Patrimoine et Inventaire Moinot Emilie |
| Cadre d'étude |
|
| Date d'enquête |
2007 |
| Copyrights |
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, (c) Communauté de communes de Charente Limousine |
| Citer ce contenu |
Maisons et fermes du Confolentais, Dossier réalisé par Dujardin Véronique, (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, (c) Communauté de communes de Charente Limousine, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/6afd9a8c-b69d-4196-a215-63e4f4b9a8d9 |
| Titre courant |
Maisons et fermes du Confolentais |
|---|---|
| Dénomination |
maison ferme |