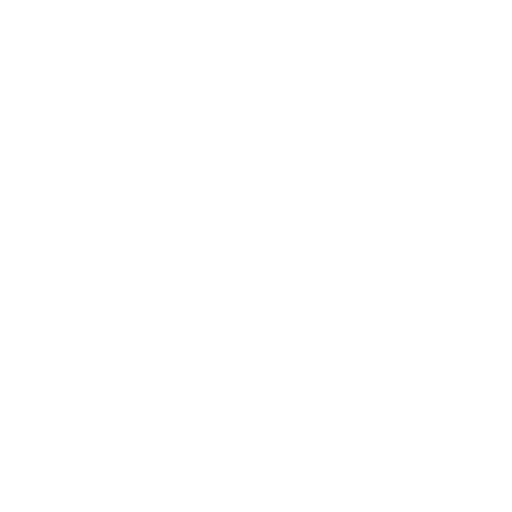0 avis
Église paroissiale Saint-Maxime ou Saint-Même
France > Nouvelle-Aquitaine > Charente > Saint-Même-les-Carrières
Historique
L'église Saint-Maxime ou Saint-Même, construite au 12e siècle, a été en grande partie détruite en 1569. Elle est restaurée dans la deuxième moitié du 17e siècle et au début du 18e siècle par Jean Bore, maître maçon, qui décéda en 1720, ainsi qu´en atteste sa pierre tombale (« ICY / GIST LE / CORPS DE JEAN / BORES MAITRE / ARCHIT[ec]/TE / QUI DECED DA [sic] LE V OCTOB[re] 1720 » (Nanglard donne par erreur une date de décès en 1680). Les restaurations s'achèvent dans la première moitié du 18e siècle, ainsi qu'en atteste la date 1731 sur la clef de voûte de la première travée de la nef. Les verrières sont l'œuvre de Élie Caillaud, peintre-verrier, en 1945. La sacristie construite en 1897 a été démolie après l´inscription de l´église à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (1991). Suite à la tempête de 1999, une campagne de restauration a été engagée (toitures, façade occidentale, mur sud de la nef).
Description
L´église Saint-Maxime ou Saint-Même est située en bordure nord du bourg de Saint-Même-les-Carrières, dans l´ancien diocèse de Saintes. Elle domine la vallée de la Charente qui coule au nord et est installée sur la rupture de pente.
D´ouest en est, l´église est constituée d´un porche extérieur adossé, fermé du côté ouest mais ouvert au nord et au sud, d´une nef de deux travées voûtées d´ogive, d´une travée sous clocher, plus étroite que la nef, couverte d´une coupole sur pendentifs, et d´un chœur constitué d´une courte travée droite et d´une abside semi-circulaire voûtée en cul-de-four. Une chapelle en partie ruinée, qui n´est pas un ancien transept, se trouve au sud de la deuxième travée de la nef. Une crypte gothique se trouve sous cette chapelle. Les hypothèses anciennes de l´existence de collatéraux et/ou d´un transept ne sont pas étayées par des éléments visibles sur place.
Le chevet est la seule partie romane conservée. Quelques-uns des chapiteaux intérieurs pourraient dater du Moyen Âge, en particulier ceux du chœur, ou même ceux du mur gouttereau sud de la nef, en partie masqués par ce mur. Mais il ne peut être exclu que nombre d´entre eux ne remontent qu´au 18e siècle, époque d´une réfection radicale de l´édifice.
Le porche adossé à l´ouest de la nef est couvert d´un berceau à peu près en plein cintre surmonté d´un toit en appentis. Il précède la façade du 18e siècle.
Une fenêtre est percée dans les deux travées de la nef, au nord comme au sud. Ces deux travées sont couvertes chacune d´un toit à long pans, celui de la première travée, à l´ouest, étant surélevé d´une assise depuis la dernière restauration au début des années 2000. Auparavant, la première travée était couverte d´un toit légèrement bombé pour épouser la forme de l´extrados de la voûte qui est plus élevé que celui de la deuxième travée. La remise à corbillard qui était adossée au sud de la première travée et la sacristie adossée au sud du clocher ont été détruites lors des mêmes travaux.
Les fenêtres de la travée sous clocher, au nord comme au sud, ont perdu leurs colonnettes, figurées sur le plan d´Abadie (1844), aussi bien à l´extérieur qu´à l´intérieur de l´église. La fenêtre sud a une archivolte ornée de pointes de diamant et une imposte ornée de dents de scie. La fenêtre nord est décorée de dents de scie sur l´archivolte et sur l´imposte. Le clocher de plan carré a été refait. Sa souche est surmontée d´une balustrade. Son étage, plus étroit que la souche, est percé d´une fenêtre en plein cintre sur chaque face. Au-dessus de la corniche s´élève une flèche conique en pierre, à écailles. Dans les angles, les amortissements modernes sont composés d´un petit pilier surmonté d´une boule.
La travée droite du chœur et l´abside sont rythmées par sept grandes arcades (alternativement aveugle et percée d´une fenêtre) séparées par des faisceaux de trois colonnes. Les colonnes externes portent les arcs en plein cintre, sauf celui de la première arcade sud qui est légèrement brisé. Les arcs sont surmontés d´une archivolte à décor géométrique (liserés, cordelettes, pointes de diamant, losanges, damiers, festons, etc.), comme les tailloirs des chapiteaux sur lesquels elles s´appuient. Les colonnes centrales, au-dessus des chapiteaux, sont surmontées d´une colonne un peu plus étroite qui monte jusqu'à une petite moulure qui devait souligner l´ancienne corniche (la corniche actuelle a été remontée une assise plus haut). Les trois fenêtres en plein cintre sont encadrées de colonnettes (celles de la baie d´axe ont disparu) à bases moulurées et à chapiteaux ornés de bagues. Leurs archivoltes, ornées de motifs géométriques, reposent sur des impostes à motifs en dents de scie qui surmontent les chapiteaux et se poursuivent jusqu'aux colonnes qui portent l´arcature.
Les deux travées de la nef sont séparées par des colonnes sur dosseret qui portent un arc doubleau peu brisé. Deux chapiteaux au moins se trouvent dissimulés sous le mur gouttereau sud de la deuxième travée de la nef, construit après coup. Les corbeilles des trois chapiteaux de la première pile, entre les deux travées de la nef - celle du centre de plan semi-circulaire à la base, les deux autres de forme cubique - sont tapissées uniformément de deux rangées superposées de marguerites à huit pétales. La première pile sud est couronnée de deux chapiteaux de plan semi-circulaire (celui du côté est aux deux tiers dissimulé par un mur) et deux autres de forme cubique. À l´imitation du chapiteau corinthien, les corbeilles sont revêtues de deux rangées superposées de feuilles d´acanthe, l´angle supérieur de la corbeille regardant le nord-est étant occupé par une tête encapuchonnée. La deuxième pile sud (pile sud-ouest de la travée sous clocher) se compose d´un chapiteau de forme cubique recouvert de quatre rangées de feuilles déposées en écailles et d´un chapiteau de plan circulaire (aux deux tiers caché par un mur) revêtu également de plusieurs rangées de feuilles et pourvu à l´angle supérieur de sa corbeille d´une tête humaine.
Les deux clefs de voûte de la nef datent de la restauration de l´église au début des années 1730. Celle de la première travée porte l´inscription en haut « F[ait] P[ar] M[oi] G. BOUNEAU » et en bas « 1731 » ; au centre se trouvent deux blasons (à gauche : de ... semé d´étoiles de ... au lion de ... brochant, et l´autre, à droite, de ... à cinq besants ou tourteaux de ... posés 2,2,1) surmontés d´une couronne de marquis. Selon l´auteur anonyme d´un article de la semaine religieuse d´Angoulême, ces blasons pourraient être ceux des familles de Culant (que Galbreith et Jequier donnent pour être d´azur semé de molettes d´or au lion du même brochant) et d´Auray de Brie, alliée à la précédente et seigneur du lieu. On sait par ailleurs que Marie-Gabrielle de Culant, fille de René-Alexandre de Culant, marquis de Culant, baron de Ciré, Saint-Même, le Grollet, Champfleury, etc., épousa à Saint-Même, le 5 février 1737, Joseph-Hector d´Auray, comte de Brie. Sur la clef de la deuxième travée sont gravés un cœur, sommé d´une croix, d´où jaillissent trois flèches dessinant entre elles des angles de 120°, deux branches feuillues entourant le cœur et l´inscription « UNUM ». Une tribune surmonte la première travée de la nef.
La travée sous clocher est encadrée de forts pilastres renforcés par deux colonnes jumelles. Ils portent les grands arcs doubleaux légèrement brisés à deux rouleaux et les arcs formerets à un seul rouleau.
Les chapiteaux recevant, au nord et au sud, le doubleau séparant la deuxième travée de la travée sous clocher sont complètement nus. Les chapiteaux recevant le doubleau séparant la travée sous clocher du chœur, très trapus, ont pour décor, au nord de longues tiges en forme de crosse s´entrecroisant et au sud une alternance de feuilles d´acanthe et de caulicoles. Le tailloir de ces chapiteaux est orné de billettes très courtes, décor qui se prolonge sur la corniche du chœur et qui se trouve également sur la corniche de la coupole de la travée sous clocher.
Le chœur est entouré de sept grandes arcades séparées par des colonnes engagées. Les chapiteaux, tous semblables, ont une corbeille engoncée dans une large feuille échancrée à sa partie supérieure et se terminant en crossette aux angles supérieurs de la corbeille. Les tailloirs sont ornés d´une rangée de plis. Les trois fenêtres sont encadrées de fines colonnettes à chapiteau nu.
Une chapelle en partie ruinée se trouve au sud de la deuxième travée de la nef, avec laquelle elle communiquait par un grand arc aujourd'hui muré et percé d´une simple porte. Son portail occidental a été mis en valeur par la démolition de la remise à corbillard. Dans l´angle sud-ouest se trouve un escalier en vis qui permettait probablement l´accès au clocher via les combles et une échelle extérieure visible sur les photographies anciennes. Le long du mur sud se trouve un escalier droit qui permet l´accès à la crypte. Celle-ci se compose d´une salle assez basse, encadrée de colonnes qui portent une voûte d´ogives à liernes. Deux soupiraux en abat-jour sont percés dans le mur sud et est, ce dernier étant aujourd'hui muré.
Localisation
Adresse: Nouvelle-Aquitaine , Charente , Saint-Même-les-Carrières
Milieu d'implantation: en village
Cadastre: 1813 A2 690, 1849 A7 1131, 2011 A 705