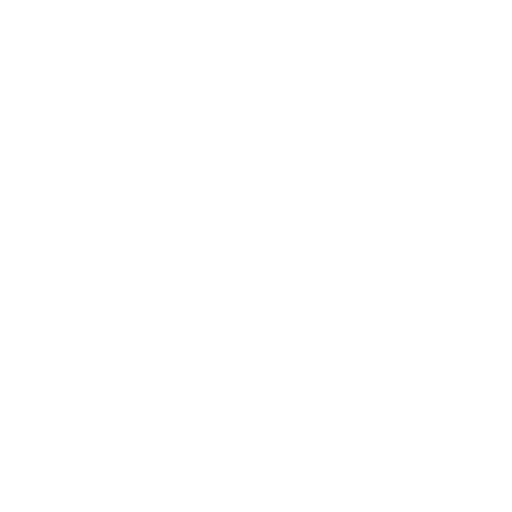0 avis
Historique
L'église Saint-Laurent de Romagne figure dans un document daté de 942 (cité par A. Lièvre). L'édifice actuel a été construit au 12e siècle, mais les seules parties romanes qui subsistent sont la travée droite du chœur et l'abside. Certains auteurs ont avancé une datation au 11e siècle ; le décor envahissant le tailloir du chapiteau de la fenêtre d´axe et le style des modillons sont plus en accord avec une datation dans le 12e siècle.
L'agrandissement de l´édifice par un collatéral nord terminé à l´est par une chapelle date plus vraisemblablement du 15e siècle voire du 16e siècle que du 14e siècle, comme cela est parfois mentionné, notamment si l´on se fie au décor des piles.
Dans la seconde moitié du 17e siècle, divers travaux sont réalisés sous la direction du curé Le Roy : réfection des portes et du cintre de la grande porte (1762), du clocher, des cloches, d´un pilier du chœur et de la voûte du chœur (suite à la chute du clocher, foudroyé en 1763).
Jusqu'à la Révolution, la cure était à la nomination du chapitre de Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers.
Au 19e siècle, l'église est restaurée à plusieurs reprises. En 1811, des tuiles sont remplacées puis en 1821, des ardoises et des tuiles. En 1853, des travaux sont exécutés par M. Degusseau pour réparer la voûte et la couverture de l'édifice. En 1865, Brouillet signale que la baie romane dans l´axe de l´abside est murée, ce qui a peut-être été réalisé au cours des travaux de 1853 pour soulager la voûte de l´abside. L´une des verrière au nord est signée P.G. POITIERS 1880. En 1886-1887, une nouvelle campagne de travaux est entreprise sous la direction de l'architecte Louis Chambert. La couverture de l'église est refaite ; le mur gouttereau sud est repris et doublé de quatre arcades à l'intérieur de la nef, afin de supporter la fausse voûte en berceau en brique de la nef que l'architecte envisage de réaliser. La couverture en tuile du collatéral nord est remplacée par des ardoises.
Suite à d´importants désordres architecturaux, le chœur a été renforcé par un cerclage de fer dans les années 1930. C´est au cours de cette campagne de consolidation qu´est mis en place le contrefort qui obstrue partiellement la fenêtre d´axe (elle avait été auparavant murée, sa désobstruction n´est pas mentionnée). Les halles en bois adossées au sud de l´église sont alors détruites. D´importantes fissures subsistent. Dans les années 1950, la voûte de la nef s´effondre : elle est reconstruite en brique et le soutènement du clocher est renforcé.
Description
L'actuelle église Saint-Laurent est située sur la place, au centre du village. De plan allongé, l'édifice se compose d'une nef avec un collatéral nord, d'un chœur à deux travées (une travée sous clocher et une travée droite) et abside semi-circulaire terminant le vaisseau principal. Le collatéral nord de quatre travées est terminé par une chapelle ouvrant sur la travée sous clocher. Les dimensions (non vérifiées lors de l´étude, données par Brouillet, 1865) sont les suivantes : 38m de long (y compris l´abside) pour la nef, 6 m de large, 5m de hauteur. La cure était, avant la Révolution, à la nomination du chapitre de Saint-Hilaire à Poitiers.
De l'édifice roman subsistent, en élévation, l´abside semi-circulaire, plus étroite que la travée droite du chœur, et vraisemblablement le mur gouttereau sud de la nef partiellement reconstruit lors des travaux de 1887.
Ce chœur, plus élevé que la nef, présente un appareil assisé en moellons équarris. Le mur sud de la travée sous clocher et de la travée droite est appuyé de trois contreforts de hauteurs différentes. Une large fenêtre couverte en arc segmentaire éclaire la travée sous clocher. La travée droite était éclairée par une étroite fenêtre en plein cintre aujourd'hui murée (fig. 18).
L'abside est épaulée d'un contrefort qui occulte partiellement la baie axiale, construit dans les années 1930. L'archivolte qui la surmonte est prolongée, sur le pourtour, d'un cordon orné de billettes. Une porte couverte en plein cintre a été aménagée dans le flanc nord de l'abside : elle donne accès à la sacristie qui a pris place dans l´ancien chœur de l´église. La maçonnerie présentant des désordres, le chevet a été cerclé, également dans les années 1930.
La fenêtre et les modillons du chevet sont ornés de sculptures (cf. annexe 1).
Le collatéral nord, construit vers le 15e siècle, ouvre à l'est sur une chapelle légèrement saillante accotée à la travée droite du chœur.
La transformation du bâtiment originel est soulignée, extérieurement, par les toitures distinctes : toit à deux pans pour la nef ; toit à un versant pour le collatéral. Ce dernier est éclairé par trois baies en plein cintre, de hauteurs différentes, percées dans le mur nord épaulé par ailleurs de trois contreforts à ressaut. Le mur gouttereau sud de la nef est en revanche aveugle ; il est dépourvu de contrefort mais renforcé à l'extérieur, vers l'est au niveau des troisième et quatrième travées, sur les deux tiers de sa hauteur, d'un second mur. Côté interne, ce mur supporte de grandes arcades plus profondes que celles des première et deuxième travées. Des traces d'arcades en plein cintre, reposant sur des supports en pierre de taille, sont visibles à l'extérieur dans les deux premières travées occidentales du mur gouttereau. Elles correspondent aux arcades plaquées à l'intérieur de la nef.
La façade occidentale de l'église reflète, par son asymétrie, l'agrandissement de l'édifice. Le mur pignon du vaisseau primitif, cantonné de deux contreforts, est percé d'un portail à une voussure brisée, composée de deux rouleaux et sommée d'une archivolte. À la base de l´archivolte se trouvent deux éléments ornés d´un visage sculpté, probablement des remplois. Le portail est surmonté d'un oculus quadrilobé. Trois autres éléments sculptés, en remploi, se trouvent sur la façade : l´un, orné d´un visage, au-dessus de la clef du portail, les deux autres (dont un visage) de part et d´autre du mur pignon, à peu près au niveau de la base de l´oculus.
Le mur pignon est appuyé, au nord, du mur fermant le collatéral. Il est percé d'une petite porte couverte en plein cintre surmontée d'un arc en accolade. Une fenêtre en plein cintre se trouve en haut à gauche de cette porte latérale.
La première travée est plus courte que les trois travées suivantes (5 m au lieu de 6).
Les quatre travées de la nef sont couvertes d'une fausse voûte en berceau surbaissé en brique. Le couvrement repose, au sud, sur le mur gouttereau épaulé de quatre profondes arcades en plein cintre (construites en 1887) et, au nord, sur les quatre piles quadrangulaires reliées par de grandes arcades brisées qui séparent la nef du collatéral. Ce dernier compte quatre travées couvertes chacune d'une voûte sur croisée d'ogives. Les ogives retombent sur les supports dépourvus de chapiteaux ; toutefois, les piles sont ornées, aux angles sud-est et sud-ouest, de masques ou de grotesques. Le collatéral s'ouvre, à l'est, sur une chapelle également voûtée d'une croisée d'ogives. Elle est éclairée par une fenêtre couverte en plein cintre, au nord, et, à l'est, par une large baie à deux lancettes et trilobe. Des traces de décor peint sont encore visibles sur le mur nord de la chapelle.
La chapelle, peu profonde, communique par une arcade brisée avec la travée sous clocher, aujourd'hui chœur de l'église.
La disposition du chœur roman a été modifiée par l'édification d'une cloison. La travée sous clocher, qui abrite l'autel, est devenue le chœur de l'église actuelle ; l´ancienne travée droite du chœur et l'abside romane servent aujourd'hui de sacristie. Elles sont couvertes d'une voûte en berceau plein cintre supportée par trois arcs doubleaux reposant sur des pilastres plats. L'abside, couverte d'une voûte en cul-de-four, est éclairée par une baie axiale couverte en plein cintre. Elle est flanquée de deux colonnettes dont les chapiteaux sont ornés de motifs végétaux.
Une cave voûtée, dont l'ouverture se trouve sur la place publique, est signalée en 1894 sous l'église.
Détail de la description
| Murs |
|
|---|---|
| Toits |
|
| Plans |
plan allongé |
| Étages |
2 vaisseaux |
| Couvrements |
|
| Couvertures |
|
| État de conservation |
|
| Décors/Technique |
|
Informations complémentaires
| Type de dossier |
Dossier d'oeuvre architecture |
|---|---|
| Référence du dossier |
IA86007775 |
| Dossier réalisé par |
Dujardin Véronique
Chercheur, service Patrimoine et Inventaire Sarrazin Christine |
| Cadre d'étude |
|
| Aire d'étude |
Civray |
| Phase |
étudié |
| Date d'enquête |
2010 |
| Copyrights |
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel |
| Citer ce contenu |
Église paroissiale Saint-Laurent, Dossier réalisé par Dujardin Véronique, (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/abcc7b61-8cf5-4b13-b410-ddbd3c531127 |
| Titre courant |
Église paroissiale Saint-Laurent |
|---|---|
| Dénomination |
église paroissiale |
| Vocable |
saint Laurent |
| Statut |
|
|---|---|
| Protection |
|
Localisation
Adresse: Nouvelle-Aquitaine , Vienne , Romagne
Milieu d'implantation: en village
Cadastre: 1837 G7 1221, 2010 K 857