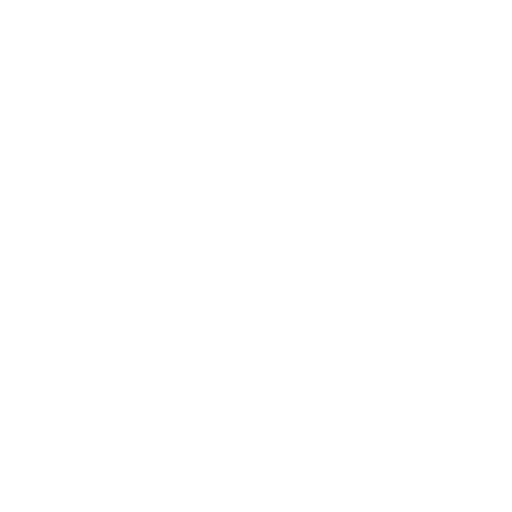Historique
C´est dans une charte de l´abbaye de Nouaillé datée de 903 qu´apparaît la première mention de la viguerie de Brion " Vicaria Brionensis in pago pictavo " [Rédet, Dictionnaire, 1881, p. 63]. Toutefois, les vestiges d´une villa gallo-romaine découverts au 19e siècle attestent de l´ancienneté de l´occupation du territoire.
La viguerie de Brion semble peu étendue et relève du pagus de Brioux-sur-Boutonne. À la fin du 10e siècle ou au début du 11e siècle, le comte de Poitou réorganise le territoire en favorisant de nouvelles places fortes. L´ancienne circonscription carolingienne de Brion est absorbée par Gençay, où s´élève un château relevant du comte. Dans une charte datée des environs de 1080, Brion est cité à la fin du 11e siècle dans la vicairie de Gençay " in vacaria castri genciaci " (Rédet, Cartulaire, 1874, p. 216).
L´église Saint-Martin de Brion apparaît également dans les textes à la fin du 11e siècle. Elle est mentionnée dans la charte de l´évêque de Poitiers Pierre II confirmant à l'abbaye Saint-Cyprien de Poitiers la possession des églises acquises par l'abbé Rainau ou ses prédécesseurs (Rédet, Cartulaire, 1874, p.13). L´existence d´un lieu de culte chrétien plus ancien est cependant attestée par la présence de sarcophages mérovingiens et carolingiens découverts près de l´actuelle église. À l´époque médiévale, l´église sert peut-être de refuge, plusieurs salles étant aménagées sous le chœur.
En partie ruinée lors des guerres de religion, l´église Saint-Martin est restaurée au 17e siècle et dotée d´objets liturgiques. Le support du bénitier (protégé au titre des objets mobiliers en 1966) porte la date de 1665, l´inscription " P. Tercier " et un blason.
En 1789, Brion, qui relève sous l´Ancien Régime de l´archiprêtré de Gençay et dépend de la sénéchaussée de Gençay, devient une commune, ainsi que la paroisse d´Ayroux, dont l´église était une annexe de Saint-Martin de Brion. En 1808, la cure de Brion est réunie à celle de Saint-Secondin ; elle est à nouveau érigée en succursale en 1840.
L´église menaçant ruine, des travaux sont entrepris dans le troisième quart du 19e siècle. Le lieu de culte étant jugé trop petit, il est envisagé, outre la restauration, un agrandissement de l´édifice. M. Ferrand, architecte de l´inspection diocésaine de Poitiers, propose la construction de deux chapelles au nord et au sud de la nef. En 1869, M. Pineau, conseiller municipal de Brion, fait un don de 2 500 francs à la commune et le ministère des cultes accorde une aide 1 400 francs ; la somme réunie permet la construction d´une première chapelle. Les travaux engagés se poursuivent les années suivantes sur les parties dégradées de l'édifice comme la façade occidentale, qualifiée de « type convenable de façade d´église romane » en 1875 par l´archéologue A. Touzé de Longuemar (1884, p. 47). Le sol autour de l´église est nivelé, révélant les sarcophages de l´ancien cimetière.
La seconde chapelle est édifiée plus tardivement grâce à deux autres legs reçus par la commune en 1884 et 1888. En 1901, la commune demande une aide pour la restauration du clocher, un « campanile à double baie » (Touzé de Longuemar, 1884, p. 47). L´église bénéficie dans les années1980 d´un legs donné à la commune pour la réfection des enduits intérieurs (source orale).
Description
L'église Saint-Martin de Brion est située au cœur du bourg. De plan allongé, et orientée est-ouest, elle se compose d´une nef unique trois travées, de deux chapelles ouvrant au nord et au sud de la troisième travée de la nef, d´un chœur à travée droite et abside demi-circulaire. À l'exception du soubassement de la façade occidentale et de la chapelle nord, qui présentent un parement en pierre de taille, les murs de l'église ont été construits en moellons de calcaire et recouverts d´enduit ; seule l´abside de la chapelle sud est en moellons apparents. L´édifice est couvert d'une toiture en ardoise.
L'église a subi, dans la seconde moitié du 19e siècle, une importante restauration qui a affecté son plan et, vraisemblablement, l'élévation de la nef ; les deux chapelles latérales ont été construites, la façade et les murs gouttereaux de la nef ont été repris ainsi que la toiture. Sur le plan cadastral de 1812, elle est composée d'une nef et d'un chœur à abside demi-circulaire sur lequel ouvre, au nord-est, un petite construction carré. La partie orientale de l'édifice, moins altérée par cette campagne de travaux, conserve des éléments romans.
L'église ouvre à l'ouest par une façade-pignon encadrée par deux contreforts et sommée d'un clocher-mur à deux baies. Elle est divisée en deux niveaux par une corniche ornée d´un damier et supportée par des modillons modernes sculptés d´animaux, de végétaux, inspirés du vocabulaire décoratif roman. L´axe vertical de la façade est fortement marqué par la superposition des ouvertures : portail au rez-de-chaussée, baie jumelle couverte en plein cintre au second niveau et clocher-mur épaulé par deux étroits contreforts-pilastres.
Le portail couvert en plein cintre à tympan sans décor est encadré, sur la moitié supérieure, de deux colonnes trapues. Ces dernières reposent sur un haut soubassement en pierre de taille. La voussure comprend deux rouleaux et une archivolte à crossettes s´interrompant à hauteur des sommiers du rouleau externe ; l´archivolte et la partie biaise de l´arc interne sont ornées de motifs géométriques. Ce portail du 19e siècle pastiche les portails romans dont il présente des éléments caractéristiques comme l'arc en plein cintre ou le tympan. Ce dernier, très rare dans les églises romanes du Poitou, est fréquemment employé dans l'architecture romane d'autres régions.
Les élévations nord et sud de la nef ont également été remaniées. Elles sont percées de deux baies modernes couvertes en plein cintre éclairant les deux premières travées de la nef. Une corniche soutenue par des modillons modernes nus couronne les murs. La troisième travée de la nef est flanquée de deux chapelles latérales de composition différente : travée droite et abside demi-circulaire au sud ; travée droite et abside polygonale au nord. Les deux annexes sont plus basses que la nef ; elle sont sensiblement de même hauteur que le chevet roman.
Le chevet est la partie la mieux conservée de l'édifice roman. Il comprend une travée droite et une abside épaulée, au sud-est, par des contreforts plats ; un bâtiment est accoté à l'élévation nord du chevet. Le sanctuaire est éclairé de deux baies couvertes en plein cintre percées l'une dans le mur sud de la travée droite, la seconde dans l'abside ; cette dernière ouverture est dotée d´un réseau néo-gothique. Une petite baie couverte en plein cintre aménagée dans la partie sud de l´abside a été murée.
La corniche qui couronne les murs est supportée, au sud et à l´est, par des modillons récemment restaurés ; ils sont ornés de sculptures romanes représentant majoritairement des animaux et décrite dans l'annexe concernant le décor sculpté du chevet roman. Le chevet est couvert d'un toit à croupe ronde.
L'intérieur de l'édifice, auquel on accède par le portail occidental, témoigne aussi de la restauration du 19e siècle. Le vaisseau unique de la nef, à trois travées, est couvert de voûtes d´ogives quadripartites reposant sur des consoles nues. La troisième travée de la nef communique par deux larges arcades brisées avec les chapelles latérales construites dans les années 1870/1890. Au sud, la chapelle se compose d´une courte travée droite couverte d´une voûte d´ogives quadripartite et d´une abside couverte d´une voûte d´ogives à trois quartiers reposant sur des consoles sculptées. La chapelle nord présente un couvrement identique. Elle conserve, encastrée dans le mur est, la dalle funéraire de la demoiselle Charlotte Boipaille, dame de la Rognouse et de la Baumière, décédée le 25 mai 1606. La dalle porte une représentation féminine gravée.
Le chœur, qui ouvre directement sur la nef, se compose d'une travée droite et d'une abside légèrement plus étroite que la travée. Elles sont couvertes de voûtes d´ogives (quadripartite pour la travée droite, à trois quartiers pour l'abside) reposant sur des culs-de-lampe portant un décor sculpté (têtes humaines, personnages). L'autel, surélevé, est éclairé par la large baie en plein cintre de l'abside, qui a été dotée d'un réseau néo-gothique, et celle du mur sud de la travée droite. Les vitraux de la baie d'axe représentent saint Louis et un évêque. Dans le mur nord de la travée droite, une porte communique avec la sacristie.
Détail de la description
| Murs |
|
|---|---|
| Toits |
|
| Plans |
plan allongé |
| Étages |
1 vaisseau |
| Couvrements |
|
| Couvertures |
|
| Décors/Technique |
|
| Décors/Représentation |
Précision sur la représentation : Le décor de la façade est moderne. Les modillons romans du chevet sont présentés dans l'annexe concernant les parties romanes de l'église. |
Informations complémentaires
| Type de dossier |
Dossier d'oeuvre architecture |
|---|---|
| Référence du dossier |
IA86008028 |
| Dossier réalisé par |
Dujardin Véronique
Chercheur, service Patrimoine et Inventaire Sarrazin Christine |
| Cadre d'étude |
|
| Aire d'étude |
Civray |
| Phase |
étudié |
| Date d'enquête |
2010 |
| Copyrights |
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel |
| Citer ce contenu |
Église Saint-Martin, Dossier réalisé par Dujardin Véronique, (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/b8497442-93ab-4537-8fdd-6b22cb856603 |
| Titre courant |
Église Saint-Martin |
|---|---|
| Dénomination |
église |
| Vocable |
saint Martin |
| Statut |
|
|---|
Localisation
Adresse: Nouvelle-Aquitaine , Vienne , Brion , rue de la Viguerie
Milieu d'implantation: en village
Cadastre: 1812 B2 398, 2009 AC 1