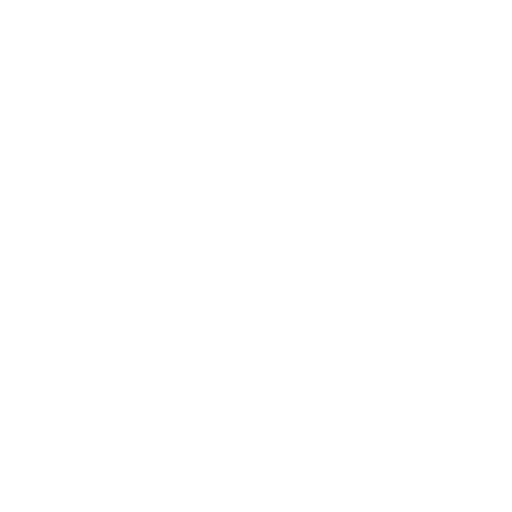Église paroissiale Saint-Martin
France > Nouvelle-Aquitaine > Charente > Gensac-la-Pallue
Historique
Au Moyen âge, et jusqu'à la Révolution, la paroisse Saint-Martin de Gensac (Gensiaco) relève du diocèse de Saintes ; la cure est à la nomination de l'évêque.
L'actuelle église Saint-Martin est édifiée vraisemblablement au cours du second quart du 12e siècle ; cette datation est suggérée par le décor sculpté de la façade, qui s'inspire de la façade de la cathédrale d'Angoulême (réalisée entre 1120 et 1135 environ), et les " colonnes baguées " du troisième niveau, fréquemment utilisées en Saintonge dans la première moitié du 12e siècle (cf. Lacoste, p. 185).
Au cours du 13e siècle, le chœur est reconstruit, comme en témoignent les baies et les voûtes sur croisées d'ogives du sanctuaire. L'édifice, ruiné pendant les guerres de Religion, est restauré au 17e siècle. Entre 1724 et 1740, des travaux sont à nouveau réalisés, au cours desquels les coupoles sont reprises.
En 1803, la paroisse Saint-Martin à Gensac est maintenue. Elle est confirmée en 1805 et en 1807, avec La Pallue comme annexe. En 1813, le cimetière s'étend au nord et à l'ouest de l'église ; en 1853, la commune achète un terrain pour y construire un nouveau cimetière, dont les travaux sont achevés en 1860.
Des travaux sont entrepris sur l'église Saint-Martin en 1838 et en 1846. Puis, entre 1847 et 1854, une importante campagne de restauration est menée par l'architecte Paul Abadie. Les relevés de l'architecte, réalisés en 1844, montrent une façade dégradée, dépourvue de clochetons. P. Abadie intervient à nouveau en 1882 pour reconstruire le clocher, détruit par la foudre. Au cours du 20e siècle, les bâtiments adossés au mur sud de l'église sont détruits ; des travaux d'entretien et de restauration ont également été réalisés.
Depuis 1862, l'église Saint-Martin est classée au titre des monuments historiques.
Détail de l'historique
| Périodes |
Principale : 2e moitié 12e siècle Principale : 2e quart 18e siècle Principale : 2e quart 19e siècle Principale : milieu 19e siècle Principale : 4e quart 19e siècle |
|---|---|
| Dates |
1724, daté par source 1738, daté par source 1739, daté par source 1740, daté par source 1838, daté par source 1846, daté par source |
| Auteurs |
Auteur :
Abadie Paul fils, architecte |
Description
Construite selon un plan allongé, l'église Saint-Martin est composée d'une nef unique, couverte de quatre coupoles, prolongée d'un chœur à chevet plat. Elle se rattache à ce groupe d'édifices construits dans les diocèses d'Angoulême et de Saintes au cours du 12e siècle qui imitent le modèle de la nef unique à file de coupoles introduit en Angoumois lors de la construction de la cathédrale Saint-Pierre à Angoulême. Les parements extérieurs et intérieurs des murs sont en pierre de taille, comme cela est fréquent en Angoumois et en Saintonge.
La façade de l'église est organisée en trois niveaux surmontés d'un pignon flanqué, de chaque côté, de deux clochetons circulaires construits dans la seconde moitié du 19e siècle par l'architecte Paul Abadie. Un portail couvert d'une voussure comprenant trois rouleaux en plein cintre et une archivolte retombant sur les piédroits à deux ressauts, garni chacun d'une colonne, s'ouvre au centre du premier niveau. Il est encadré de deux arcades aveugles couvertes d'un arc à ressaut en plein cintre. Ce premier niveau a été restauré par Paul Abadie ; le portail, les arcades aveugles et les sculptures qui les ornent on été en partie repris.
Une corniche marque la séparation avec le deuxième niveau. Ce dernier est rythmé par cinq arcades en plein cintre reposant sur des colonnettes doubles aux chapiteaux sculptés ; le niveau est ajouré d'une baie en plein cintre inscrite dans l'arcade centrale, les quatre autres étant aveugles.
Au registre supérieur, les arcades aveugles, au nombre de sis, sont plus étroites et moins hautes que celles du niveau intermédiaire. Les colonnettes doubles de l'arcature sont dépourvues de chapiteaux : le fût monolithe est orné, en partie haute, de trois anneaux superposés, sculptés sous l'abaque quadrangulaire. Ce niveau est un peu moins large que les deux autres.
Le jeu des arcatures plus ou moins larges, plus ou moins hautes, anime la façade tout en accentuant l'élancement vers le haut. Cette ornementation architecturale est complétée par le décor sculpté porté par les chapiteaux des colonnes ; au rez-de-chaussée, il se déploie également sur les bandeaux qui les prolongent, et sur les deux reliefs insérés au-dessus des arcades aveugles qui représentent, au nord, l'Assomption de la Vierge et, au sud, l'ascension d'un évêque, vraisemblablement saint Martin. Les sculptures sont absentes des claveaux des arcs et des voussures. Plusieurs d'entre elles, reconnaissables au bon état de conservation de la pierre, ont été refaites lors de la campagne de restauration réalisée au milieu du 19e siècle.
Les élévation latérales de l'édifice distinguent une nef de trois travées et une travée sous clocher. Cette séparation n'apparaît pas à l'intérieur de l'église : la nef est unifié par la suite de quatre coupoles couvrant les quatre travées qui précèdent le chœur, et les murs gouttereaux sont confortés par une arcature aveugle continue qui porte une coursière aménagée (filant) sous l'appui des baies des quatre travées.
Les murs des trois première travées la nef sont scandés par quatre contreforts à ressaut terminés par un larmier. Ils sont éclairés par trois baies en plein cintre flanquées de colonnettes dont les tailloirs sont prolongés en cordon entre chaque contrefort. Les murs ont été rehaussés lors des restaurations du 19e siècle : selon le relevé de P. Abadie (1844), le toit antérieur reposait juste au-dessus des contreforts. Cette modification des élévations a accentué la différence entre les trois premières travées et la quatrième qui porte le clocher.
Afin de soutenir ce dernier, composé d'une base ornée d'une arcature aveugle (romane) et d'une haute flèche octogonale en pierre cantonnée de clochetons portés par des faisceaux de colonnettes (refaits au cours du 19e siècle), la partie haute du mur devient, au niveau de la coupole, un glacis. On accède au clocher par un escalier en vis hors-œuvre, construit au nord de l'édifice, au droit de la jonction entre le chœur et la travée.
Le chœur à chevet plat termine l'église. Deux contreforts à glacis très accentué épaulent le mur sud, éclairé par deux hautes baies brisées. Au nord, les baies sont identiques, le mur étant soutenu par un contrefort et la tour d'escalier du clocher. Les angles nord-est et sud-est du chevet sont confortés par des contreforts d'angle.
L'homogénéité extérieure de l'édifice, qui présente des élévations latérales presque identiques, se retrouve à l'intérieur. La nef comprend quatre travées couvertes chacune par une coupole sur pendentifs ; la base des coupoles des deuxième et troisième travées est ornée d'un damier [sur le relevé de P. Abadie, ce sont les bases des coupoles des première et deuxième travées). Les voûtes sont portées par des arcs doubleaux en plein cintre et par des arcs formerets légèrement brisés. Les arcs retombent sur les piliers, composés d'une colonne engagée sur dosseret, qui rythment les travées de la nef. Entre chaque supports de voûte, deux arcades aveugles confortent les murs gouttereaux. Cette arcature aveugle monte au niveau des chapiteaux des piliers. Comme à la cathédrale Saint-Pierre à Angoulême, une coursière continue surmonte l'arcature aveugle ; des passages ont été aménagés dans l'épaisseur des murs derrière chaque pilier.
Chaque travée est éclairée, au nord et au sud, par une baie en plein cintre percée dans la partie haute des murs.
L'intérieur de la nef, repris aux 18e et 19e siècles, est sobrement orné par le jeu de l'arcature aveugle, la modénature des tailloirs et des bases, les modillons portant la coursière. Le chapiteau de la colonne nord-est de la troisième travée, décoré de feuillage formant une volute d'angle, les chapiteau à feuillage de la colonnette gauche de la baie nord de la seconde travée et du chapiteau droit de la baie sud de la troisième travée, porte le seul décor sculpté de la nef. Le recours à la pierre de taille, le rythme des arcades qui animent les murs pallient cette absence d'ornementation tout en conférant à la nef une grande unité et une relative austérité.
Au-delà de la quatrième travée de la nef, qui porte le clocher, se développe le chœur à chevet plat. Plus larges que celles de la nef, les deux travées qui le composent sont couvertes de voûtes sur croisées d'ogives. Trois marches permettent d'accéder à la seconde travée, dont le sol a été surélevé à une date indéterminée.
Elles sont largement éclairées par des hautes baies à lancettes. Au nord et au sud, les fenêtres de la première travée de chœur ont été en partie murées lors de la réalisation de deux retables architecturés. La baie du chevet, dont la partie basse est également murée, diffère des quatre autres par le nombre de lancettes (trois au lieu de deux) et d'oculus (trois à l'est, un pour les fenêtres latérales).
Plusieurs niches et passages ont été créés dans les murs du chœur. À gauche de l'autel latéral nord, une porte couverte d'un arc surbaissé communique avec l'escalier qui dessert le clocher. Au nord et au sud, deux passages murés ont permis une communication avec l'extérieur de la nef, à une date antérieure à 1844 car ils n'apparaissent pas sur les relevés de P. Abadie. La hauteur des reprises du parement extérieur, qui correspond à ces ouvertures, peut signaler une différence de niveau de sol par rapport à aujourd'hui. Au nord, ce passage communiquait avec l'ancien cimetière qui, jusqu'au 19e siècle, jouxtait l'église.
Dans le mur est, ont été aménagés au nord, une niche (peut-être une ancienne porte ?) et au sud, une porte donnant accès à la sacristie adossée au chevet. Dans le mur sud de la deuxième travée prend place un lavabo double.
Détail de la description
| Murs |
|
|---|---|
| Toits |
|
| Plans |
plan allongé |
| Étages |
1 vaisseau |
| Couvrements |
|
| Couvertures |
|
| Escaliers |
|
| État de conservation |
|
| Décors/Technique |
|
| Décors/Représentation |
Précision sur la représentation : La façade concentre la presque totalité du décor sculpté de l'édifice. Au rez-de-chaussée, il est essentiellement porté par les chapiteaux des colonnes du portail et des arcades qui le flanquent, et par le bandeau régnant à même hauteur. S'y déploient des entrelacs de feuillages, des animaux entrecroisés et trois scènes figurées dont le sacrifice d'Isaac sur le bandeau gauche. Au-dessus des arcades aveugles, deux reliefs présentent, à gauche, l'Assomption de la Vierge et, à droite, l'Ascension de saint Martin, à qui l'église est dédiée. Au deuxième niveau, les chapiteaux sont aussi ornés d'entrelacs de feuillages, d'animaux et de scènes figurées. Sur le chapiteau gauche de l'arcade qui encadre la baie d'axe, sont représentés un évêque (ou un abbé) bénissant devant qui se prosternent trois personnes, une quatrième se tenant debout derrière eux. À droite de la baie, sur l'avant-dernier chapiteau droit, est figuré un homme encadré par deux oiseaux dont il serre les cous. Au troisième niveau, les tailloirs portent un décor de feuillages et, sur les modillons, sont représentés des têtes animales, des têtes humaines, un musicien... |
Informations complémentaires
L'église Saint-Martin à Gensac-la-Pallue (en Charente) présente une nef couverte d'une file de coupoles, ainsi qu'une façade richement animée par une série d'arcatures. On peut également remarquer les deux reliefs du premier niveau qui représentent l'Assomption de la Vierge et saint Martin.
Construite au 12e siècle, l'église Saint-Martin est composée d'une nef unique et d'un chœur à chevet plat (chœur rectangulaire), reconstruit au 13e siècle. Les quatre travées de la nef sont chacune couvertes par une coupole sur pendentifs. Les murs de la nef sont doublés par des arcades aveugles. Celles-ci sont surmontées par une coursière passant derrière les piliers engagés des murs de la nef. Une très grande sobriété règne à l'intérieur de l'église, où la sculpture est presque absente.
Tel n'est pas le cas de la façade qui a fait l'objet d'un décor particulièrement soigné. La façade est animée par une superposition d'arcatures. Au rez-de-chaussée ouvre le portail, encadré par deux arcades aveugles. Le registre intermédiaire compte cinq arcades, celle du centre étant ajourée par une baie en plein cintre. Le niveau supérieur est orné de six arcades aveugles, plus étroites et plus petites que les précédentes. Ce jeu d'arcatures joue avec la perspective et donne à la façade une impression de grande hauteur.
La sculpture souligne ce décor d'architecture. Au rez-de-chaussée, les arcades latérales et le portail sont réunis par un bandeau sculpté où se déploie un décor de rinceaux parfois habités d'animaux. Deux scènes religieuses (le sacrifice d'Isaac, Samson et le lion) sont également représentées sur le bandeau intérieur de l'arcade gauche.
Deux reliefs dominent les arcades latérales : l'Assomption de la Vierge, à gauche, et saint Martin, à droite. Les deux personnages sont debout dans une mandorle (forme en amande) soutenue par des anges, dont les corps épousent les courbes. Le mouvement de leurs corps s'oppose à la position hiératique de la Vierge et de saint Martin.
La sculpture est également présente sur les chapiteaux du deuxième niveau où sont figurés des animaux et des végétaux. Un groupe de trois personnages s'inclinant devant un évêque ou un abbé illustre le chapiteau gauche de la baie.
| Type de dossier |
Dossier d'oeuvre architecture |
|---|---|
| Référence du dossier |
IA00042086 |
| Dossier réalisé par |
Riou Yves-Jean
Dujardin Véronique Chercheur, service Patrimoine et Inventaire Sarrazin Christine |
| Cadre d'étude |
|
| Aire d'étude |
Pays Ouest-Charente - pays du Cognac |
| Phase |
étudié |
| Date d'enquête |
1984 |
| Copyrights |
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel |
| Citer ce contenu |
Église paroissiale Saint-Martin, Dossier réalisé par Riou Yves-Jean, (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/ba878a93-4c18-4270-928b-4cda0ab521b0 |
| Titre courant |
Église paroissiale Saint-Martin |
|---|---|
| Dénomination |
église paroissiale |
| Vocable |
saint Martin |
| Statut |
|
|---|---|
| Protection |
|
Localisation
Adresse: Nouvelle-Aquitaine , Charente , Gensac-la-Pallue
Milieu d'implantation: en village
Cadastre: 1850 B 745, 2011 AN 130