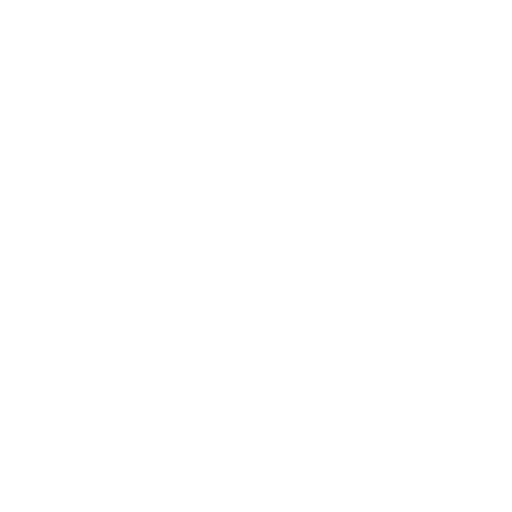0 avis
Abbaye de chanoines réguliers de saint Augustin, dite abbaye Notre-Dame
France > Nouvelle-Aquitaine > Vienne > Fontaine-le-Comte
Historique
La date de fondation de cette abbaye est imprécise, elle se situe entre 1126 et 1136, lors du règne de Guillaume VIIIe comte de Poitou, Xe duc d´Aquitaine, qui légua ses terres à Geoffroy de Loriol pour y installer une communauté religieuse. Si la donation fit l´objet de controverses avec l´abbaye cistercienne de Bonnevaux, Geoffroy de Loriol parvint à fonder l´abbaye avant de devenir, en 1136, archevêque de Bordeaux et y fit établir des chanoines réguliers, de l´ordre de saint Augustin. Cette collégiale prend rapidement le vocable de Notre-Dame des Fontenelles. La guerre de Cent ans occasionna l´incendie de l´abbatiale par les habitants de la commune et des environs, la voûte de la nef fut ruinée et laissée sans couverture pendant plusieurs siècles.
Après le Traité de Brétigny (1360), le prince de Galles ordonna au sénéchal du Poitou d´intervenir auprès des habitants de Poitiers et des environs pour faire réparer l´église et plusieurs maisons de Fontaine-le-Comte qu´ils avaient incendiées, pour éviter que l´ennemi s´y retranche.
A la fin du 14e siècle, l´abbatiale possédait vraisemblablement, un sol carrelé figuratif. Suite aux destructions subies lors de la guerre de Cent ans, une accalmie permit d´amorcer une période de reconstruction qui débuta lorsque Guy Doucet fut élu abbé, en 1435. Pour protéger l´abbaye des tumultes de l´époque, il fut entrepris de fortifier l´ensemble. De cette période subsistent les écus avec les armes de l´abbé Guy Doucet figurant au-dessus du portail de l´abbatiale, sur la bretèche à mâchicoulis et sur le portail de l'infirmerie. Le mur sud, mis à bas pendant la guerre de Cent ans, fut reconstruit à l´époque de Guy Doucet (voir la reprise de l´appareil). Les archives montrent que le pignon de la façade a été également reconstruit vers 1435 et percé plus tard (baie datant du 15e siècle).
Abbé de 1471 à 1502, François Ardillon poursuivit la campagne de restauration : réfection des voûtes des bras du transept et de la croisée, construction d´un chemin de ronde sur le chevet. Si la voûte en berceau brisé du bras nord est entièrement refaite au 19e siècle et celle du bras sud a subi de nombreuses rénovations (1982), l´écusson de l´abbé F. Ardillon situé au sommet prouve que la construction remonte au 15e siècle. Pareillement, la voûte en cul-de-four du choeur, en partie reconstruite en 1825 et restaurée en 1980, date sans doute du 15e siècle. Cette période de construction donna également lieu à la restauration et l´exhaussement de la façade (avec sa baie ogivale) ainsi qu´à la construction d´un chemin de ronde sur le chevet.
Au 16e siècle, les guerres de religion furent à l´origine de la destruction du toit de l´église. Au milieu du 17e siècle, François le Veneur relève l´abbaye et, le 15 juin 1647, passe un concordat avec P. Blanchard, supérieur général des chanoines régulier de sainte Geneviève pour que la congrégation de Génovéfains prenne possession de l´abbaye et en entreprenne la restauration. Il faut attendre le début du 18e siècle (1716-1718 ?) pour que la nef soit couverte d´une charpente et d´une voûte en bois ; c´est à cette même époque que les bâtiments sont restaurés et qu´un nouveau mobilier est installé. L'une des deux niches du choeur (mur sud), servant à placer les objets cultuels, a été obstruée par la pose des stalles commandées et réalisées par les chanoines de sainte Geneviève en 1720.
L´abbaye des chanoines de l´ordre de saint Augustin fut supprimée en 1756 en raison de son état d´indigence. Elle fut alors rattachée à Saint-Hilaire-de-la-Celle de Poitiers.
Au cours du 19e siècle, de nombreux travaux de restauration furent effectués. La nef, recouverte jusqu´en 1975 d´une voûte en brique construite au 19e siècle, est aujourd´hui remplacée par une structure en bois. Cette voûte est probablement plus proche du système originel car, les piliers de soutien n'étant pas d´origine, l´absence d´importants contreforts extérieurs ne permettait pas aux murs de soutenir une voûte en pierre. La partie supérieure du chevet (les modillons situés en haut des contreforts) a été refaite lors de la destruction en 1980 du chemin de ronde, qui menaçait, par son poids, la voûte en cul-de-four, aujourd'hui affaissée.
Description
Cet édifice, construit en belle pierre d´un moyen appareil, se caractérise, sur la partie supérieure des murs, par des reprises témoignant des diverses réparations qui ont été faites.
Ce bâtiment présente un plan cruciforme simple.
L´entrée est délimitée par un parvis, accessible par un escalier de cinq marches, qui était autrefois couvert (voir Rédet). Un corbeau est encore visible sur cette façade à gauche. La porte, unique, orientée à l´ouest est surmontée d´un arc en plein cintre, sans tympan. Son encadrement se compose de trois voussures ornant son cintre arrondi, retombant sur six petites colonnes non homogènes : celles du côté gauche ont le chapiteau orné de feuillages, celles du côté droit, n´offrent que de simples bandes en saillie l´une sur l´autre.
Ce portail est surmonté d´une niche trilobée, sur laquelle figure une inscription en hommage à l´abbé Guy Doucet qui, au 15e siècle, fit restaurer l´abbatiale (façade et mur sud de la nef). Au dessus de la niche, une large baie obstruée, dont certains motifs (feuilles, voussures fines), encore visibles, relèvent du gothique flamboyant.
Le mur sud de la nef présente des traces de reprise et des traces d'arrachement sur la façade principale. Côté nord, le mur de la nef comporte de solides contreforts et les traces de l'ancien cloître. Le clocher carré, reposant sur la croisée du transept, est surmonté d´un toit pyramidal obtus.
Orienté à l´est, le chevet est soutenu par des contreforts plats, rectangulaires. Son toit à croupe ronde est porté par un ensemble de modillons non homogène. Le chevet, qui se caractérise par une sobriété décorative, est ajouré par des baies, dépourvues de colonnettes, surmontées d´une archivolte à impostes moulurées présentant un décor géométrique (pointes de diamants accompagnées d´entrelacs, dents de scie, palmettes, petites feuilles creusées). L´absidiole nord semble moins le fruit d´une restauration que l´absidiole sud. Toutes deux sont dénuées de contreforts et présentent une fenêtre encadrée de colonnettes à chapiteaux, dont les bases et les fûts ont été tournés. Les ornements extérieurs renvoient aux éléments de décor intérieurs.
Au seuil de l´église abbatiale se trouvent les fonds baptismaux, circonscrits par un muret en pierre de taille, datant sans doute du 19e siècle, clôturé par une grille en fer forgé à l´enclume. Pour descendre dans la nef, il faut emprunter un escalier constitué de six marches. Le sol de l´église est en contrebas du niveau du terrain extérieur.
Cette nef unique, sans collatéraux, se caractérise par son étroitesse (9 de large sur environs 50 mètres de long, 15 mètres de haut). Elle est couverte d´une fausse voûte en berceau brisé dont les doubleaux, à deux rangs de claveaux, sont portés par des dosserets et des colonnes géminées présentant des chapiteaux lisses. Les murs de la nef ne sont pas percés en vis-à-vis, car les neuf fenêtres cintrées sont établies en quinconce (quatre fenêtres au sud dont deux sont en arc segmentaire, cinq fenêtres en plein cintre au nord). Ces baies, plus hautes et étroites sur le mur sud, pénètrent légèrement dans la voûte. Le départ des voûtes, souligné par un cordon, est dès lors interrompu par l´arc des fenêtres. Cet effet est accentué par le fait que le bandeau est établi dans le prolongement des tailloirs de chapiteaux. Quatre arcs brisés (arcades ogivales), délimitant la croisée du transept, portent le clocher. Les piliers qui soutiennent ces arcades sont constitués de colonnes engagées couplées relevant de deux styles différents : l´ensemble des colonnes sont surmontées d´un chapiteaux lisses, à l´exception de celles de l´angle sud-ouest de la nef qui, refaites au 13e siècle, sont surmontées de chapiteaux à feuillage et terminées en bas par des consoles (en culs-de-lampe, dont une sur le mur sud est ornée d´une main) à sept pieds au dessus du sol. Sur le mur nord, les colonnes ont été écornées pour recevoir la chaire. Le transept, de 28 mètres de long, est doté, sur chaque croisillon, d´absidioles semi-circulaires, voûtées en cul-de-four. Les voûtes des croisillons, en berceau brisé, ont fait l´objet d´une restauration non homogène : le bras droit est voûté en pierre, tandis que le bras gauche est voûté en bois. Une coupole octopartite, présentant huit nervures toriques, coiffe la croisée différenciée du transept. Visiblement, la voûte romane a été remplacée par une voûte d´ogive à huit branches.
Les fenêtres de l´abside et des absidioles sont accostées de colonnettes à chapiteaux refaits. L´abside en hémicycle est voûtée en cul-de-four brisé, et percée de sept fenêtres en plein cintre, ébrasées, encadrées de colonnettes, à fûts cerclés et à chapiteaux façonnés au tour. Les absidioles ont chacune une fenêtre flanquée, à chaque angle, de colonnettes à chapiteaux lisses ou tournés. Le choeur, surélevé de trois marches, était autrefois fermé par une grille (voir Rédet).
Aujourd´hui, seules les chapelles, dédiées à saint Sébastien et au saint Sacrement, sont clôturées par une grille en fer forgé à l´enclume. La salle capitulaire, surmontée du dortoir, était située dans l´actuelle sacristie. Le transept communiquait avec les autres bâtiments.
Détail de la description
| Murs |
|
|---|---|
| Toits |
|
| Plans |
plan en croix latine |
| Couvrements |
|
| Couvertures |
|
| Décors/Technique |
|
| Décors/Représentation |
Précision sur la représentation : Chapiteau à feuillage en façade et à la croisée du transept. Baies du chevet à archivolte à décor de pointes de diamants, entrelacs, dents de scie, palmettes et petites feuilles. Baie obstruée ornée de feuilles et voussures fines. Console à la croisée du transept ornée d´une main. |
Informations complémentaires
| Type de dossier |
Dossier d'oeuvre architecture |
|---|---|
| Référence du dossier |
IA86002185 |
| Dossier réalisé par |
Bunoz Céline
|
| Cadre d'étude |
|
| Aire d'étude |
Communauté d'Agglomération de Poitiers |
| Phase |
étudié |
| Date d'enquête |
2005 |
| Copyrights |
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers |
| Citer ce contenu |
Abbaye de chanoines réguliers de saint Augustin, dite abbaye Notre-Dame, Dossier réalisé par Bunoz Céline, (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/64d6d00c-fa54-4396-9d9b-37d4e9688b19 |
| Titre courant |
Abbaye de chanoines réguliers de saint Augustin, dite abbaye Notre-Dame |
|---|---|
| Dénomination |
abbaye |
| Genre du destinataire |
de chanoines réguliers de saint Augustin |
| Vocable |
Notre-Dame |
| Parties constituantes non étudiées |
bâtiment conventuel |
| Statut |
|
|---|---|
| Protection |
|
| Intérêt |
|
Localisation
Adresse: Nouvelle-Aquitaine , Vienne , Fontaine-le-Comte
Milieu d'implantation: en village
Lieu-dit/quartier: le Bourg
Cadastre: 1837 C 93, 2004 AO 23