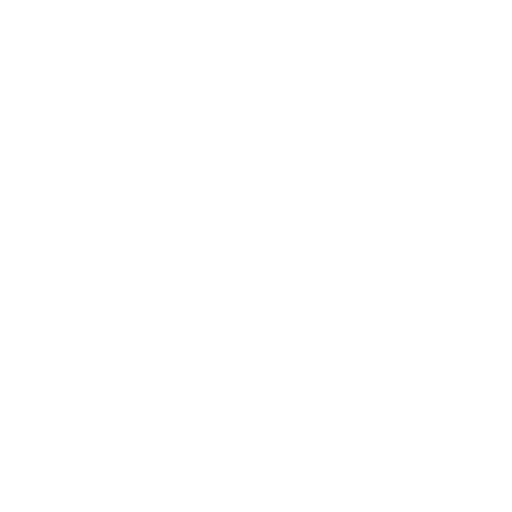0 avis
Historique
Vers 785, le comte Roger de Limoges cède à l´abbaye de Charroux qu'il vient de fonder « la curie de Surin avec son église », placée à l'origine sous le vocable de Saint-Pierre. Surin est mentionnée en 1096 dans la bulle d'Urbain II confirmant les possessions de l´abbaye de Charroux.
La sculpture remployée dans l´édifice actuel, entièrement reconstruit à la fin du 19e siècle, semble plus tardive, sans doute de la seconde moitié du 12e siècle. L'histoire de l'édifice n'est pas documentée jusqu'au 18e siècle.
En 1721 est fondue une cloche (classée monument historique en 1943 au titre des objets). Elle porte l´inscription « EX SUMPTIBUS ET CURIS MATRI LUDCI CAROLI HUGUET RECTORIS ST PETRI SUBVINO. L'ANNO DOMINI 1721. ETIENNE BARAUD » (Elle vient des largesses et des soins de maître Charles Huguet, recteur de Saint-Pierre de Surin. L´an du seigneur 1721. Etienne Baraud). Ce fondeur était installé dans la région de Confolens. En 1749, l´assemblée des habitants de la paroisse décide une série de travaux portant sur la réparation de la toiture (lattes et tuiles creuses) ; la porte, les fonts baptismaux et les verrières.
En 1809, le conseil municipal demande des réparations au sous-préfet. Les travaux sont refusés au motif que la paroisse a été supprimée. Le sous-préfet souligne qu'il faudrait d´abord demander le rétablissement de l´église comme annexe ou chapelle pour pouvoir financer les travaux au titre de l'entretien des lieux de culte. Cette demande semble être restée sans suite.
En 1852, le conseil municipal demande des plans et un devis à l´agent-voyer du canton, pour réparation ou reconstruction à neuf de l´église, mais aucune suite n´est donnée.
En 1865, Brouillet signale que l´église menace ruine, ce qui est à nouveau constaté en 1867 par le conseil municipal, qui demande au préfet la marche à suivre pour faire fermer l´église et le cimetière, devenus trop dangereux. Le prêtre se plaint auprès de l'évêque du mauvais état de l'église.
En 1868, l´architecte diocésain Léon Louis Ferrand se déplace et établit un devis de travaux pour 27562 francs, rejeté. En 1869, le conseil municipal demande au préfet de faire établir un devis par l´agent-voyer du canton, aucune suite ne semble avoir été donnée. En 1872, une partie de la toiture s'est effondrée. En 1877, l'église est érigée en succursale.
En 1879, l´architecte diocésain Léon Louis Ferrand établit un nouveau devis pour 24000 francs, resté sans suite (mais le ministère de l'intérieur a délivré une subvention), puis un nouveau projet est présenté en 1881, pour 13500 francs, enfin accepté. Les travaux sont adjugés le 21 janvier 1883 à Surreaux, entrepreneur à Civray. Les matériaux de l´ancienne église sont réutilisés dans la nouvelle construction. Très vite, le budget initial est dépassé, des demandes de crédits complémentaires sont faites en 1884, 1885 et 1886. En 1887, un emprunt de 5300 francs est contracté par la commune auprès du crédit foncier. Des travaux supplémentaires sont alors confiés à Eugène Texier, entrepreneur de maçonnerie à Surin. En 1889, les travaux sont achevés. En 1892, une nouvelle délibération est prise pour lancer une souscription pour la construction du clocher et l´achèvement de l´église. Le devis est établi en 1893 par l´architecte Alcide Boutaud pour 2985,54 francs et les travaux adjugés à Pierre Regeon, entrepreneur à Ruffec.
En 1901 est décidée la construction d´une voûte en voliges et plâtre, financée sur l´argent de la fabrique.
En 1950, une seconde cloche est offerte par l´abbé Paul Guillon, curé de Chatain, qui desservait alors Surin. Elle lui avait été offerte par une personne qu´il avait aidé pendant l´occupation.
En 1981 ont lieu des travaux de réaménagement du chœur.
Détail de l'historique
| Périodes |
Principale : 12e siècle (incertitude) Principale : 4e quart 19e siècle Secondaire : 1er quart 20e siècle |
|---|---|
| Dates |
1883, daté par source 1895, daté par source 1901, daté par source |
| Auteurs |
Auteur :
Ferrand Léon Louis, architecte diocésain Auteur : Boutaud Alcide, architecte Auteur : Surreaux, entrepreneur Auteur : Texier Eugène, entrepreneur Auteur : Regeon Pierre, entrepreneur |
Description
L´ancienne église de Surin était placée sous le vocable de Pierre, qu´elle porte encore en 1749. Il est probable que le changement pour Hilaire soit intervenu au moment de la reconstruction de l´église, en 1883. La paroisse de Surin dépendait de l´archiprêtré d´Ambernac.
Au cours du 19e siècle, la cure de Surin est réunie à celle d´Asnois. La paroisse est desservie par le curé de Charroux.
D´après Brouillet (1865), l´ancienne église mesurait 24 mètres de long sur 8 de large, avec un chevet plat. L´abside, « carrée » (donc sans doute à chevet plat), était voûtée en pierre avec une fenêtre romane en plein cintre dans l´axe. La nef comportait trois travées en plein cintre, avec une seule fenêtre au-dessus de la porte. Un clocher-mur à une seule chambre de cloche surmontait le fronton triangulaire. Le portail était en plein cintre, à deux rouleaux dépouillés d´ornement, et soutenus par des colonnes aux chapiteaux ornés d´animaux symboliques tels que des lions et des griffons. Les bases des colonnes étaient sculptées de pattes et le côté gauche de l´ouverture est plus richement orné que le côté droit. L´église était alors charpentée, mais Brouillet pense qu´elle avait été voûtée. Les contreforts étaient peu saillants et la couverture en tuile creuse. L'église portait, à l'extérieur, une litre seigneuriale.
Les éléments sculptés du portail roman remployés dans l'édifice du 19e siècle comprennent :
- l'archivolte ornée de pointes de diamant ;
- les deux colonnes monolithes ;
- les bases moulurées des colonnes ornées de motifs géométriques ;
- deux lions affrontés sur le chapiteau droit ;
- un homme affronté à un dragon (basilic) et poursuivi par un second dragon sur le chapiteau gauche ; l´homme est debout, penché vers l´avant, et tient à deux mains un objet allongé au-dessus de sa tête ;
- un décor en damier sur le tailloir de ce chapiteau.
D'après les dessins de Brouillet (1865), la base à décor de losange se trouvait sur le piédroit gauche, du même côté que le personnage affronté à un dragon sur le chapiteau. Le piédroit droit semblait porter un centaure sur le chapiteau et une base à plusieurs moulures. Un personnage en position d'Atlante (sur un modillon ?) et deux chapiteaux ornés d'animaux affrontés à une seule tête sont également représentés sur ces planches.
L´église de la fin du 19e siècle a été construite en moellons, sans enduit, et couverte d´ardoises. La nef est constituée de quatre travées, le chœur de deux, avec d´étroits contreforts plats. Au nord comme au sud, seules les deuxième et troisième travées ainsi que la première travée droite du chœur sont éclairées par des fenêtres. Les murs gouttereaux, à l´extérieur, présentent un léger ressaut à un peu moins de la moitié de la hauteur.
Le portail se situe sur la façade occidentale. Il est encadré de deux colonnes remployées de l´édifice roman, comme les bases moulurées, les chapiteaux et les éléments de l'archivolte. Le pignon triangulaire, découvert, est percé d´une baie d´axe encadrée de deux arcatures aveugles, toutes trois en plein cintre.
Le clocher, carré, est situé sur la première travée de la nef. Il présente une baie en plein cintre par face et est couvert d´une flèche polygonale en ardoise. Le chevet plat est éclairé par deux fenêtres en plein cintre.
La nef est couverte d´une voûte en plein cintre en bois recouvert de plâtre. Le chœur est un peu plus étroit que la nef. Dans les angles nord-est et sud-est de celle-ci, deux chapiteaux romans ont été remployés en console de statue. Celui situé du côté nord est constitué de deux lions affrontés, avec une tête unique dans l'angle du chapiteau. Les queues sont retournées en panache sur le dos des animaux. Du côté sud, il s´agit de deux sphinx non ailés, affrontés, avec également une seule tête (humaine) dans l'angle.
Détail de la description
| Murs |
|
|---|---|
| Toits |
|
| Plans |
plan allongé |
| Couvrements |
|
| Couvertures |
|
| Décors/Technique |
|
Informations complémentaires
| Type de dossier |
Dossier d'oeuvre architecture |
|---|---|
| Référence du dossier |
IA86007802 |
| Dossier réalisé par |
Dujardin Véronique
Chercheur, service Patrimoine et Inventaire Sarrazin Christine |
| Cadre d'étude |
|
| Aire d'étude |
Civray |
| Phase |
étudié |
| Date d'enquête |
2010 |
| Copyrights |
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel |
| Citer ce contenu |
Église paroissiale Saint-Pierre puis Saint-Hilaire, Dossier réalisé par Dujardin Véronique, (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/ecad4ce5-192b-4971-b8b4-ba5dfe58eae0 |
| Titre courant |
Église paroissiale Saint-Pierre puis Saint-Hilaire |
|---|---|
| Dénomination |
église paroissiale |
| Vocable |
saint Pierre saint Hilaire |
| Statut |
|
|---|---|
| Protection |
|
Localisation
Adresse: Nouvelle-Aquitaine , Vienne , Surin
Milieu d'implantation: en village
Cadastre: 1834 D1 74, 2009 D 35