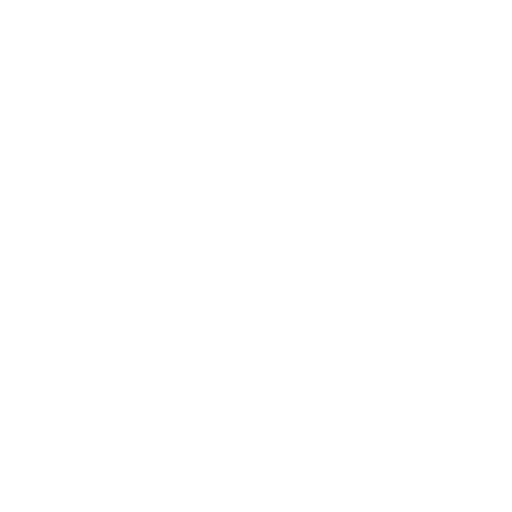Historique
Le site de Savigné apparaît dans les textes à la fin du 9e siècle, comme siège d'une viguerie (Rédet, 1891, d'après Jean- Besly, Histoire des comtes de Poitiers, publié en 1634). Un acte de donation daté des années 986-999 et conservé dans le cartulaire de l'abbaye Saint-Cyprien à Poitiers signale à nouveau la viguerie de Savigné. La présence de nombreux sarcophages mérovingiens et carolingiens, enterrés dans le grand cimetière qui s'étendait devant l'église, confirme une occupation du site remontant au moins au Haut Moyen Age [voire à l'Antiquité], et la probable existence d'un édifice cultuel chrétien dès cette période. La viguerie de Savigné disparaît au siècle suivant, absorbée par la châtellenie de Civray. Savigné, dont la cure est à la nomination de l'évêque, est le siège de l'archiprêtré de Gençay.
L'actuelle église Saint-Hilaire est vraisemblablement édifiée à l'époque romane, comme en témoignent le portail roman du mur nord, le clocher et les murs de la nef.
L'église est remaniée au 15e siècle ; un nouveau portail est aménagé dans le mur sud de la nef, le chœur est reconstruit. À l'époque moderne, des travaux de restauration sont réalisés ; la charpente et la toiture sont refaites au cours du 17e siècle (Aucher, p. 11).
Jusqu'à la Révolution, la paroisse dépend de la châtellenie et de la sénéchaussée de Civray. En 1789, la commune de Savigné est créée ; l'église reste ouverte au culte.
Si l'archiprêtré de Gençay disparaît en 1804, la cure de Savigné est maintenue. L'église Saint-Hilaire est dotée, en 1859, de deux nouvelles cloches. Cependant, dès 1836/1837, le conseil municipal et la fabrique demandent des secours auprès du préfet pour des réparations urgentes à faire à l'église, dont l'état est alarmant. Le projet de restauration présenté par M. Perlat, qui prévoit la division de la nef en trois vaisseaux, est refusé le 4 mai 1864 par la commission archéologique diocésaine (Archives diocésaines de l'évêché de Poitiers). En 1871, le préfet approuve le projet et le devis de restauration de l'édifice établis en 1868 par l'architecte Ferrand (Archives départementales de la Vienne). Les travaux, qui concernent la toiture, les murs et le couvrement de la nef, sont engagés l'année suivante. Le dallage de la nef est refait en 1873. En 1877, le ministère de la justice et des cultes accorde une subvention pour la construction de la sacristie et l'achat d'objets de culte.
À la fin du 19e siècle, la restauration du clocher est envisagée. Selon le dessin réalisé par P.-A. Brouillet en 1865, ce dernier comprend alors une base ornée d'une arcature aveugle surmontée d'une haute flèche à égout retroussé (Brouillet, 1865, pl. 20 ; voir fig. 1). Le projet présenté par la commune est refusé plusieurs fois par la commission départementale des bâtiments civils et par la commission des techniques des édifices diocésains. En 1901, un nouveau projet de restauration est présenté au préfet (Archives départementales de la Vienne).
Une campagne de restauration est effectuée en 1977 ; elle concerne la toiture de l'église et le portail roman, qui est alors mis en valeur (Aucher, p. 11).
Description
L'église Saint-Hilaire s'élève dans le village de Savigné. La place qui s'étend au nord de l'édifice succède à l'ancien cimetière où ont été découverts des sarcophages mérovingiens et carolingiens.
De plan allongé, l'église est constituée d'une nef à six travées, d'une travée sous clocher et d'un chœur à chevet plat. L'ancien presbytère est accoté à la façade occidentale dont seul le pignon, refait dans les années 1870, est visible.
Selon Brouillet (1865), l'église mesure 35,4 mètres de long sur 8,75 mètres de large. L'archéologue, qui a visité le site avant la restauration des années 1870, décrit une nef de six travées couverte d'une voûte en bois et une abside du 15e siècle couverte en pierre, des fenêtres romanes, étroites à l'extérieur et évasées en dedans, et gothiques.
De l'édifice roman subsistent vraisemblablement les murs de la nef (en partie), le clocher (en partie) et le portail muré de la cinquième travée de l'élévation nord de la nef.
La nef, construite en moellons de calcaire équarris comme les autres parties de l'église, est couverte d'un toit en ardoise. Les murs gouttereaux (et les contreforts) ont été rehaussés lors de la restauration des années 1870 ; les six fenêtres, la corniche et les modillons ont également été refaits.
L'élévation nord, appuyée de deux contreforts plats, est dotée de deux portails, dont un muré, et éclairée de trois baies en plein cintre percées dans les deuxième, quatrième et sixième travées.
La porte d'entrée de l'église, dont le seuil est en contrebas par rapport à la place, a été aménagée au 15e siècle dans la première travée de l'église. Le portail est composé d'une voussure à deux rouleaux brisés garnis de tores retombant sur les minces colonnettes des piédroits et d'une archivolte sommée d'un motif fleuronné (?) ; de part et d'autre de la voussure, deux pinacles complètent le décor. Au dessus du portail, deux petites niches ornées d'un arc trilobé abritent deux statues en pierre.
La cinquième travée nord conserve un second portail, muré, surmonté de deux petits contreforts plats qui épaulent la partie haute du mur. Ce portail, qui a pu être déplacé, est daté de l'époque romane. La voussure compte deux rouleaux en plein cintre, sans décor, et une archivolte ornée de billettes ; les deux rouleaux ne sont pas directement accolés mais ils sont reliés par une maçonnerie de moellons équarris disposés suivant la courbe de l'arc.
Le rouleau externe de la voussure repose sur les deux colonnes engagées externes des piédroits ; en revanche, les fûts et bases des deux colonnes internes ont disparu et le rouleau interne retombe sur les seuls chapiteaux. Les quatre chapiteaux présentent des motifs sculptés presque identiques, des palmettes reliées entre elles par des nœuds et surmontées de volutes d'angle.
La voussure semble encadrer un rare exemple poitevin de tympan avec linteau en bâtière, sans ornement (Crozet, 1948, p. 135). Le mur gouttereau sud de la nef est sobre. Il est épaulé de quatre contreforts plats ; des traces d'un cinquième contrefort entre les deux premières travées occidentales sont décelables dans la maçonnerie. Comme au nord, trois baies en plein cintre éclairent les deuxième, quatrième et sixième travée ; l'élévation est couronnée d'une corniche portée par des modillons sans décor.
La travée sous clocher succède à la nef. Les murs nord et sud sont appuyés, jusqu'à la corniche, de deux contreforts plats. Deux massifs contreforts d'angle à un ressaut et à glacis très accentué confortent les angles nord-est et sud-est de la travée ; ils ont vraisemblablement été ajoutés à l'époque gothique. Le mur sud est ajouré d'une baie en plein cintre reprise à la fin du 19e siècle ; au nord, la baie, étroite et dépourvue d'un encadrement en pierre de taille, n'a pas été remaniée.
Une corniche décorée de festons marque la séparation avec le clocher. Au sud, elle est portée par huit modillons disposés irrégulièrement. Plusieurs d'entre eux portent des vestiges de sculptures romanes ; les deux derniers, à l'est, sont décorés l'un d'une palmette grasse, l'autre d'une feuille à quatre pétales (fig. 28). Au nord, douze modillons sont ornés de motifs géométriques variés.
Un court chœur à chevet plat se développe à l'est de la travée sous clocher. Il est couvert d'un toit à croupe en ardoise. Deux contreforts à ressaut, en pierre de taille, épaulent les angles du chevet ; ce dernier est éclairé par une baie couverte en arc brisé percée dans le mur oriental. Une sacristie est adossée au mur sud du chevet.
À l'intérieur de l'église, la longue nef est couverte d'une haute fausse voûte en berceau portée par cinq cintres reposant sur des consoles sculptées. Les murs gouttereaux sont doublés par une arcature aveugle reposant sur des pilastres. Le couvrement et l'arcature ont été reconstruits lors des travaux des années 1870.
Le mur occidental, aveugle, est appuyé de deux pilastres, couronnés d'une imposte, identiques à ceux des murs gouttereaux. À l'est, une arcade légèrement brisée, dont l'arc retombe sur des impostes sculptées et moulurées, communique avec la travée sous clocher. La voûte sur croisée d'ogives en blocage recouvert d'enduit qui la couvre est nettement plus basse que la fausse voûte de la nef. La petite baie nord, fortement ébrasée, et la baie sud éclairent la travée.
Cette dernière donne accès, par une arcade identique à celle qui ouvre sur la nef, au chœur à chevet plat. Il est également couvert d'une voûte sur croisée d'ogives. Ce chevet et les deux voûtes d'ogives orientales témoignent de la restauration/reconstruction du 15e siècle.
Détail de la description
| Murs |
|
|---|---|
| Toits |
|
| Plans |
plan allongé |
| Étages |
1 vaisseau |
| Couvrements |
|
| Couvertures |
|
| Décors/Technique |
|
Informations complémentaires
L'église Saint-Hilaire s'élève dans le village de Savigné. Au nord de l'église, sous l'actuelle place, ont été découverts des sarcophages mérovingiens et carolingiens. De l'édifice roman subsistent vraisemblablement les murs de la nef (en partie), le clocher (en partie) et le portail muré de la cinquième travée de l'élévation nord de la nef.
Le site de Savigné apparaît dans les textes à la fin du 9e siècle, comme siège d'une viguerie. La présence de nombreux sarcophages mérovingiens et carolingiens, enterrés dans le grand cimetière qui s'étendait devant l'église, confirme une occupation du site remontant au moins au Haut Moyen Age voire à l'Antiquité, et la probable existence d'un édifice cultuel chrétien dès cette période. L'actuelle église Saint-Hilaire est vraisemblablement édifiée à l'époque romane, comme en témoignent le portail roman du mur nord, le clocher et les murs de la nef. L'église est remaniée au 15e siècle ; un nouveau portail est aménagé dans le mur sud de la nef, le chœur est reconstruit. De plan allongé, l'église est aujourd'hui constituée d'une nef à six travées, d'une travée sous clocher et d'un chœur à chevet plat. Les murs gouttereaux (et les contreforts) ont été rehaussés lors de la restauration des années 1870 ; les six fenêtres, la corniche et les modillons ont également été refaits.
Situé au nord de la cinquième travée, le portail roman, aujourd'hui muré, a pu être déplacé. Sa voussure compte deux rouleaux en plein cintre, sans décor, et une archivolte ornée de billettes ; les deux rouleaux ne sont pas directement accolés mais ils sont reliés par une maçonnerie de moellons équarris disposés suivant la courbe de l'arc. Le rouleau externe de la voussure repose sur les deux colonnes engagées externes des piédroits ; en revanche, les fûts et bases des deux colonnes internes ont disparu et le rouleau interne retombe sur les seuls chapiteaux. Les quatre chapiteaux présentent des motifs sculptés presque identiques, des palmettes reliées entre elles par des nœuds et surmontées de volutes d'angle.
La travée sous clocher succède à la nef. Deux massifs contreforts d'angle, vraisemblablement ajoutés à l'époque gothique, confortent les angles nord-est et sud-est de la travée. Le mur sud est ajouré d'une baie en plein cintre reprise à la fin du 19e siècle ; au nord, la baie, étroite et dépourvue d'un encadrement en pierre de taille, n'a pas été remaniée. Une corniche décorée de festons marque la séparation avec le clocher. Au sud, elle est portée par huit modillons disposés irrégulièrement. Plusieurs d'entre eux portent des vestiges de sculptures romanes ; les deux derniers, à l'est, sont décorés l'un d'une palmette grasse, l'autre d'une feuille à quatre pétales. Au nord, douze modillons sont ornés de motifs géométriques variés.
| Type de dossier |
Dossier d'oeuvre architecture |
|---|---|
| Référence du dossier |
IA86007835 |
| Dossier réalisé par |
Dujardin Véronique
Chercheur, service Patrimoine et Inventaire Sarrazin Christine |
| Cadre d'étude |
|
| Aire d'étude |
Civray |
| Phase |
étudié |
| Date d'enquête |
2010 |
| Copyrights |
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel |
| Citer ce contenu |
Église Saint-Hilaire, Dossier réalisé par Dujardin Véronique, (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/45eff0c5-c231-476b-a3a8-a6adf783df2d |
| Titre courant |
Église Saint-Hilaire |
|---|---|
| Dénomination |
église |
| Vocable |
saint Hilaire |
| Statut |
|
|---|
Localisation
Adresse: Nouvelle-Aquitaine , Vienne , Savigné
Milieu d'implantation: en village
Cadastre: 1836 G2 572, 2009 G 394