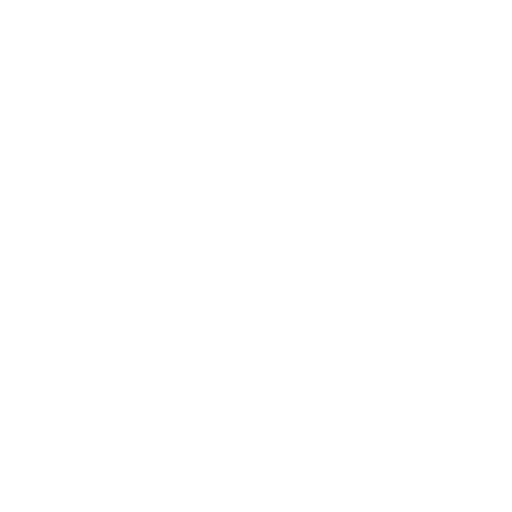0 avis
Prieuré, aujourd'hui église Saint-Maurice
France > Nouvelle-Aquitaine > Vienne > Saint-Maurice-la-Clouère
Historique
La première mention connue de l'église Saint-Maurice est relevée dans une charte du cartulaire de l'abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers, datée des années 987/990. Un siècle plus tard, vers 1096/1098, l'église est donnée aux moines de l'abbaye Saint-Cyprien qui établissent un prieuré à proximité ; les religieux de Saint-Cyprien reçoivent simultanément Notre-Dame de Gençay.
Les deux églises bénéficient de l'essor du château de Gençay confié vers 1025 à Aimery II de Rancon par le comte du Poitou Guillaume le Grand (995-1030). La famille de Rancon, seigneurs de Taillebourg, Gençay et autres lieux détient châtellenie de Gençay -qui apparaît au 11e siècle- jusqu'au 13e siècle. Le prieuré Saint-Maurice semble être le principal centre religieux de Gençay ; l'église prieurale est le siège de la paroisse Saint-Maurice qui constitue, avec la petite paroisse Notre-Dame, le bourg de Gençay.
Au 14e siècle, l'église Saint-Maurice bénéficie de travaux d'embellissement et le cul-de-four de l'abside est orné de peintures murales. Ce décor est vraisemblablement antérieur au début de la guerre de Cent ans. Le long conflit affecte à diverses reprises Gençay et sa région dont l'état de désolation est signalé dans un compte de la commune de Poitiers de 1446-1447 (Favreau, 1980, p. 20).
Le prieuré-cure est toujours en fonction après la guerre. Cependant, à la fin du 15e siècle ou au début du 16e siècle, le prieur ne réside plus à Saint-Maurice et la cure est confiée à un vicaire perpétuel (Favreau 1980, p. 23).
À l'époque moderne, des travaux de restauration et d'entretien de l'église sont entrepris à différentes périodes. Un effondrement de la voûte est signalé par un graffiti visible dans l'abside du transept sud : " 1595, le iour de ste Luce la voste est tombée ".
À la fin du 17e siècle ou au début du 18e siècle, il est décidé de surélever le sol de l'église car l'édifice, érigé sur un terrain en partie marécageux, est régulièrement inondé lors des crues de la Clouère. Vers 1720 sont réalisés d'importants travaux de couverture.
Au cours de cette même période, l'église est ornée de peintures murales. Des fragments d'un décor peint daté du 16e siècle sont conservés sur le mur gouttereau sud, sur un pilier sud de la nef et dans le bras sud du transept. Une litre funéraire aux armes de la famille des Brilhac de Nouzières, seigneurs de Gençay des années 1650 à 1753, est peinte à l'intérieur de la nef de l'église. Des traces d'une litre funéraire sont également décelables à l'extérieur de l'édifice, sur l'absidiole du transept nord.
En 1789, les deux paroisses du bourg de Gençay deviennent deux communes distinctes. La paroisse Saint-Maurice devient la commune de Saint-Maurice-la-Clouère ; le prieuré ferme, l'église demeurant paroissiale.
En 1856, l'architecte Joly-Leterme alerte le conseil municipal quant au mauvais état d'une partie de l'église. La commune ne donne pas suite par manque de ressources.
L'église, très dégradée, est classée au titre des monuments historiques en 1890. Les fondations des murs sont à reprendre. L'édifice subit toujours les crues de la proche Clouère. Les remblais déposés dans l'église au siècle précédent pour surélever le sol constituent en fait une réserve d'humidité qui aggrave la dégradation des murs. En 1898, le mur gouttereau et la voûte du collatéral nord sont étayés en attendant la restauration générale du bas-côté.
Le devis des travaux est établi en 1898 par l'architecte en chef des monument historiques J. Formigé (voir annexe 2, note 1). Les travaux, dont le programme a été réduit, sont engagés en 1902 (voir annexe 2, notes 2 et 3). Le mur gouttereau nord est refait ainsi que les contreforts d'angle nord-ouest. Le sol du collatéral nord est abaissé à son niveau initial, le projet de rétablissement du niveau primitif du sol étant abandonné par manque d'argent. La baie de la façade occidentale est dotée de nouveaux vitraux en 1903.
En 1905, est approuvé le nouveau devis de Formigé pour la restauration de la façade ouest et du transept nord (voir annexe 2, notes 3 et 4).
Des vitraux neufs sont posés dans trois baies du collatéral nord par le verrier d'art Durand. Le portail nord est restauré ; le sculpteur Delphin Pelletier reçoit 135 F pour la sculpture de deux chapiteaux romans avec chimère, et feuillages sur les tailloirs. Les charpente et toitures du clocher, du transept de l'abside et des absidioles sont refaites.
Divers travaux sont par la suite exécutés sur le bâtiment au cours du 20e siècle. En 1936/1938, des revers pavés sont réalisés autour de l'édifice afin d'assainir les murs ; l'ancienne sacristie, édifiée au sud-est, est détruite et la nouvelle sacristie est adossée au mur sud de la nef. La commune achète à cette occasion une bande de terrain de 10 mètres de large le long du mur sud. En 1946, les peintures murales du chœur sont dégagées.
La couverture de l'édifice fait l'objet de plusieurs campagnes de travaux : en 1957 (croisillon sud) ; en 1966/1968 (toits en tuile courbe du chœur, du croisillon nord et des absidioles nord-est et sud-est) ; 1982/1983 (réfection de la couverture en tuile plate et de la charpente du clocher) et en 1984/1985 (toit de la nef).
Description
L'église Saint-Maurice est implantée dans la partie sud-ouest du village, près de la Clouère qui marque la limite avec la commune de Gençay.
L'édifice, composé d'une nef, d'un transept à absidioles et d'un chœur à travée droite prolongée d'une abside, présente la particularité d'associer deux types de plan, le plan allongé et le plan tréflé. Du premier relève la nef à quatre travées flanquée de collatéraux ; le tracé des murs gouttereaux est ici irrégulier : les murs sont de longueur inégale et s'écartent vers l'ouest. Les parties orientales de l'édifice déclinent le plan tréflé. Les bras du transept sont terminés par une abside demi-circulaire à l'intérieur, polygonale à l'extérieur. Les absidioles prennent chacune appui sur le mur est des bras du transept et sur les murs de la travée droite du chœur. L'ensemble est couvert de toits en tuiles creuses à l'exception du clocher couvert en tuiles plates. Ce dernier, édifié sur la croisée du transept, domine massivement l'édifice. La base carrée, aveugle, est dotée dans les angles de massifs en pierre circulaires. Il est coiffé d'un toit en pavillon.
L'église ouvre à l'ouest par une façade-pignon appuyée de trois contreforts plats montant jusqu'à la base du pignon. Deux d'entre eux encadrent la travée centrale, percée d'un portail et, à l'étage, d'une baie. Le troisième épaule l'angle nord-ouest du mur. À l'opposé, l'angle sud-ouest est renforcé par un massif maçonné. Les parties nord et sud de la façade sont éclairées chacune d'une baie couverte en plein cintre ouverte au niveau supérieur ; une petite ouverture est percée au centre du pignon.
La façade présente une maçonnerie hétérogène, la restauration du début du 20e siècle étant particulièrement visible au niveau du portail. Le moyen appareil est utilisé jusqu'à la hauteur des baies ; en revanche, le pignon est construit en moellons équarris. Des moellons similaires sont également visibles autour de la baie sud de la façade. Plusieurs déformations affectent l'élévation et le pignon présente une retraite sur les deux-tiers de sa largeur.
Le portail occidental est l'une des deux entrées de l'église, la seconde étant aménagée dans le mur nord. Ouvert sous un arc de décharge légèrement brisé dont les retombées sont masquées par les contreforts, il est couvert d'une voussure à trois rouleaux en plein cintre. Le rouleau interne retombe sur les colonnes engagées des tableaux, le second sur les colonnes des piédroits. L'archivolte et les chapiteaux des colonnes ont reçu un décor sculpté en partie restauré lors de la campagne de travaux du début du 20e siècle. Les tailloirs des chapiteaux se prolongent en imposte jusqu'aux contreforts flanquant le portail.
Surmontant le portail, une baie à ébrasement en ressaut est couverte d'un arc plein cintre reposant sur des colonnettes dont les chapiteaux sont ornés de feuillage. Les tailloirs des chapiteaux se prolongent en bandeau jusqu'aux deux contreforts. La séparation entre les deux niveaux de la travée centrale est marquée par un larmier. Les deux baies latérales supérieures sont percées à des hauteurs différentes. Celle du nord est inscrite dans une embrasure en plein cintre ; l'archivolte ornée d'un damier qui la couronne retombe sur une imposte se prolongeant jusqu'aux contreforts. Au sud, la baie, couverte d'un arc légèrement brisé, est ouverte au nu du mur qui présente à ce niveau des reprises de maçonnerie en moellons attestant de désordres affectant particulièrement cette partie de l'église.
Ces désordres ont nécessité l'édification d'un mur-contrefort qui conforte l'angle sud-ouest de la façade et les deux premières travées du mur gouttereau sud. Ce renfort, qui présente un empattement, est couvert en tuile. Le tracé irrégulier des murs de la nef a vraisemblablement déséquilibré les poussées des voûtes, ce qui a pu fragiliser l'angle sud-ouest de l'église et rendre nécessaire l'épaulement du mur roman.
Les deux dernières travées du mur gouttereau sud sont uniquement appuyées de deux contreforts plats. Elles sont éclairées d'une baie à ébrasement en ressaut couverte en plein cintre, l'arc retombant sur une imposte. Une sacristie, à toit en appentis, est adossée à la quatrième travée. Le mur présente un appareil assisé en moellons équarris, la pierre taillée étant réservée pour les contreforts et l'encadrement des baies ; le soubassement est toutefois mouluré. La charpente du toit de la nef repose sur le mur dépourvu de corniche. Le transept est peu saillant. Les bras se terminent, au sud comme au nord, par une abside à quatre pans. Le bras sud présente une maçonnerie hétérogène, où la pierre taillée a été remplacée en divers endroits par des moellons équarris assisés. Les désordres visibles du pan nord-ouest de l'abside révèlent les problèmes structurels qui affectent encore l'édifice. Les élévations sont sans décor. Les angles sont renforcés par trois contreforts plats montant jusqu'à la corniche. Deux baies couvertes en plein cintre éclairent les pans sud-ouest et sud-est de l'abside. Elles sont couronnées d'une archivolte retombant sur une imposte qui se poursuit sur le contrefort sud.
Le transept est doté d'une absidiole qui prend appui sur le mur est du transept et sur le mur sud de la travée droite du chœur. La construction est particulièrement soignée. Le mur en pierre de taille, au soubassement appareillé et mouluré, est conforté par deux contreforts-colonnes sur dosseret et ajouré d'une baie couverte en plein cintre. La fenêtre est accostée, au nord, d'une seconde ouverture aujourd'hui occultée. Une corniche reposant sur neuf modillons couronne le mur. L'absidiole est agrémentée d'un décor sculpté porté par les modillons et les chapiteaux des contreforts-colonnes. Les pierres de la corniche sont elles aussi ornées de motifs géométriques sauf la section entre les deux contreforts ; les pierres y sont nues, ce qui peut témoigner d'une restauration postérieure.
Le chevet, composé d'une travée droite et d'une abside, présente également une maçonnerie et un décor architectural élaborés. Le parement extérieur des murs est réalisé en moyen appareil homogène, à l'exception de la dernière assise ; composée de moellons rectangulaires, celle-ci marque la séparation avec la corniche à modillons. L'implantation des murs dans le sol est soulignée par un soubassement mouluré. Six contreforts-colonnes sur dosseret montant jusqu'à la corniche épaulent l'abside du chevet. Entre chaque contrefort, une baie couverte en plein cintre est encadrée par une haute arcade couronnée d'une archivolte ; deux arcades aveugles en plein cintre surmontent chaque baie. Les murs de la travée droite sont également confortés par un contrefort-colonne et ornés, en partie haute, d'une arcature aveugle. La partie orientale de ces murs était ajourée d'une baie, aujourd'hui murée, inscrite dans une embrasure en plein cintre ; au nord, la baie murée est encadrée de deux colonnettes qui n'existent pas au sud.
Le jeu des pleins et de vides des arcatures, qui créent ombres et lumières, celui des courbes animent ce chevet par ailleurs embelli par la sculpture. Celle-ci est présente sur les chapiteaux des contreforts-colonnes et des colonnettes de l'arcature aveugle, sur les modillons de la corniche, autour des baies de l'abside, à l'exception de la fenêtre sud. Les modillons, distribués cinq par cinq entre les contreforts, sont ornés majoritairement de têtes animales, parfois monstrueuses ; quelques têtes humaines sont identifiables. Les motifs végétaux règnent exclusivement sur les chapiteaux des colonnettes de l'arcature aveugle ; ils alternent avec les motifs animaliers sur les chapiteaux des contreforts-colonnes. Les arcades encadrant les baies de l'abside portent, quant à elles, un décor géométrique varié (cf. annexe 1 concernant la sculpture).
Cette organisation du décor du chevet, où une arcature aveugle règne en partie haute, et l'abondance du décor font plus référence à l'art roman saintongeais qu'à l'architecture poitevine.
La volonté d'embellissement de l'édifice est également visible sur le bras nord du transept et son absidiole qui, comme au sud, prend appui sur le transept et sur la travée droite du chevet. De même facture que le chevet, ils présentent un parement en moyen appareil, un décor architecturé et sculpté. L'absidiole, au soubassement appareillé et mouluré, est appuyée de deux contreforts-colonnes sur dosseret et éclairée d'une baie couverte en plein cintre. Une corniche, reposant sur onze modillons, couronne le mur. Corniche et modillons ont été refaits au début du 20e siècle ; seul le chapiteau du contrefort-colonne est porte un décor sculpté roman. Des vestiges d'une litre funéraire peinte ont été conservées en partie haute de l'élévation est de l'absidiole. Le bras nord du transept qui est terminé, comme au sud, par une abside à quatre pans, conserve également un parement en pierre de taille et un décor d'architecture. Trois contreforts-colonnes confortent les angles de l'abside dont les pans nord-est et nord-ouest sont ajourés de deux grandes baies à ébrasement à ressaut couvertes en plein cintre. Une arcature aveugle, dont les chapiteaux et tailloirs sont taillés dans un bloc monolithe, décore les parties hautes du transept à l'exception du mur est de la travée du transept ; ce dernier est simplement animé d'une baie aveugle couverte en plein cintre.
Comme sur le chevet, le décor sculpté est porté par les chapiteaux et les modillons de la corniche. Les feuillages ornent exclusivement les chapiteaux alors que les sujets des modillons sont essentiellement puisés dans le bestiaire.
Les parties basses, les baies et le parement extérieur du bras nord du transept ont été repris au début du 20e siècle. Cette réfection appartient à l'importante campagne de restauration qui a été menée sur les faces nord et ouest de l'église, menacées d'effondrement, et à l'intérieur du collatéral. Le mur gouttereau nord, qui présentait un fort déversement, a été reconstruit à l'identique du mur roman. Il présente un parement en pierres taillées et un soubassement appareillé et mouluré. Il est épaulé par trois contreforts rectangulaires, d'une section plus importante que les contreforts sud. Les première, troisième et quatrième travées du mur sont ajourées d'une baie couverte en plein cintre à ébrasement en ressaut ; une archivolte à décor géométrique les couronne ; un cordon règne à hauteur d'imposte. Un imposant portail, surmonté d'une d'une corniche reposant sur des modillons nus, a été construit dans la seconde travée nord. Il est composé d'une voussure en plein cintre comprenant quatre rouleaux et une archivolte retombant sur les piédroits à ressauts. Les colonnes des tableaux et des jambages externes supportent respectivement le rouleau interne et le rouleau externe de la voussure, les jambages intermédiaires étant dépourvus de colonnes. Le rouleau interne est nu alors que les trois autres portent un décor rayonnant de griffons et de palmettes. Les chapiteaux des colonnes externes conservent également un décor roman (oiseaux à gauche, griffons à droite) ; en revanche, les chapiteaux internes ont été refaits au début de 20e siècle.
Le développement et l'ornementation de ce portail semblent le désigner comme la principale entrée de l'église. Il s'inscrit dans une élévation au parement soigné en pierre de taille, comme le chevet, alors que la face sud est mise en œuvre plus pauvrement, avec des moellons assisés, et est dépourvue de décor. Le prieuré était peut-être implanté du coté sud alors que la face nord de l'édifice ouvrait vers le bourg.
À l'intérieur, l'église surprend par ses proportions trapues. À la fin du 17e siècle ou au début du 18e siècle, le sol est en effet surélevé d'environ 0,70 mètre par rapport à son niveau d'origine. Le niveau de sol primitif du collatéral nord a été dégagé au début du 20e siècle ; lors de cette restauration furent détruites les marches qui permettaient d'accéder dans l'église par le portail nord (cf. fig. 1 : dessin de l'élévation nord de l'église, réalisé en 1842 par Charles de Chergé).
La nef à quatre travées se compose d'un vaisseau central et de deux collatéraux de longueur inégale, le bas-côté sud étant plus court que le nord. La première travée, à l'ouest, est donc dissymétrique et moins longue que les trois autres. Cette irrégularité est accentuée par l'écartement progressif des murs gouttereaux vers l'ouest.
Le vaisseau central est couvert d'une voûte en berceau brisé soutenue par des arcs doubleaux et reposant sur des grandes arcades légèrement brisées. Les poussées du berceau central sont contrebutées par les voûtes en berceau brisé des collatéraux, selon un dispositif fréquent en Poitou. Le déversement des grandes arcades traduit un déséquilibre entre les forces exercées par la voûte centrale et les contrebutements latéraux, certainement accentué par l'irrégularité du tracé des murs gouttereaux.
Les arcs doubleaux de la voûte du vaisseau central retombent sur les colonnes engagées qui flanquent, côté nef, les piles cruciformes des grandes arcades. La retombée des grands arcs est soulignée par une simple imposte ; la dernière travée fait exception, les grands arcs reposant sur les chapiteaux des colonnes engagées occidentales des piles marquant la séparation entre la nef et la croisée du transept. Dans les collatéraux, les arcs doubleaux reposent sur des pilastres. Les deux premiers arcs doubleaux du collatéral sud ne retombent pas à l'aplomb des pilastres mais sur des consoles. Cette irrégularité correspond aux travées où le mur et la voûte présentent des désordres de maçonnerie ; elles sont épaulées extérieurement par le mur-contrefort. Le troisième doubleau supporte la voûte par l'intermédiaire d'un petit mur-diaphragme. Aucun désordre n'est visible dans le collatéral nord, reconstruit au début du 20e siècle.
La nef est éclairée directement par les baies en plein cintre du mur ouest et indirectement par les fenêtres des collatéraux, trois au nord et deux au sud. Les appuis des deux baies du mur sud sont soulignés par un bandeau filant qui n'existe pas au nord.
À la nef succède, vers l'est, le transept. La croisée est couverte d'une coupole sur pendentifs triangulaires qui est appareillée en lits horizontaux ; elle est dotée de huit nervures rayonnant autour d'un oculus central. La coupole est portée par des supports cruciformes reliés entre eux par des arcs à double ressaut surmontés d'une archivolte. De même hauteur que ceux de la nef, les piliers de la croisée se différencient par la présence d'une colonne engagée sur les faces est et ouest, pour les piles occidentales, et uniquement sur l'élévation ouest pour les piles orientales.
Les bras du transept sont composés d'une travée de plan trapézoïdal, couverte en berceau brisé, et d'une abside demi-circulaire à l'intérieur et polygonale à l'extérieur, couverte d'un cul-de-four. Deux baies couvertes en plein cintre éclairent les absides. Sur chaque bras ouvre, à l'est, une absidiole couverte d'une voûte en cul-de-four et éclairée d'une seule baie au sud ; une niche en plein cintre a été aménagée dans l'axe de l'abside, pour abriter un statue. Les absidioles communiquent avec le chœur par deux passages percés ultérieurement (Crozet, C.A.F., 1951, p. 323).
Comme dans le transept, la travée droite du chœur est couverte d'une voûte en berceau brisé et l'abside d'une voûte en cul de four. L'abside, un peu plus étroite que la travée droite, est reliée à cette dernière par un ressaut garni d'une haute et mince colonne. L'abside est largement éclairée par cinq baies s'inscrivant chacune dans une embrasure en plein cintre. Deux hautes baies couvertes en plein cintre de la travée droite ont été murées. La base des murs du chœur disparaît derrière des boiseries.
L'architecture intérieure témoigne d'une relative sobriété. Le parement en pierre de taille des parties orientales de l'église (chœur, absidiole et transept) atteste du soin accordé par les constructeurs au sanctuaire. Dans la nef, la pierre taillée est réservée aux grandes arcades, aux pilastres et à l'encadrement des baies ; les parties basses du mur nord de la seconde travée et du revers de la façade ouest, où ont été aménagés les deux portails, présentent également un parement en pierre de taille. La maçonnerie de la nef est en grande partie recouverte d'un badigeon blanc à l'exception du mur gouttereau nord où l'enduit ciment a été laissé en état.
L'église conserve des éléments de décor sculpté et peint. Les sculptures romanes se concentrent sur les chapiteaux des colonnes des grandes arcades et des colonnettes des baies du chœur. Trois chapiteaux de la nef portent un décor animalier : des lions sont représentés sur les corbeilles des colonnes occidentales de la croisée du transept et le chapiteau du troisième pilier nord de la nef est orné de quatre oiseaux affrontés deux à deux. Les motifs de feuillage plus ou moins stylisés décorent les autres chapiteaux de l'édifice, notamment dans le chœur où règnent les corbeilles végétales (cf annexe 1 concernant le décor sculpté roman).
Des vestiges de décor historié peint subsistent dans le chœur, dans le collatéral sud et sur le mur sud de la nef. Ils témoignent de deux campagnes d'embellissement, l'une datée du 14e siècle et la seconde du 16e siècle.
De la première relèvent les apôtres, les prophètes et le ciel étoilé qui ornent la voûte de la travée droite du chœur ainsi que le Christ en majesté peint sur la voûte en cul-de-four de l'abside. Assis sur un trône, le Christ bénit de sa main droite et tient dans sa main gauche le globe terrestre. Il est entouré d'une mandorle légèrement quadrilobée. À l'extérieur de la mandorle était représenté le tétramorphe dont il subsiste aujourd'hui le lion de saint Marc (en bas à gauche), l'ange de saint Matthieu (en haut à gauche), la partie postérieure du taureau de saint Luc (en bas à droite).
À la campagne du 16e siècle appartiennent les vestiges de peintures murales de l'élévation sud de l'église : sainte Barbe, saint Pierre et le dessin d'une ville fortifiée sur le mur gouttereau ; un personnage non identifié, des dessins de bateaux dans le transept sud. Diverses inscriptions et graffiti sont encore déchiffrables dans l'abside du transept sud.
Une litre funéraire, aux armes de la famille Brilhac de Nouzières qui détenaient la seigneurie de Gençay de 1650 environ à 1753, est peinte dans le transept, sur les murs sud et ouest de la nef.
Détail de la description
| Murs |
|
|---|---|
| Toits |
|
| Plans |
plan tréflé, plan allongé |
| Étages |
3 vaisseaux |
| Couvrements |
|
| Couvertures |
|
| Décors/Technique |
|
| Décors/Représentation |
Précision sur la représentation : L'église Saint-Maurice possède un riche décor sculpté roman porté, à l'extérieur, par les portails ouest et nord et, sur le chevet, par les contreforts-colonnes, les colonnettes de l'arcature aveugle et les modillons. Les corbeilles végétales dominent, à l'exception de quelques chapiteaux des contreforts ; le décor animalier règne sur les modillons, où sont toutefois représentés quelques têtes humaines. À l'intérieur de l'édifice, les colonnes des supports de la nef et les colonnettes des baies du chœur ont conservé le décor sculpté roman de feuillages et, pour trois d'entre eux, d'animaux (lions, oiseaux). D'importants vestiges peints, datés des 14e et 16e siècles, subsistent : Christ glorieux entouré du tétramorphe, apôtres et prophètes dans le choeur ; saints et dessin d'une ville sur l'élévation sud de l'église. |
Informations complémentaires
| Type de dossier |
Dossier d'oeuvre architecture |
|---|---|
| Référence du dossier |
IA86007938 |
| Dossier réalisé par |
Dujardin Véronique
Chercheur, service Patrimoine et Inventaire Sarrazin Christine |
| Cadre d'étude |
|
| Aire d'étude |
Civray |
| Phase |
étudié |
| Date d'enquête |
2010 |
| Copyrights |
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel |
| Citer ce contenu |
Prieuré, aujourd'hui église Saint-Maurice, Dossier réalisé par Dujardin Véronique, (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/65578b6e-6a37-458c-bb69-ebf617a9f4e5 |
| Titre courant |
Prieuré, aujourd'hui église Saint-Maurice |
|---|---|
| Dénomination |
prieuré |
| Vocable |
saint Maurice |
| Destination |
église paroissiale |
| Statut |
|
|---|---|
| Protection |
|
Localisation
Adresse: Nouvelle-Aquitaine , Vienne , Saint-Maurice-la-Clouère , place de la Liberté
Milieu d'implantation: en village
Cadastre: 1812 C1 180, 2010 AH 300