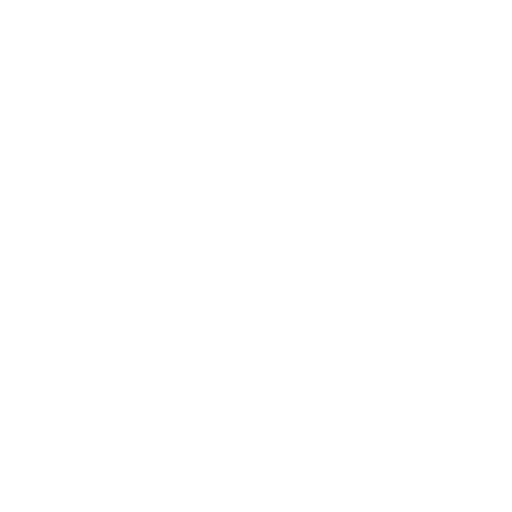0 avis
Historique
Au cours du 11e siècle, Guillaume et Audebert de La Trémoïlle donnent une partie de leur terre du Mas-Vital aux ermites installés à Fontgombault (Indre). Deux d'entre eux, Geoffroy et Bertrand, s'y installent. Vers 1108-1109, le petit ermitage de Geoffroy et Bertrand est donné à l'abbaye de Fontevraud (Maine-et-Loirel) fondée quelques années plus tôt par Robert d'Arbrissel.
Robert d'Arbrissel installe à Mas Vital un prieuré, mixte comme à Fontevrault. Le nouvel établissement est doté de biens donnés notamment par la famille de La Trémoïlle. Théburge, religieuse du prieuré fontevriste de La Puye (Vienne), en est la première prieure. L'église des moniales est édifiée au milieu du 12e siècle ; le prieuré des moines est élevé à l'extérieur de la clôture des femmes.
À la fin du 15e siècle, après la guerre de Cent ans, la vie du prieuré est réduite à un prieur, un religieux et deux domestiques.
La vie religieuse régulière est rétablie à la fin du 16e siècle. Le prieuré semble en mauvais état et le cloître a disparu. Les deux premières travées de la nef sont transformées pour abriter le logement de la prieure et des dépendances. Après l'adoption de la réforme de la règle fontevriste, en 1642, un nouveau bâtiment conventuel est construit. Il s'appuie partiellement sur la façade de l'église afin de communiquer avec les pièces aménagées dans la nef. Les religieuses ouvrent une école pour les jeunes filles.
Le monastère et l'école ferment pendant la Révolution, en 1790. L'année suivante, Les bâtiments sont vendus comme biens nationaux.
Au 19e siècle, l'église, convertie en dépendance agricole, est cloisonnée et éventrée. Un mur sépare la nef du transept, un plancher divise l'espace en deux niveaux. À la fin du siècle, des érudits s'inquiètent de l'état de l'édifice et s'attachent à en faire reconnaître la qualité architecturale. En 1914, l'ancienne église est inscrite sur la liste des monuments historiques. Quelques réparations sont faites mais le bâtiment continue à se dégrader.
Il faut attendre le rachat par l'État, en 1962, pour que d'importantes restaurations soient entreprises. Le choix est fait de restituer l'église dans son état originel. Les toitures sont restaurées, les premières travées de la nef et la voûte en berceau (disparue) sont reconstruites, les ouvertures romanes restituées et les autres condamnées. Les travaux s'achèvent en 1998.
Le bâtiment monastique du 17e siècle, protégé au titre des monuments historiques en 1995, connaît une première restauration entre 1999 et 2001.
Détail de l'historique
| Périodes |
Secondaire : 11e siècle Principale : 1ère moitié 12e siècle Principale : milieu 12e siècle Principale : 17e siècle |
|---|
Description
L'église Notre-Dame est construite selon un plan fréquemment utilisé en Poitou par les communautés monastiques : nef avec collatéraux, transept et chœur composé d'une travée droite et d'une abside semi-circulaire.
L'extérieur de l'église
Les murs de l'église présentent des pierres de taille calcaire en parement. La façade occidentale a fait l'objet d'un travail particulièrement soigné, avec l'utilisation d'un appareil réticulé (en losange) et de divers appareils polygonaux. Ce jeu de parements, qui participe du décor de la façade, se retrouve dans plusieurs édifices du Poitou, comme à Notre-Dame la Grande de Poitiers (Vienne).
La façade compte deux niveaux séparés par une corniche et surmontés d'un pignon. Elle est divisée verticalement en trois travées par des contreforts-colonnes, au premier niveau, et des colonnes jumelées au second niveau. La partie sud, à droite, où appuie l'aile monastique du 17e siècle, est visible à l'intérieur du bâtiment.
Au rez-de-chaussée, le portail est encadré par deux arcades aveugles abritant une arcade géminée. À l'étage, une haute baie en plein cintre est flanquée de deux arcades aveugles à deux rouleaux ; celle du nord est percée d'un petit oculus.
Les éléments architecturaux de la façade portent des sculptures qui complètent le décor architectural : voussure à quatre rouleaux et chapiteaux des colonnes du portail, arcs et chapiteaux des colonnes des arcades et des baies, corniches. Au rez-de-chaussée, les arcades latérales abritent des petits tympans qui portent également un décor.
Les murs gouttereaux de la nef ont été malmenés au 19e siècle.
L'élévation nord, mutilée au 19e siècle, a été reprise en grande partie. La majorité des cinq baies, des cinq contreforts et des modillons de la corniche ont été restitués en partie ou en totalité.
La troisième travée présente une légère avancée et est ornée d'une haute arcade en plein cintre à l'intérieur de laquelle s'inscrivent un second portail et, en partie haute, une arcature aveugle. La voussure à trois rouleaux et les chapiteaux des colonnes du portail, l'arcature supérieure portent le décor sculpté roman originel.
L'élévation sud de la nef, du côté de l'ancien cloître, a moins souffert. Elle conserve les baies et la corniche à modillons sculptés de l'époque romane.
Le transept à absidioles orientales et le chevet ont nécessité une importante restauration afin de restituer l'état roman. Lors des travaux, un pigeonnier a été retrouvé dans le pignon du bras nord du transept et dégagé.
Les chapelles orientales du transept présentent des disparités. Celle du nord est couronnée par une corniche constituée de deux tores. Elle est éclairée d'une baie en plein cintre qui s'inscrit dans une arcade à chapiteaux sculptés (oiseaux, feuillages). Les tailloirs de ces derniers, ornés de rinceaux, se prolongent en imposte jusqu'aux deux colonnes qui rythment l'élévation. Au sud, la chapelle est plus basse et la corniche a été refaite. La baie qui l'éclaire est percée au nu du mur. Comme au nord, le mur d'appui a été reconstruit.
Le chevet comprend une travée droite et une abside semi-circulaire. Le passage entre les deux parties est souligné par un contrefort-colonne double.
L'élévation est séparée en deux niveaux par une moulure filant à hauteur d'appui. La partie inférieure est rythmée par des pilastres, le niveau supérieur par des contreforts-colonnes simples ou doubles. Cette structuration se retrouve sur les absidioles du transept.
Trois baies inscrites chacune dans une arcade en plein cintre éclairent l'abside. La baie d'axe, partiellement détruite lors de la création d'une porte au 19e siècle, a été refaite. Les baies nord et sud de l'abside sont flanquées par le contrefort-colonne double séparant l'abside de la travée droite et par un contrefort-colonne simple. La travée droite est également ajourée au nord et au sud d'une baie en plein cintre.
Une différence de parement est visible sur le chevet. La pierre de taille cède la place aux trois quarts de la hauteur de l'élévation à une maçonnerie en moellons, ce qui semble indiquer une surélévation du mur.
Un massif clocher carré est édifié sur la croisée du transept. Il est dépourvu de chambre de cloches et est coiffé d'un toit à pavillon en ardoise. La tourelle polygonale située à l'angle du transept nord et du chevet a été reconstruite.
L'intérieur de l'église
L'intérieur de l'église présente des volumes équilibrés. L'homogénéité intérieure a été accentuée par les restaurations. La nef, qui compte cinq travées, est divisée en trois vaisseaux. Le vaisseau central est couvert d'une voûte en berceau brisé - refaite en 1974– soutenue par des arcs doubleaux ; les étroits collatéraux sont couverts de voûtes d'arêtes. Selon un dispositif fréquent en Poitou, les voûtes des collatéraux et de la nef ont été édifiées sensiblement à même hauteur afin de s'épauler. Ce mode constructif induit un éclairage indirect du vaisseau de la nef.
Les voûtes retombent sur de grandes arcades en plein cintre reliant. Les piliers sont composés d'un noyau carré flanqué de quatre colonnes.
Le transept assure la transition entre la nef et le chœur. Une voûte d'ogives couvre la croisée, une voûte en berceau les croisillons et les absidioles sont couvertes d'une voûte en cul-de-four. Une arcature aveugle court sur les murs du bras nord du transept ; elle se prolonge dans l'absidiole et sur le mur ouest du bras sud. Cette animation murale est peu fréquente dans un transept.
Le chœur comprend une travée droite et une abside semi-circulaire. La transition est marquée par un ressaut garni d'une colonne torse surmontée d'une colonne à fût lisse. Le passage entre la voûte en berceau du chœur et le cul-de-four de l'abside est souligné par un arc doubleau.
Le décor mural du chœur est composé d'une alternance de baies en plein cintre et d'arcades aveugles.
Le décor sculpté de la façade
La façade présente un riche décor sculpté porté par le portail, les arcades et les corniches.
La voussure du portail compte quatre rouleaux et une archivolte ornés de feuillages à l'exception de l'arc interne, refait. La disposition rayonnante du décor a été privilégiée : chaque rouleau présente un motif répété sur les claveaux : palmettes, tiges grasses dessinant des S, double rangée de feuilles stylisées. Il en est de même pour les arcades nord et sud du rez-de-chaussée, ornées de palmettes et demi-palmettes, rinceaux, tiges grasses encadrant des boutons de fleurs. Sur les chapiteaux des colonnes du portail, des animaux se mêlent aux végétaux. Ils sont également présents sur les chapiteaux des arcades latérales.
Les petits tympans sculptés de ces arcades sont des éléments particulièrement intéressants de la façade, du fait de la rareté en Poitou de ces pièces d'architecture. Deux lions affrontés à gauche, deux oiseaux buvant dans une coupe à droite illustrent les tympans nord. Au sud, un quadrupède (lion?) occupe le tympan de gauche et en suit la courbe. Le tympan de droite est divisé en deux compartiments qui accueillent respectivement un animal à face simiesque et un personnage à visage humain.
Au niveau supérieur, la baie centrale et l'arcade aveugle nord comptent deux rouleaux. Elles sont séparées par des colonnes jumelées aux chapiteaux ornés de dragons.
Les claveaux de l'arc externe de la fenêtre sont chacun orné d'oiseau huppé disposé face à son suivant, par paire.
Le rouleau externe de l'arcade nord porte un étonnant motif de main fermée disposé en alternance avec des feuillages. L'arc interne est orné d'un décor plus habituel, deux rangées de feuilles plates.
Les motifs sculptés des modillons et des métopes (plaques entre les modillons) des corniches de la façade sont fréquemment utilisés par les sculpteurs romans.
Les métopes de la corniche inférieure sont ornées, dans la partie nord, d'oiseaux adossés et, au centre, de palmettes. Des têtes humaines et des animaux sont figurés sur les modillons avec quelques végétaux.
Ces sujets sont également présents sur les modillons de la corniche supérieure, les métopes présentant à ce niveau un motif de fleurs au nord et de feuillages entrelacés au centre.
Le décor sculpté du portail nord
Le portail nord, notamment la voussure à trois rouleaux, présente un riche décor qui montre l'importance de cette entrée.
Les sculptures de l'arc externe, disposées en ordre rayonnant, représentent des têtes humaines masculines et une féminine, en alternance avec des animaux monstrueux. Deux d'entre elles sont couronnées, celle de la femme et celle de l'homme qui lui fait suite à droite. Les animaux hybrides sont tous identiques. Ils ont des pattes d'oiseau, une crinière, une queue se transformant en feuillage, une tête huppée à gueule dentée.
L'arc intermédiaire est composé de claveaux ornés de deux motifs : l'un est composé, de bas en haut, d'un feuillage, d'un petit boudin, d'un bouton de fleur et de deux volutes ; le second, plus sobre, comprend un bouton floral et un boudin.
L'arc interne est orné d'une palmette stylisée répétée sur tous les claveaux. Au-dessus du portail, les trois arcades portent des motifs - calices et feuillages alternés, animaux assis se faisant face - qui renvoient à d'autre édifices du Poitou.
Le décor sculpté intérieur
Le décor intérieur est porté par les chapiteaux des colonnes de la nef et et ceux des colonnettes de l'arcature aveugle du transept et du chœur.
Le feuillage domine dans la nef. Feuilles plates ou à folioles charnues, palmettes, feuilles plus ou moins découpées ornent les corbeilles des chapiteaux, dans des compositions équilibrées. Quelques chapiteaux à simples volutes d'angle sont également présents.
Dans le transept et dans le chœur, les chapiteaux (corbeilles et tailloirs) de l'arcature aveugle présentent une belle diversité de feuillages. Aux angles d'une corbeille du mur nord du transept, deux petites têtes humaines crachent des rinceaux. Trois chapiteaux de l'absidiole nord sont ornés d'animaux (oiseaux, serpents entremêlés). Certaines corbeilles, notamment dans le chœur, sont plus fouillées que d'autres où les motifs, peu saillants, sont traités d'une manière plus sèche.
Détail de la description
| Murs |
|
|---|---|
| Toits |
|
| Plans |
plan en croix latine |
| Étages |
3 vaisseaux |
| Couvrements |
|
| Couvertures |
|
| État de conservation |
|
| Décors/Technique |
|
| Décors/Représentation |
Précision sur la représentation :
|
Informations complémentaires
Situé sur un territoire dépendant du comté de la Marche, le prieuré de Villesalem est fondé au début du 12e siècle par Robert d'Arbrissel, créateur de l'ordre de Fontevrault. L'architecture de l'église, la structure de la façade et la sculpture témoignent de liens étroits avec des édifices poitevins, notamment Notre-Dame la Grande de Poitiers.
Un peu d'histoire
Dans les premières années du 12e siècle, vers 1108/1109, des ermites originaires de l'abbaye de Fontgombault (Indre) donnent leur ermitage situé aux confins de la Marche et du Poitou à l'abbaye de Fontevraul fondée quelques années plus tôt par Robert d'Arbrissel en Anjou (actuel Maine-et-Loire).
Robert d'Arbrissel installe à Villesalem un prieuré, mixte comme à Fontevrault. Les hommes s'installent à l'extérieur de la clôture des femmes et le monastère est sous la responsabilité d'une prieure. L'église Notre-Dame est édifiée au milieu du 12e siècle.
Le monastère, bien doté par des seigneurs locaux, prospère jusqu' à guerre de Cent ans. Le prieuré est progressivement abandonné par les religieux à partir du 15e siècle. Au 17e siècle, la vie communautaire reprend. Un nouveau bâtiment conventuel est édifié, partiellement adossé à la façade de l'église.
À la Révolution, les biens du prieuré sont vendus. L'église, transformée en grange, n'est plus entretenue ; un plancher divise l'espace intérieur, portes et fenêtres sont ouvertes dans les murs.
À l'initiative de personnalités locales, l'église, qui sert toujours de dépendance agricole, est protégée au titre des monuments historiques en 1914. L'État achète les vestiges du prieuré en 1962 et d'importants travaux sont engagés pour sauver les bâtiments. La restauration de l'église, menée afin de restituer l'état originel, est achevée en 1998.
L'église aujourd'hui
L'église Notre-Dame présente un plan en croix latine fréquemment utilisé dans les monastères poitevins des 11e-12e siècles : nef à collatéraux, transept avec absidioles et chœur en abside.
Elle est construite en pierres de taille et entièrement voûtée, ce qui témoigne des moyens financiers affectés à cette entreprise.
La façade occidentale de l'église Notre-Dame présente une structure fréquente en Poitou. Elle s'élève sur deux niveaux séparés par une corniche et est couronnée d'un pignon ; elle est divisée en trois parties verticales (travées) par des contreforts-colonnes ou des colonnes jumelées. Le portail et la grande baie de la partie centrale sont encadrés d'arcades aveugles latérales. Le jeu de parements (pierres polygonales ou taillées en losange) évoque le décor de la façade de l'église Notre-Dame la Grande de Poitiers.
La travée de droite est masquée par le bâtiment conventuel du 17e siècle.
La sculpture est portée par les éléments architecturaux : voussure du portail, arcades et baie, chapiteaux des colonnes, modillons et métopes des corniches. La disposition rayonnante a été privilégiée. Le décor végétal (palmettes, feuillage en S, rinceaux, tiges grasses avec des boutons floraux) domine sur les rouleaux (arcs) du portail, de la fenêtre et des arcades. L'arcade du niveau supérieur présente un ornement original, des mains serrant des feuillages. Des animaux sont présents sur les chapiteaux des colonnes ainsi que sur l'arc externe de la fenêtre (oiseau huppé).
Les éléments les plus originaux sont les tympans sculptés des arcades latérales du rez-de-chaussée. Ceux de la travée de gauche sont ornés de lions affrontés et d'oiseaux buvant dans une coupe, motif souvent mis en relation avec l'Eucharistie. Les deux tympans de la travée de droite sont visibles à l'intérieur du bâtiment conventuel. L'un porte un lion dont le corps suit la courbe de l'arc ; le second est partagé en deux compartiments qui abritent respectivement un animal à face simiesque et un personnage à visage humain.
De rares édifices du Poitou possèdent des tympans. Ceux de Villesalem présentent des similitudes avec la façade de l'église Notre-Dame la Grande de Poitiers. Plusieurs motifs décoratifs, ainsi que les jeux de parements rappellent également cet édifice.
Un second portail ouvert dans le mur nord de l'église possède un riche décor sculpté. Il est composé de feuillages, de motifs géométriques et floraux et, pour le dernier rouleau de la voussure, de têtes humaines alternant avec des animaux fantastiques. La présence de couronne sur deux têtes ont donné à cette entrée le surnom de « portail des rois ».
L'intérieur de l'église, très restauré, présente un espace aux volumes équilibrés. La nef est composée de trois vaisseaux voûtés : voûte en berceau brisé pour la partie centrale, voûtes d'arêtes pour les collatéraux. Selon un principe constructif fréquent en Poitou, les trois voûtes s'élèvent à même hauteur afin de s'épauler. La voûte centrale retombe sur de grandes arcades. Les piliers sont composés d'un noyau carré flanqué de quatre colonnes. Les chapiteaux de ces dernières portent presque exclusivement de feuillages.
La prédominance du motif végétal prévaut également dans les parties orientales de l'église. Des arcades aveugles ornent le bras nord du transept, le chœur (en alternance avec les baies) et le mur ouest du bras sud du transept. De souples feuillages, dans des compositions très variées, des rinceaux se déploient sur les chapiteaux des colonnettes. Dans la chapelle du bras nord du transept, trois chapiteaux échappent au règne du végétal et sont ornés l'un de serpents, les deux autres d'oiseaux.
| Type de dossier |
Dossier d'oeuvre architecture |
|---|---|
| Référence du dossier |
IA00044962 |
| Dossier réalisé par |
Dujardin Véronique
Chercheur, service Patrimoine et Inventaire Sarrazin Christine |
| Cadre d'étude |
|
| Aire d'étude |
Pays Montmorillonnais |
| Phase |
étudié |
| Date d'enquête |
1986 |
| Copyrights |
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel |
| Citer ce contenu |
Prieuré Notre-Dame de Villesalem (ancien) à Journet, Dossier réalisé par Dujardin Véronique, (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/2cd7bdc1-d762-449b-8aef-44faff045ba8 |
| Titre courant |
Prieuré Notre-Dame de Villesalem (ancien) à Journet |
|---|---|
| Dénomination |
prieuré |
| Genre du destinataire |
de fontevristes |
| Vocable |
Notre-Dame |
| Parties constituantes non étudiées |
église jardin puits |
| Statut |
|
|---|---|
| Protection |
|
| Intérêt |
|
Localisation
Adresse: Nouvelle-Aquitaine , Vienne , Journet
Milieu d'implantation: en écart
Lieu-dit/quartier: Villesalem
Cadastre: 1832 B4 1176,1177, 2015 B 880 (l'église et l'ancien bâtiment conventuel : B 880.)