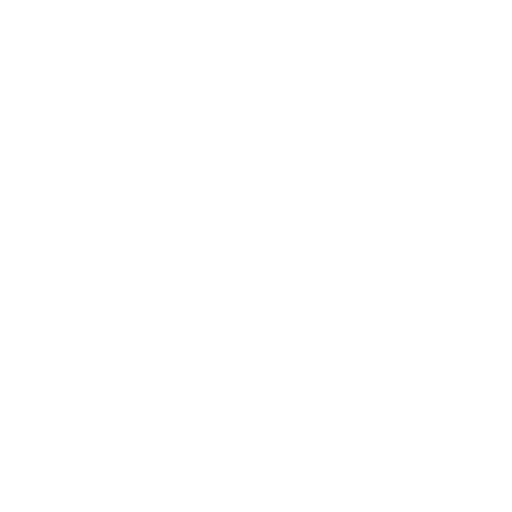Église paroissiale Saint-Martin
France > Nouvelle-Aquitaine > Charente > Juillac-le-Coq
Historique
Juillac-le-Coq est le siège d´une vicairie perpétuelle unie au chapitre cathédral d´Angoulême depuis le début du 9e siècle.
L´église date en partie des 11e et 12e siècles. Du 11e siècle resteraient les assises en petit moellon de la nef. Dix chapiteaux sculptés de la partie occidentale de la nef datent de la seconde moitié du 12e siècle. À l´origine, l´édifice devait avoir une nef unique, comme en témoignent d´anciennes fenêtres placées au-dessus des grandes arcades et qui s´ouvrent aujourd'hui dans les combles des collatéraux, qui ont dû être rehaussés dès le 12e siècle, au cours d´une vaste campagne de remaniement qui semble s´être poursuivie jusqu´au début du 13e siècle.
Selon Nanglard, l´église est ruinée en 1568.
Elle a successivement été restaurée en 1595, 1597, 1655, 1679 et 1714.
Une sacristie est adossée à l´est en 1740 (elle a été détruite depuis).
De nouvelles restaurations sont réalisées en 1844, sous la direction de l´architecte Peronnaud, puis en 1862 et 1878.
Détail de l'historique
| Périodes |
Principale : 11e siècle Principale : 12e siècle Principale : 4e quart 16e siècle Principale : 3e quart 17e siècle Principale : 4e quart 17e siècle Principale : 1er quart 18e siècle Principale : 2e quart 19e siècle Principale : 3e quart 19e siècle Principale : 4e quart 19e siècle |
|---|---|
| Dates |
1595, porte la date 1597, daté par source 1655, daté par source 1679, daté par source 1714, daté par source 1740, daté par source 1844, daté par source 1862, daté par source 1878, daté par source |
| Auteurs |
Auteur :
Peronnaud, architecte |
Description
L´église Saint-Martin, située dans le bourg de Juillac-le-Coq, comprend :
- une nef centrale couverte d´une charpente, encadrée de collatéraux voûtés de brique, et composée de six travées dont la partie en moellons pourrait dater du 11e siècle,
- une travée sous clocher couverte d´une coupole sur trompes et flanquée de chapelles,
- et un chœur à chevet plat composé d´une travée couverte d´une croisée d´ogive à liernes, beaucoup plus élevée que la nef.
La sacristie était adossée au chevet auquel elle communiquait par une porte située à l´est du chœur.
La façade occidentale, refaite au 19e siècle, comprend un portail à deux rouleaux surmonté par une fenêtre en plein cintre, le tout surmonté d´une corniche portée par des modillons sculptés qui délimite le pignon triangulaire. Deux contreforts épaulent le mur occidental.
La cage d´escalier hors-œuvre du clocher se trouve au sud-est de la travée sous clocher. Au-dessus de cette dernière, le clocher comporte trois niveaux. Le premier niveau, en partie masqué au sud par la chapelle adossée, comporte trois arcatures aveugles. Au second étage, les angles et le centre de chaque face sont renforcés par un contrefort-colonne. Sur chaque face sont percées deux baies (certaines sont murées) à doubles rouleaux ornés de motifs géométriques et archivoltes ornées de pointes de diamant qui se prolongent horizontalement à hauteur d´imposte. L´étage supérieur, plus récent et en léger retrait, est percé de deux fenêtres sur chaque face, aux angles amortis en boudin suivi d´un cavet qu´entoure une archivolte qui se prolonge horizontalement à hauteur d´imposte. Le toit à quatre pans à faible pente repose sur une cornique à modillons sculptés modernes.
La nef communique avec les collatéraux par six arcades en demi-cercle reposant sur des colonnes engagées. Au-dessus de ces arcades se trouvent d´anciennes fenêtres qui témoignent d´un système d´éclairage direct du vaisseau principal. Aujourd'hui, ces fenêtres s´ouvrent dans les combles des collatéraux, qui ont dû être rehaussés dès le 12e siècle, au cours d´une vaste campagne de remaniement qui semble s´être poursuivie jusqu´au début du 13e siècle.
Les voûtes des collatéraux, en berceau « aplati », sont modernes et en brique.
La structure des piliers et les chapiteaux des grandes arcades de la nef, appartiennent à la première moitié du 12e siècle, tout comme la travée sous clocher.
Dix chapiteaux de la seconde moitié du 12e siècle sont conservés au revers de la façade et sur les deux premières piles de la nef, au nord et au sud. Leurs décors sont les suivants :
- chapiteau 1, au revers de la façade, côté nord : palmettes (une grande à chaque angle supérieur de la corbeille et une plus petite au milieu et en haut de la grande face) aux tiges doubles s´entrelaçant ;
- chapiteau 2, face ouest de la première pile nord : rinceaux de feuillages au milieu desquels s´agite, au milieu de la grande face, un personnage portant une robe longue ; à l´angle supérieur droit, tête de lion crachant un feuillage ;
- chapiteau 3, face est de la première pile nord : sur fond de décor végétal, quatre lions se dressent, deux par deux, la tête unique à chaque couple d´animaux marquant l´un et l´autre angle supérieur de la corbeille ;
- chapiteau 4, face ouest de la deuxième pile nord : au milieu de rinceaux se dressent deux quadrupèdes dont les têtes humaines occupent les deux angles supérieurs de la corbeille ; à la partie supérieure des petites faces, une tête de lion crache un feuillage, tandis qu´au milieu de la grande face et en haut est figuré un bucrane ;
- chapiteau 5, face est de la deuxième pile nord : dix petites feuilles côtelées sont alignées sur le registre inférieur de la corbeille, tandis que sur le registre supérieur se développent asymétriquement de larges rinceaux ;
- chapiteau 6, au revers de la façade, côté sud : corbeille garnie de trois grandes palmettes, une grande, tombante, à chaque angle supérieur, et une autre, montante, plus petite, au milieu et en bas de la grande face ;
- chapiteau 7, face ouest de la première pile sud : corbeille garnie de rinceaux au milieu desquels on distingue un homme en robe longue au milieu de la grande face encadré de part et d´autre d´un lion dont la tête marque l´angle supérieur de la corbeille et, sur la petite face gauche, seule visible, un oiseau. À gauche de cette petite face, entre les chapiteaux 7 et 8, est sculptée une longue palme ;
- chapiteau 8, face est de la première pile sud : au milieu de la grande face et sur l´angle droit de la corbeille sont disposées sur l´astragale deux grandes palmettes, tandis que les angles supérieurs sont sculptés d´une petite tête humaine, celle de gauche crachant des feuillages qui garnissent toute la petite face gauche ;
- chapiteau 9, face ouest de la deuxième pile sud : au milieu des rinceaux de feuillages s´avancent deux quadrupèdes qui se suivent - l´un sur la petite face droite et l´autre sur la grande face - et dont la tête occupe l´un ou l´autre angle supérieur ; au milieu et en haut de la grande face et à gauche et en haut de la petite face gauche, une tête de lion crache des feuillages ;
- chapiteau 10, face ouest de la deuxième pile sud : deux registres superposés de onze feuilles allongées.
Les deux chapelles couvertes de voûtes d´ogive en brique, qui encadrent la travée sous clocher, se trouvent dans le prolongement des collatéraux. Celle située au sud communique avec la nef et déborde vers l´extérieur de l´édifice. L´ancien mur du collatéral et sa voûte restent visibles sur le mur ouest de cette chapelle.
Les deux chapelles sont des adjonctions de la fin du Moyen Âge, remaniées après les guerres de Religion, tout comme le dernier niveau du clocher. La date de 1595, sur la corniche de la chapelle méridionale, confirme ces interventions, auxquelles on doit également la porte de style Renaissance qui s´ouvre au sud de la nef.
La travée sous clocher est couverte d´une coupole oblongue sur trompes. Les grands arcs doubleaux est et ouest sont en plein cintre alors que les formerets sont brisés.
Le chevet est éclairé au nord et au sud par une fenêtre à colonnettes et à l´est par une grande baie qui a été murée en partie basse pour l´adossement de la sacristie aujourd'hui détruite à l´est, à l´extérieur. Il est couvert d´une croisée d´ogive à liernes dont les nervures sont reprises par de fines colonnettes à chapiteaux du 14e siècle.
Détail de la description
| Murs |
|
|---|---|
| Toits |
|
| Plans |
plan allongé |
| Étages |
3 vaisseaux |
| Couvrements |
|
| Couvertures |
|
| Escaliers |
|
| État de conservation |
|
| Décors/Technique |
|
Informations complémentaires
| Type de dossier |
Dossier d'oeuvre architecture |
|---|---|
| Référence du dossier |
IA00042153 |
| Dossier réalisé par |
Riou Yves-Jean
Dujardin Véronique Chercheur, service Patrimoine et Inventaire Sarrazin Christine |
| Cadre d'étude |
|
| Aire d'étude |
Pays Ouest-Charente - pays du Cognac |
| Phase |
étudié |
| Date d'enquête |
1984 |
| Copyrights |
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel |
| Citer ce contenu |
Église paroissiale Saint-Martin, Dossier réalisé par Riou Yves-Jean, (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/ffda67a1-bc20-4fbc-b06c-17c7e6ace95a |
| Titre courant |
Église paroissiale Saint-Martin |
|---|---|
| Dénomination |
église paroissiale |
| Vocable |
saint Martin |
| Statut |
|
|---|---|
| Protection |
|
Localisation
Adresse: Nouvelle-Aquitaine , Charente , Juillac-le-Coq
Milieu d'implantation: en village
Cadastre: 1812 E3 986, 2011 E 474